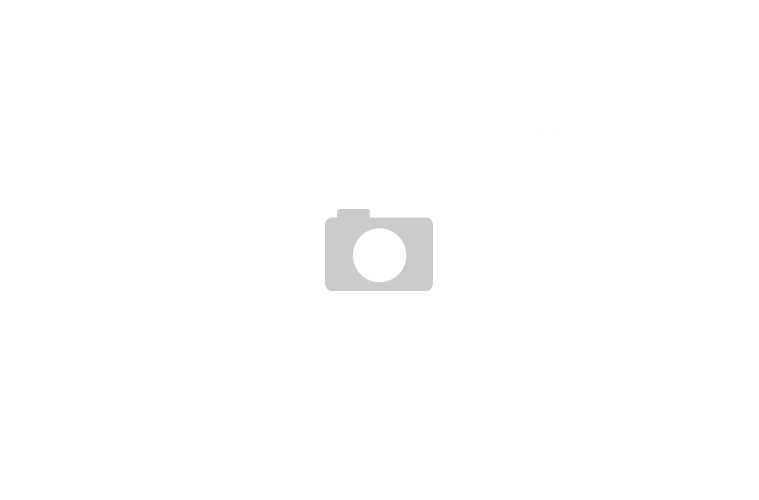«J’ai fait allusion aux expositions les plus brillantes que l’Équateur a organisées à Paris, lors des dernières semaines de 1973 et les premières de 1974: a) ‘Richesses de l’Équateur’, au Petit-Palais avec des pièces d’art précolombien et colonial, b) le ‘Livre équatorien’ avec 1100 publications pédagogiques et c) l’œuvre du peintre Oswaldo Guayasamín au Musée d’Art Moderne et à la Galerie ‘Arts et Contacts’. Singulière occasion pour donner au public de la salle Hulst une idée de l’art équatorien, c’est pour cette raison que j’ai choisi comme thème de ma conférence: L’ÉQUATEUR, pays d’art. Elle a eu lieu le samedi 30 mars 1974 et a commencée par ces mots: «Avant tout je tiens à remercier les dirigeants du Centre d’Études et de Recherches ibéro-américaines pour cette nouvelle occasion de présenter quelques facettes de l’histoire de l’art équatorien… Les grandes expositions qui se sont déroulées dernièrement à Paris ont été une révélation pour le public français, les visiteurs ont pu admirer quelques pièces de l’art préhispanique, ainsi de que de l’art colonial… Comme on peut le lire à l’annexe 3, le Gouvernement équatorien m’a désigné Commissaire artistique de cette exposition»*.
* A. Darío Lara “Los Frutos de la Memoria” (1938-1955). Au chapitre 8, intitulé «París: capital de conferencias internacionales: una gran ceremonia en Notre Dame; el libro ecuatoriano en París; inolvidables compatriotas y amigos» tomo I, le Chêne-aux-Dames, tapuscrit inédit, verano de 1998; pp. 140-141 y 271-272. (note Claude Lara).
Ce texte est annexé à la conférence: «Le Centre d’études équatorienne de Paris ouest Nanterre, le regard de Monsieur A. Darío Lara son fondateur équatorien».