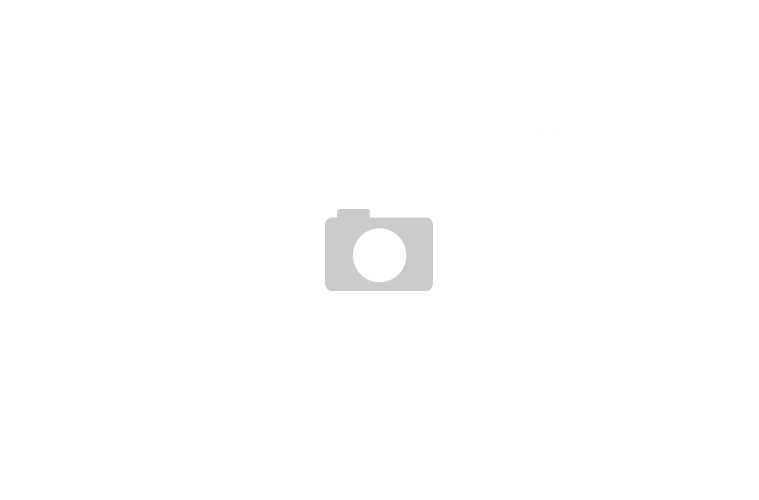Le jeudi 16 mai 1974, le Centre d´Études et de Recherches Ibéroaméricaines de l´Université Catholique de Paris, dirigé par son Président Monsieur Edmond Giscard d´Estaing, membre de l´Institut de France a organisé à la Maison de l´Amérique Latine une séance à laquelle deux livres des Professeurs du Centre ont été présentés:
– Les Messagers de l´Indépendance –Les Français en Amérique Latine de Jean Descola, et
– Voyageurs français en Équateur au XIXème siècle de A. Darío Lara.
Pour nos lecteurs nous reproduisons le discours inédit prononcé par G.F. Pardo de Leygonier (1), Directeur du Centre et Membre de l´Académie Nationale d´Histoire du Venezuela, présentant le livre de A. Darío Lara.
(1) Pour mieux situer cette personnalité, rappelons: “cette belle scène parisienne qui se passe à Paris au marché de timbres, situé au Rond-point des Champs Elysées:
“-Monsieur avez vous un timbre de cette série de Juan Montalvo? demanda un adolescent qui avait dans sa main un timbre équatorien avec l’effigie du célèbre écrivain.
-Pourquoi t’intéresses-tu à Juan Montalvo? demanda à l’adolescent [le Chargé des affaires culturelles de l’Ambassade du Venezuela, M. Pardo de Leygonnier, académicien, historien, conférencier… philatéliste amateur lui aussi]… Surpris par cette question, l’adolescent répondit: mon papa m’a raconté que nous appartenons à la famille de Juan Montalvo et à ce qu’il paraît ce fut un grand écrivain…
-Si tu veux des timbres sur Juan Montalvo et en savoir plus sur lui ajouta le diplomate vénézuélien, adresse toi à ce monsieur et sur une carte de visite il écrivit: Monsieur A. Darío Lara Ambassade de l’Équateur 34, avenue de Messine Paris 8º, tél.: Laborde 10-21” (voir Réflexions sur l’oeuvre franco-équatorienne de M. Darío Lara).
Discours de : G.F. Pardo de Leygonier
Mesdames, Messieurs,
De propos délibéré nous ne suivons aucune espèce de chronologie: Nous avons lu avec le plus grand intérêt, et cela durant les vacances, l´ouvrage que vient de publier le Professeur Darío Lara: Les Voyageurs français en Equateur au XIXème siècle.
Nous avons noté les commentaires que la dite lecture nous avait inspirés, dans notre jardin fleuri et sans aucune documentation ou bibliothèque idoine à notre disposition: C´est un appel à votre indulgence.
Vous penserez sans doute que nous aurions pu attendre de mettre de l´ordre dans nos notes tout en les complétant? Nous vous répondrons que nous avons pensé que la parution d´un livre avait un caractère d´actualité et qu´il fallait en gloser en profitant des sentiments qu´éveillait en nous cette première lecture.
Nous parlerons plus longuement de ce livre que de celui de Jean Descola, car étant écrit en espagnol il n´est peut-être pas accessible à tous.
L´une des nombreuses qualités de Darío Lara -comme professeur- est celle de plaire à ces élèves, en particulier… aux demoiselles. Il a le don de charmer avant d´enseigner sans pour cela perdre de son autorité. Ses premiers travaux didactiques ont, pour moi, des titres rébarbatifs: Fonética y morfología de la lengua española- Síntaxis castellana- El idioma de mi Patria et ainsi de suite…
Pour les quatre ouvrages parus sous ce dernier titre, cela n´a pas dû être commode: en effet, si l´un des pays de l´Amérique espagnole a su créer l´originalité de sa langue, c´est bien l´Équateur.
Par ailleurs, en bon Sud-américain, Darío Lara ne pouvait laisser d´être poète. Je ne vais pas énumérer ses œuvres nombreuses qui reflètent son amour de son terroir. Il me semble qu´il croit sincèrement à cette phrase qu´il introduit dans la présentation du livre auquel nous allons nous référer, et contant ses flâneries sur les quais de la Seine:
“… à la recherche patiente, dit-il, de quelques nouvelles informations”, et il se pose cette question: “… ou bien simplement afin de tuer la nostalgie incurable, laquelle plus d´une fois tourmente ceux qui, du fait de circonstances inexplicables, vivent éloignée de la terre natale…”-
Cela est bel et bien, cependant je le soupçonne quelque peu d´être devenu -comme disait Aragon- un paysan de Paris.
Mais venons peu à peu à notre propos:
Les relations des voyageurs français dans nos pays d´Amérique, ou les mémoires de ceux-ci ont, pour nous, une importance considérable, en particulier ceux du XIX° siècle, c´est-à-dire, pendant ou à la suite des mouvements insurgents ou guerres d´Indépendance.
En effet, si les récits antérieurs et notamment du XVIII° siècle sont souvent romancés, ceux du XIX° se présentent comme une tentative de véracité. Ils émanent d´officiers de marine, de savants, d´artistes ou encore de diplomates, tous croyant déjà à l´esprit de leur temps, lequel tendait à un positivisme de sincérité, quelque peu entaché, toutefois de démagogie. Pour n´avoir pas toujours été de très grandes personnalités, leurs écrits n´ont pas retenu l´attention et sont trop souvent restés méconnus. Il faut donc savoir gré à nos amis Jean Descola et Darío Lara de cette recherche, cette quête, dirais-je, des Français en Amérique Latine, et cela par le truchement, notamment, des Français qui vinrent chez nous ou s´occupèrent de nos affaires; Darío Lara ayant recherché, lui, des textes inédits sur son seul pays et dans une période donnée.
Si bien les personnages de Darío Lara pourraient s´incruster et occuper leur place dans l´œuvre de Descola, ce serait dans une approche plus totale de leurs pérégrinations.
Dans l’impossibilité de pousser l´étude de tous les personnages dont traitent nos auteurs, nous nous bornerons aux trois bonshommes dénichés par Darío Lara et qui symbolisent assez bien leurs différentes conditions sociales. De plus tous trois racontent la même région qu´ils ont visitée dans un même laps de temps.
Darío Lara, peu désireux de naviguer dans le sillage d´un La Condamine ou d´un Ulloa, nous révèlera des noms comme ceux de: René de Kerret, Eugène Souville ou Ernest Charton, nous promettant -par ailleurs- un nouvel ouvrage où nous pourrons apprendre qui était un Ripert de Monclar, un Gabriac, un Guillaume Lallemand, et enfin avec de nouveaux dires sur le mieux connu: Lafond de Lurcy.
Comme il était impossible à notre ami de suivre ses personnages dans leurs périples complets, il devait centrer son étude sur les séjours de ces voyageurs dans son pays: l´Équateur; cela afin d´apporter à celui-ci des matériaux permettant une meilleure connaissance de la physionomie qu´on lui attribuait outre-Atlantique.
Ayant souhaité instruire son pays, il se trouve qu´il pourrait donner, aussi, un enseignement en France. Celui-ci n´est pas seulement anecdotique, il démontre -grâce à ses exemples- qu´il serait possible d´arriver à une synthèse de l´ample réseau d´informations singulières que nous ont tissé ces observateurs.
À leurs écrits devraient s´ajouter, se jouxter, leurs correspondances, patrimoine des archives du Muséum, de l´Académie de Marine, richesse enfin du Quai d´Orsay… documents qui ne sont à la disposition des chercheurs que depuis assez peu de temps.
Nous soulignons cependant que pour son travail, Darío Lara s´est appuyé notamment sur deux manuscrits inédits, celui de Kerret et celui de Monclar.
Pourquoi la voie ouverte par Darío Lara est assez singulière? C´est une question de simple angle de vue.
Quand un européen, américaniste, aborde nos problèmes, il le fait avec un esprit -très justifié d´ailleurs- de soutenance de thèse ou de vulgarisation. Il écrit pour démontrer son savoir et obtenir ses diplômes, ou bien encore pour donner des connaissances générales à un grand public qui ne sait rien de notre Amérique et qu´il est nécessaire de retenir par un aspect amène, voir divertissant, du récit.
Par contre quand l´un de nous, sud-américain, tente ces mêmes recherches, son propos s´adresse à ses compatriotes… et il en est tout autrement.
Notre souci est celui d´écrire “notre” Histoire en utilisant ces matériaux étrangers et ces visions plus ou moins objectives de visiteurs européens. Mais! Pensez bien que dans ce cas nos lecteurs sont déjà informés de la circonstance historique et peuvent -eux-mêmes- les enchâsser dans le cadre, les mœurs qui sont traditionnellement les leurs. Ils reconstruisent le récit par la possibilité qu´ils ont de disposer physiquement de la mise en scène et du contexte naturel.
Si bien nos lecteurs doivent prendre -pour utiliser ces informations le recul du temps nécessaire à l´Histoire, leur paysage est éternel et présent pour eux.
Prenons brutalement un exemple: Qui fera croire à un sud-américain que, face au Chimborazo, ou dans la bataille de Bombona, Bolívar se prenait pour Napoléon? Cela parce que, à la mode du temps, il mettait sa main dans son gilet…
De là ces différences d´éclairages pour le narrateur français ou pour l´investigateur sud-américain.
Le premier écrit “une histoire”, le second écrit “son Histoire” mais naturellement les deux se doivent de collaborer. D´une manière bien normale l´européen connait mieux la conjoncture universelle du moment historique et le dessous des cartes politiques à l´égard des ibéro-américains, tandis que ceux-ci ressentent plus réellement l´ambiance dans laquelle le drame -ou les prolongements de la comédie- s´est finalement joué.
Nous avons aussi des quiproquos anciens que nous pourrions maintenant élucider. En voici l´un des plus notables que nous rapporte Descola.
En 1828, le gouvernement de Charles X va déléguer le Comte Bresson en Grande Colombie pour y étudier les chances de résoudre le futur du conglomérat, grâce à l´établissement d´une monarchie orléanaise. Il progresse et obtient l´adhésion de quelques politiques ou militaires locaux. Sa correspondance envers son Ministre est toute empreinte d´optimisme sincère et, pour lui, l´affaire est dans le sac. Cela au moment même ou son grand interlocuteur -le Libérateur Simón Bolívar- informe de son côté le gouvernement colombien de son opposition radicale et définitive à l´établissement d´une monarchie contraire à ses principes démocratiques. Et c´est une comédie de dupes.
Les deux volets de l´affaire sont donc nécessaires pour comprendre les intentions, les intrigues et les malentendus. Notons en passant que la France de Charles X offrait alors un Prince de la maison d´Orléans et ne voyait qu´un problème: résoudre la succession de Bolívar de la même manière dont avait usé Louis XIV pour dénouer la succession des Hasbourg espagnols.
Toutefois Bolívar connaissant la Sainte Alliance ne voit, lui, qu´une manœuvre qui dissimule un retour “actif” du Pacte de Famille, et par la même se profiler l´Espagne dans une nouvelle formule de colonialisme. Il s´oppose en cela à ses propres généraux, notamment Sucres et Flores qui n´ignorent pas que les pays qu´ils gouvernent sont restés profondément monarchiens. Et puisque l´Équateur est ici au centre de nos pensées souvenons-nous que la question dynastique était déjà primordiale en 1822, lors de la rencontré de Bolívar et San Martín à Guayaquil. Entrevue mystérieuse qui a fait couler beaucoup d´encre.
En effet, le voyageur Lafond de Lurcy dont nous parle Descola, et dont nous parlera Darío Lara dans son prochain volume, avait provoqué une controverse en publiant dans son œuvre Quinze ans de voyages autour du Monde, une lettre dont l´authenticité fut contestée.
Pouvait-il prévoir qu´il avait envenimé un débat qui resterait, de nos jours, une interminable querelle ayant brouillé et embrouillé bien des historiens argentins et vénézuéliens?
Un vrai combat de nègres dans un tunnel!
Ce fut l´historien vénézuélien Vicente Lecuna qui sortit le premier sa hache de guerre, traitant Lafond de Lurcy de menteur et de faussaire. Mais depuis, les recherches des argentins Ricardo Levene et Ariosto González (pour ne parler que des tenants les plus récents de l´affaire) mettront en lumière des pièces des archives de San Martín, actuellement au musée Mitré: huit lettres de Lafond de Lurcy adressées au Libérateur de la Plata, et deux brouillons de réponse de ce dernier.
Il apparaît maintenant de manière évidente que le marin français était un homme sérieux puisqu´il écrivait à San Martín, pour lors retiré à Boulogne-sur-Mer, le 5 septembre 1839:
“Je ne vous dissimulerai pas, mon Général, que je cherche la vérité et la vérité tout entière: et vous êtes le seul homme au monde qui puissiez me fournir des documents qui me manquent pour la trouver, je m´adresse à vous avec confiance”.
Sans vouloir entrer aujourd´hui dans cette fameuse querelle, nous devons retenir les soucis de véracité de l´un des héros de notre Darío Lara dont nous attendons maintenant la prise de position.
Vous constaterez déjà l´incohérence de mes dires puisque je vous parle d´un voyageur que l´auteur n´a pas encore fait entrer en scène et cela avant même de vous entretenir des personnages déjà ressuscités par notre chercheur équatorien… mais passons…
L´Amérique coloniale ne fut pas -en vérité- une Amérique de Nations; elle était une Amérique de ports et de cités. Aussi la signification historique de l´Équateur d´aujourd´hui tient essentiellement dans ces deux noms: Guayaquil et Quito.
Quito! Une entité depuis sa structure quichua, bien avant la conquête, et qui deviendra le centre rayonnant d´une des principales audiences au XVIII°, justifiant ainsi la nation future, son existence et sa réalité.
L´histoire de l´Équateur -en tant que nation indépendante- est relativement récente et ne remonte qu´au premier quart du XIX° siècle: mais ses hommes politiques avaient été des premiers à prôner la liberté et à déclencher le mouvement insurgent, dès 1809. Cet Équateur lié d´abord à la formation politique et arbitraire que fut la Grande Colombie et la Fédération des Andes, de 1822 à 1830.
En effet, non content de réunir des territoires de conditions très différentes, Bolívar ne tint aucun compte de leurs structures, de leur particularisme racial ou géographique, préparant ainsi -sans le prévoir et des révolutions et des guerres entre les nouveaux États dont les frontières théoriques étaient souvent aussi géométriques que mal délimitées.
Les conséquences ne furent pas heureuses pour l´Équateur, injustement amputé en vertu d´une prétendue antériorité espagnole, alors que la naissance des nouveaux États résultait d´une création toute nouvelle et d´un concept différent de celui des anciennes divisions coloniales. Celles-ci d´ailleurs, constamment modifiées ou révisées, dans le passé par l´Espagne elle-même.
Mon ami Darío Lara doit bien sourire en m´entendant, lui qui s´est tellement occupé de ces questions, et comme patriote et comme diplomate, mais s´il veut prendre la parole il n´a qu´à m´interrompre et me la demander, elle sera immédiatement sienne.
Il était réservé au sol équatorien d´offrir la mise en scène grandiose et prestigieuse à l´une des plus violentes et décisives batailles de l´Indépendance. Finis les premiers combats de guerrilleros, les escarmouches entre petites formations, les violences de village à village, de cités minuscules ou d´agglomérations mises à sac. Depuis la victoire de Carabobo en 1821 pour laquelle s´affrontaient 12.000 patriotes contre autant d´espagnols, on est entré dans l´ère des grandes actions militaires. Le choc des armées est comparable aux batailles européennes, si ce n´est que le décor qui n´est certes pas le même.
Quand les dieux eurent décidé qu´il y aurait une terrible lutte, en face de Quito, à 4.600 mètres d´altitude -et tout comme pour les spectacles du Chatelet de mon enfance- on fit appel aux metteurs en scène et aux artificiers…
Le paysage fut déroulé comme un vaste diaporama et le décorateur après avoir fourni des grondements aux volcans de vert vêtus, les orna de mantelets de glace et, les trois coups frappés, ce sera: Pichincha!
Ici tout est singulier. Le commandement notamment; les insurgés vont disposer de José Antonio de Sucre, ce jeune Achille, cet élégant Casanova des salons créoles, ce futur Président jurisconsulte qui aura l´audace de déclarer à Bolívar ce que Joseph Bonaparte ne sut pas dire à Napoléon: “Vous m´avez fait chef d´une Nation et cela pour défendre les intérêts de cette Nation et non plus les vôtres personnels”.
Curieux homme qui s´élèvera, au nom des peuples, contre les aristocraties militaires -dont cependant il fait partie- lesquelles dit-il, “ne permettent pas à l´ordre de s´établir”.
Carrière fulgurante et courte puisqu´il sera assassiné à l´âge de 35 ans au cours d´un épisode romantique: Ayant été alerté de l´embuscade qui l´attend sur sa route, dans un défilé, il dira avec emphase: “Le général Sucre ne recule pas”. Et il poursuivra son chemin conscient de ce qui l´attendait.
Vous pouvez juger par ce court rappel, l´importance du XIX° siècle pour ce très vieux pays qui avait donné à l´art colonial son essor le plus raffiné et ses caractéristiques propres.
Dans toute l´Amérique espagnole, la floraison artistique la plus belle et la plus profonde fût nommée École de Quito. Elle allait servir de modèle et de guide aux autres régions et l´on ne peut comprendre, de ce fait, que l´admiration suscitée par l´Équateur chez la plupart des voyageurs européens se soit réellement limités au paysage. Ils ont été relativement indifférents aux trésors d´art colonial du temps des espagnols.
Parlant d´une église, le Vicomte de Kerret pourra nous dire: “L´intérieur était rechargé d´ornementations, tout était de mauvais goût, mais original. De grands saints ou saintes de grandeur naturelle, grossièrement taillés, bourrés d´or, d´argent…”
Nos voyageurs le sacrifièrent à la mode -déjà!- et ceux qui avaient une vocation de collectionneurs -tel le Marquis de Monclar- s´attachèrent au seul précolombien. Les collections du Musée de l´Homme en témoignent.
Notez qu´en France l´on ne saurait trouver, dans les Musées, une seule pièce représentative de l´art colonial américain, ce composite parfois si étrange et si éloquent. Ici, l´apport de l´indianisme, là, un naïf admirable, un surréalisme poétique.
Les Voyageurs dont Darío Lara nous entretient dans son premier volume forment une trilogie intéressante puisque nous y disposons de trois personnages de castes bien différentes à l´époque: un aristocrate, un peintre et ce que nous pourrions classer comme un bourgeois: un commandant de Marine.
Ce dernier: Souville, est instruit, mais sans aucun doute manque de culture générale; il ne verra de Quito que ses rues sales et étroites, sa disposition en damiers, et surtout, tous les inconvénients sanitaires, enfin l´inconfort dans ses déplacements. De son patrimoine architectural, pictural ou sculptural, de son passé indien, de son passé espagnol ou de ses luttes pour acquérir l´indépendance, rien ne le retient particulièrement.
C´est un observateur négatif, et le bourgeois montre l´oreille quand il est ébloui par les conditions de vie de la société créole.
L´on peut opposer son attitude à celle du peintre Charton dont l´œil sagace sait mieux remarquer et apprécier.
Darío Lara nous a donné des extraits significatifs des récits romancés, de ce dernier car ce peintre s´adonne un peu à la littérature et non sans exagérer les faits; il se personnalise avec un compagnon dans un petit bouquin dont l´action se passe aux îles Galápagos et qui serait digne de la bibliothèque rose. Le réel et le fantastique s´y donnent la main.
Ses dessins et ses peintures sont infiniment plus précieux et ici il ne triche nullement, son talent est certain.
Quant à l´aristocratique de Kerret qui excelle dans ses aquarelles et croquis, bien que n´étant pas un professionnel, il sera sensible au paysage et si, généralement, il en parle dans des formes conventionnelles, l´on peut glaner parfois une phrase semi-poétique, telle celle-ci:
“Les crêtes de El Altar, recouvertes de neige se découpent fines et sveltes sur un ciel infiniment bleu”.
Tout comme Souville, le luxe de certains intérieurs le surprend et il raconte dans ces termes:
“Nous arrivâmes dans une somptueuse salle à manger, toute la vaisselle était d´argent. On fit un premier service, tout ce que l´on obtient par la chasse se trouvait sur la table, même un excellent foie gras et de minuscules poisons, plus petits que ceux des rivières d´Europe, rares dans ce pays. Pour le second service rien de plus étrange que de nous voir conduits à une deuxième salle à manger; une argenterie aussi belle que dans la première, les vins les plus fins et les meilleurs d´Europe; viandes de gros gibier et volailles délicieuses: c´était un repas à nous renverser, absolument des mille et une nuits.
Nous pensions en avoir fini lorsqu´on nous pria de passer à une troisième salle afin de nous servir les desserts. Nous étions sidérés de tant de luxe, de tant de richesse. Ici, tout le service était d´or, les vases de cristal les plus beaux du monde, la table couverte de fruits les plus variés, de sorbets, etc., etc.”.
Nous en avons l´eau à la bouche! Comme nous aimerions l´entendre avec autant d´enthousiasme dans une description des monuments ou des œuvres d´art.
Quant à Charton il semble qu´il ne connut pas de telles agapes; mais il n´était -n´est-ce pas- ni vicomte… ni chargé de mission.
Je dois avouer qu´à mon retour de vacances, j´ai dit à Darío Lara ce que je pensais des appréciations de ses voyageurs sur l´art colonial, ce beau fleuron de Quito. Il n´est pas d´accord avec moi. Nous donnons acte à notre ami de sa protestation.
En vérité nous nous sommes particulièrement penché sur ce que ce livre apporte à l´action des marins au XIX° siècle, et ce qu´il suggère quant à l´évolution de la peinture des artistes ayant séjourné dans notre Amérique, avec ses conséquences dans la littérature et l´édition en Europe.
Il nous paraît cependant indéniable que Charton a peint le paysage et les mœurs avec, tantôt une petite chapelle simple qui pourrait orner les compositions -usuelles à l´époque- de l´Italie ou de la Suisse, parfois quelques maisons plus ou moins imaginaires. Toutefois nous n´avons trouvé, ni dans les illustrations reproduites dans le livre de Darío Lara, ni dans les revues que nous avons parcourues, des dessins ou croquis intéressants, relatifs à l´art colonial proprement dit, pas plus d´ailleurs que de textes. Des évocations? peut-être… une visión profonde? Jamais! Jamais.
Charton a bien donné une magnifique étude: “Quito, république de l´Équateur” qui démontre son talent d´écrivain, et nous allons en donner un extrait alors qu´il faudrait tout lire:
“Je ne perdrai jamais le souvenir de ce que j´éprouvai en entrant dans cette imposante solitude. Une lumière incertaine, verdâtre y confondait les objets et leur donnait une forme vague et fantastique; je marchais, ému et ravi, comme dans un de ces pays imaginaires qu´on voit quelquefois en songe; une atmosphère vaporeuse communiquait à mes membres, fatigués de la chaleur du soleil, un bien être inexprimable; j´aurai voulu m´arrêter, rêver, me recueillir; mais de toutes parts la nouveauté et l´étrangeté des objets m´attiraient; de pittoresques accidents de terrain, des collines, des gorges profondes diversifiaient la scène sans lui rien ôter de sa grandeur…”, et tout est de la même veine, précis, juste.
Mais c’est une vision de peintre et non d’amateur réel des choses du passé. Parlant de la Cathédrale, c’est bien encore le peintre qui parle: «ses voutes ont de la majesté. La douce lumière qui pénètre à travers les vitraux tempère l’éclat des flots de pourpre et d’or répandus partout avec une profusion féérique ; des bas-reliefs travaillés avec art couvrent les murailles depuis le bas jusqu’au Dôme: ils sont partout revêtus d’une dorure aussi fraîche que si elle datait seulement d’hier; un fond rouge fait ressortir ces riches sculptures dont le dessin révèle chez l’artiste de l’originalité et du goût».
À l’Église San Francisco, ce qui le retient, c’est que le fonds sur lequel se détachent les bas-reliefs variés de couleur. Parlant des arts locaux un peintre, Miguel de Santiago, le retient par le fait «qu’il lui fallut inventer une nouvelle manière de préparer les toiles, composer les couleurs, fabriquer ses brosses etc.
La visite d’un atelier de peintre, son contemporain, retient une bonne partie de son récit, mais c’est anecdotique.
Pour terminer cette petite querelle amicale, oh combien!, nous laisserons au lecteur du livre de Darío Lara, des articles de Charton et des souvenirs de Souville, de décider lui-même en dernière instance.
Pour me faire pardonner de persister dans mon sentiment, je dirai à Darío Lara que je viens de demander à mon ami Henri Benezit de faire figurer son Eugène Charton dans la nouvelle édition en cours, de son célèbre dictionnaire des peintres.
Mais revenons à mon texte vacancier «ne variatur»: Quand il s’est agi d’imaginer l’Amérique, les illustrateurs des XVIIè et XVIIIè siècles ne firent qu’une mise en scène artificielle; ils ne s’intéressèrent vraiment qu’à l’anecdote et à la comédie supposée de l’exotisme, et situèrent leurs personnages à seule fin d’animer ou meubler leurs compositions. Ils en étaient restés à Marmantel et à l’Abbé Raynal!
Aussi leurs paysages ne sauraient se passer de monuments aztèques ou incaïques, tout comme il était impératif dans les paysages européens que l’on puisse y retrouver des ruines antiques; Chateaubriand lui-même depuis Rome donnait ce conseil à l’artiste:
«après avoir peint la nature, il doit s’enfermer dans son atelier avec sa toile afin d’ajouter à son paysage: patres, chaumières ou… tombeau».
Pour le voyageur du XIXème siècle, tel notre Eugène Charton, la composition du paysage naturel n’est qu’un cadrage, comme l’on dit aujourd’hui en langage cinématographique.
Cette rupture avec la tradition dont les étapes, en France, étaient marquées par un Claude Lorrain, un Poussin, un Hubert Robert… ce sont les peintres aux Amériques qui vont l’accomplir.
En effet, bien que contemporaine ils sont très loin de voir la nature comme le firent ceux de l’École de Barbizon et, en fait, ils sont les créateurs d’une école particulière.
Allant au-devant d’une objection, celle de nous rappeler la manifestation romantique que nous serions tentés de baptiser sous le vocable d’alpestre, -ceci pour englober des peintures du Sud de l’Allemagne et de l’Autriche, ainsi que du nord de l’Italie- qui trouve son expression la plus typique en Suisse, nous dirions que loin de nous contredire nous y trouvons une intéressante matière comparative.
Bien qu’issue de la pensée bucolique de la fin du XVIIIème avec la tentative d’éliminer les éléments académiques du néo-classicisme -cela avec la tendance naturiste du temps et du lieu- elle ne pourra échapper à un maniérisme et à une sensibilité enfantine. En bref, un paysage conventionnel.
C’est de là que nous pourrions apprécier l’intention tellement différente des peintres en Amérique car ce sont eux, malgré les apparences chronologiques et les parentés, qui ouvriront les voies au paysage de couleurs intenses de la fin du XIXe siècle.
Ernest Charton fût, comme la plupart de ses collègues, tout saisi par l’ambiance redoutable du paysage et, surtout, les couleurs de la nature, aussi les mœurs. Ce fût une véritable pléiade de peintres et nous citerons au hasard et pour exemple: Pissaro, Bellermann, Debret élève de David qui résidera de longues années au Brésil et dirigera l’Académie de Rio, Biart qui visitera plusieurs pays, Emmerd avec ses admirables toiles du Pérou, Manesson Mallet, Jansson, Quillota, Le Capelain, Melby compagnon de Pissaro, Rugendas dont l’œuvre péruvienne et argentine est considérable, d’Orbigny, Roulin et tant d’autres que l’on ne retrouve que dans les collections ou musées d’Amérique latine. Il y a encore les inconnus, Morisot, compagnon de Jaffanson dans la remontée de l’Orénoque ou encore un Thirion de Montauban dont les aquarelles naïves ont une qualité et un charme réalisant déjà le fauvisme.
On pourrait ajouter les peintres attachés à la Marine, formant obligatoirement partie de l’équipage et dont, parfois, nous retrouvons les albums de croquis sans parvenir, cependant, à connaître leurs noms.
Or, tous préparaient le futur de la peinture dans une recherche de la couleur, puis de la spatialité afin de parvenir à la perspective par des plans naturels et non plus par des plans monumentaux.
Seul de ceux que nous connaissons, Camille Pissarro, avait consciemment entrevue la luminosité des tropiques, initiant ainsi l’impressionnisme, ouvrant un cycle qui ne trouverait son apogée et sa fin qu’avec le grand peintre vénézuélien Armando Réveron.
Par Darío Lara nous savons l’étonnement et la modestie d’Ernest Charton qui va s’écrier en contemplant les événements pittoresques; les sites grandioses: «Une série de scènes dignes d’un pinceau plus habile que le mien!». Sans cependant se classer parmi les très grands maîtres, il est et reste un excellent artiste.
Toutefois, ne pourrait-on pas reconnaître à Charton une autre action que celle purement picturale? Certainement et cela en raison de sa collaboration avec son frère Édouard Charton.
Nous rappellerons tout d’abord que jusqu’à la Révolution de Juillet en 1830, les livres embrassant l’ensemble des histoires de voyages ne traitaient que des Christophe Colomb, des Walter Raleight, des La Condamine et bien d’autres du passé, lesquels -pour retenir l’intérêt du lecteur- avaient besoin de la patine du temps. Seuls Humboldt, Dumont d’Urville et Alcide d’Orbigny eurent quelque chance de figurer dans ces ouvrages de compilation, antérieurs à ceux dont nous allons parler.
Les artistes voyageurs du XIXème siècle, qui furent aussi chroniqueurs -tel Eugène Charton ou Roulin- ne savent pas qu’ils seront le ferment de toute une littérature de voyages et d’aventures, cela dans une forme nouvelle laquelle culmine avec un Jules Verne, tant dans les récits eux-mêmes que par les illustrations qui inspireront les éditions Hetzel, entre autres.
Ils sont aussi les promoteurs de ces belles revues instructives et divertissantes dont nous allons parler: Édouard Charton -le frère du peintre méconnu dont nous entretient Darío Lara- débutera par une publication: La Bibliothèque des Merveilles, puis, avec la collaboration de Paulin et Dubochet: «L’Illustration». Dans cette entreprise un quatrième larron, actif et compétent, le géographe Adolphe Joanne dont la célébrité individuelle se fera plus tard en vertu d’éditons plus personnelles, mais surtout grâce aux fameux «Guides Joanne», contemporains du «Baedeker».
Déjà Charton avait publié dès 1823 une revue populaire, laquelle avait vulgarisé pour la première fois la gravure sur bois: «Le Magazine Pittoresque». Ne devrait-on pas dire que le «Le Magazine Pittoresque» n’est pas seulement une revue, mais sans doute «un monument», c’est la documentation (avec «L’Illustration») la plus complète sur les débuts de l’histoire contemporaine, laquelle à notre avis ne devrait pas débuter avec la Révolution française, mais seulement avec celle de 1830.
Édouard Charton ne s’en tient pas là. Il donnera encore les quatre gros volumes Les anciens voyageurs, les six tomes du Tour du Monde qui publie les récits de ses frères, lequel depuis l’Amérique du sud lui fournira des croquis pour illustrations; rapidement imités d’ailleurs par des artistes qui eux, n’auront jamais quitté les rivages de la Seine.
Nous ne pensons pas trop sortir de notre sujet en insistant sur l’action sociale des Charton et plus particulièrement d’Edouard. Il fut un ardent saint-simonien dont il se sépare dès qu’Enfantin fit prévaloir ses doctrines farfelues. Il est aux côtés de Lamartine à l’Hôtel de Ville en 1848. Ami de Carnot, puis de Grévy et sans doute de Thiers, au 2 décembre il signe avec 18 de ses collègues la protestation élevée contre le coup d’État de Napoléon III.
C’est une famille importante, cultivée, et, Eugène, le peintre qui nous occupe partage leurs idées, c’est la gauche intellectuelle de l’époque.
Ils formèrent une école et nous avons nommé, et nous ne devrons pas oublier: Pierre Jules Hetzel, écrivant sous le pseudonyme de Sthal, qui collabora avec et Alexandre Paulin, lui-même collaborateur et cofondateur de «l’Illustration» d’Édouard Charton. Il fut non seulement un promoteur de la Révolution de 1848, mais encore chef de Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères durant dix mois, puis de celui de la Marine et enfin, Secrétaire général du Gouvernement provisoire.
Il est tout à la fois normal et remarquable que la pléiade des Français qui vont se mettre sous les ordres de Bolívar, ou bien encore travailler dans des activités scientifiques en Amérique insurgée soient presque tous des émules des libéraux, encouragés par la plume de l’Abbé de Pradt ou les incitations des savants du Muséum, Cuvier en tête. Avec, en toile de fond: Alexandre Humboldt (pour cela je vous renvoie une fois encore au livre de Descola). En bref, le rôle des Charton et de leurs semblables était non seulement novateur mais encore transcendant.
N’oublions pas, pour compléter ces dires, que la fameuse «Revue des Deux Mondes» était l’héritière du «Journal des Voyages» où collaboraient les deux frères Charton. Elle continuait à sous-titrer sa nouvelle dénomination en conservant l’ancienne, cela en 1829. Telle était sa première vocation et rien ne laissait présager son évolution vers la seule littérature.
Buloz -qui d’un œil borgne gouverne les Deux Mondes, comme l’on disait alors- justifiait son titre, publiant par ailleurs cette documentation précieuse et si peu exploitée par les historiens: «L’annuaire des Deux Mondes», la plus sérieuse des informations politiques de l’époque ne devant rien au reportage littéraire ou romancé.
On reprochera à la «Revue des Deux Mondes» de n’être pas populaire et c’est ce qui la différencie des efforts novateurs d’Édouard Charton.
Sur les rapports des voyageurs avec les revues s’occupant de voyages, on peut rappeler la brouille de François Désiré Roulin, avec Buloz. Dans une lettre de 1861, cet homme de science et si grand peintre en rapporte le motif: «J’ai été reçu un peu moins bien que dans un Ministère. On m’a déclaré que la veille du 15, LE GRAND HOMME n’était visible pour personne».
Il se plaint aussi du ton de Bulloz, quelque peu dictatorial envers ses collaborateurs et en donne un exemple par ce billet: «Tâchez donc, mon cher Roulin, de nous avoir pour le prochain numéro, le fragment dont vous m’avez parlé. Je voudrais bien aussi que vous donnassiez l’histoire d’un héron voyageur dont vous avez parlé à Bonnaire. Vraiment, vous faites trop peu pour la Revue».
Au bas de cette lettre qui a froissé Roulin, celui-ci note au crayon: «Je les ai procurées, il n’a pas voulu les payer à l’auteur».
Si au XVIème siècle l’Espagne et le Portugal prennent possession de la majeure partie des Amériques… Si au XVIIème et XVIIIème ils allaient la recouvrir de leurs civilisations dans sa forme coloniale…
C’est au XIXe, lors des premières indépendances que les voyageurs ne seraient plus, ni des conquérants, ni administrateurs royaux et dominants, mais bien des observateurs attentifs et alors… c’est l’établissement et la montée d’une influence des Français, sino encore dans les mœurs, du moins dans la culture artistique et scientifique. Ils seront eux, des enseignants!
Dans le domaine des arts ils donneront le coup de grâce à l’art colonial ibérique.
Il s’agira d’abord de cette école née sous le pinceau de David dans ses tableaux de batailles ou portraits glorieux de personnages militaires. Ainsi, nous imagerons nos guerres d’indépendance sur l’exemple des Gros, des Gérard, des Géricault et quelques autres.
Et ces maîtres nous tromperont, nous Américains, en même temps qu’ils nous serviront de guides. Nous allons figurer notre Epopée sous des dehors européens: Bolívar passe les Andes à la manière de Bonaparte franchissant les Alpes; nous signerons nos actes d’Indépendance comme une sorte de serment du Jeu de Paumes. Et, nous célébrerons la victoire de Pichincha comme celle d’Austerlitz -sous le pinceau de Gérard- ou celle d’Iéna, sous celui d’Horace Vernet.
Nous aurions deux courants d’influence française, celui de nos artistes hispano-américains qui vinrent à Paris travailler dans les ateliers d’un Léon Cogniet, d’un Baudry, d’un Bougereau ou d’un Bonnat; ils nous doteront, à leur retour, de scènes de batailles, de sujets de genre, hélas aussi de vierges à la Bougereau. Le tout académique, voire même quelque peu «pompier».
Puis l’autre courant, celui des peintres européens, généralement français ou d’École française, lesquels résideront en notre Amérique et donneront en enseignement dans leurs ateliers, ou bien dirigeront nos Écoles des Beaux Arts ou autres académies, tel Eugène Charton qui est un bel exemple.
Ces derniers, saisis par les paysages, nous doteront très heureusement d’une orientation naturiste toute différente de celle encore de mode en Europe.
Alors que Corot empâte ses toiles -et avec génie- les paysagistes en Amérique ont déjà adouci leurs techniques et coloré leurs palettes au contact de ce qui n’est plus un sous-bois, mais une immensité. Dans cette voie ils nous doteront d’un particularisme qui fera nos écoles jusqu’au premier quart du XXème siècle.
C’est ce violent passage de l’Art colonial espagnol -tant dans sa démonstration musicale- à une période post Romantisme qui nous privera des violences d’un Berlioz, ou bien d’un certain Delacroix, celui des fresques de Saint Sulpice qui annoncent déjà Van Gogh et Soutine.
Nous avons sauté de pied joints -pour ainsi dire- dans un Fromentin ou dans les valses de Waldteufel. Ce ne sont que des images bien sûr, mais elles peuvent êtres éloquentes.
Il est évident que le Commandant Souville nous intéresse moins, bien que son récit, simple et parfois détaillé, soit un apport indéniable. C’est l’un de ces braves marins qui a réalisé sa carrière avec courage et honnêteté, cela au milieu de changements politiques assez déconcertants. Ses Souvenirs maritimes couvrent les années de 1837 à 1863; ils correspondent au règne de Louis Philippe, à la Commune, la courte République et le deuxième Empire.
Fort heureusement, à cette époque, on pouvait servir la France sous l’un ou l’autre régime sans déchoir et sans laisser parler ses convictions personnelles. La marine sous Charles X ou Louis Philippe ou Napoléon III restait essentiellement la marine de la Nation et non pas celle d’une dynastie. Il faut reconnaître que les gouvernements qui s’étaient succédé depuis la Restauration avaient conservé une continuité remarquable dans leurs politiques extérieures.
Après avoir été empreinte d’empirisme -et dans ses actions et dans la formation de ses chefs- la marine française allait fournir, en la personne de ses amiraux, les grands plénipotentiaires itinérants et particulièrement dans les mers de l’Amérique Ibérique.
Nommons au hasard les Rosamel, les Duperré, Roussin, Baudin, Mackau, Dupotet, Jurien de la Gravière et enfin Dupetit-Thouars. On peut très bien placer le Souville de Darío Lara dans cette pléiade, bien qu’il ne parvînt pas au grade d’Amiral.
Tous ces envoyés auprès d’une Amérique post indépendance -et dans l’effervescence des guerres civiles qui suivirent- agirent avec tact et mesure. Ces marins ne se battirent pas dans nos mers, mais ils furent présents, apportant – par leurs uniformes et décorations- un décorum bien fait pour séduire. De plus, leurs vaisseaux ancrés dans les ports constituaient un événement. Nous les retrouveront comme «messagers» dans le travail de Descola.
Finies les rivalités maritimes et coloniales du XVIIIe siècle entre la France et l’Angleterre. Après les formules de combats singuliers aux issues imprévisibles, en raison même de l’ancienne navigation à voiles, les marins surent qu’il fallait tourner la page et montrer la force -dans les eaux américaines- pour n’avoir à s’en servir.
Il est vrai qu’en France des événements d’inégale importance allaient compléter cette mutation: le Conseil de l’Amirauté en 1821, les Préfets maritimes et l’École de Brest en 1827, et surtout -sous le second Empire- la décision de 1856 que voici: «Aucun bâtiment ne devra figurer sur les listes navales s’il n’a pas de machines».
En bref, la machine à vapeur !
C’est aussi une époque où les Ministres de la Marine étaient des amiraux qui avaient parcouru le monde avant que de s’asseoir dans leur Fauteuil de la rue Royale. Ils pouvaient donner des ordres en pleine connaissance de cause, savaient les lieux où ils envoyaient leur bateaux; en bref, ils agissaient avec compétence.
Parmi les amiraux que j’ai nommé tout à l’heure, cinq furent successivement ministres avec une grande solidarité et continuité d’active. Souville n’est qu’un exemple de plus et c’est peut-être en cela qu’il retient notre attention.
La probité de son récit manque de panache parce qu’étant brave il est modeste, mais c’est ainsi qu’il nous est de sûre référence.
Darío Lara en a pris exemple, il n’a pas cherché à nous livrer un roman d’aventures. Il a bien situé ses personnages grâce à de patientes recherches et puis, il a extrait ce qui pouvait constituer un apport à l’histoire de son pays. Il eut été facile par quelque détour littéraire d’introduire telle ou telle page plus divertissante ou pittoresque, c’est-à-dire sortir élégamment de son sujet. Il ne l’a pas voulu et a délibérément écrit un livre pour l’Équateur et seulement pour celui-ci. Il ne s’est pas préoccupé du lecteur européen, plus précisément du lecteur français, et pour cela il n’a pas fourni le contexte.
Je m’explique il ne nous apportera que les seuls témoignages des visiteurs sans nous conter la réalité quotidienne de son pays, en contrepoint. À la vision rapide des voyageurs il n’oppose pas ses connaissances des gens, des mœurs, de la politique d’alors. Nous nous inclinons mais nous devrons répéter que c’est un ouvrage pour ses compatriotes et pour eux seuls. Ce n’est déjà pas si mal. Il ne lui reste, maintenant, qu’à expliciter ses recherches dans une édition française, langue où il est orfèvre, et c’est le souhait que nous formons.
Oh! je connais bien ce problème: écrire pour les siens n’est pas écrire pour les autres.
Mais ne lâchons pas encore ni Souville, ni Darío Lara, sans une digression amusante, surtout pour nous Vénézuéliens. Il s’agit de la rencontre de Souville avec le fameux Simón Rodriguez et le récit qu’il nous en a donné.
Notre Darío Lara, prudent, a montré son oreille de diplomate et, averti d’une controverse historique sur un fameux serment de Bolívar, tronque le texte du marin. Nous allons le voir clairement; Darío Lara transcrit le récit qu’a fait, à Souville, le dit Simón Bolívar, comme suit: «et c’est devant lui que le héros prononça son fameux serment de Rome», or monsieur Darío Lara, le texte complet de Souville est: «et c’est devant lui que le héros prononça son fameux serment dans l’Église Saint Pierre de Rome».
Tout comme un bon nihiliste, Darío Lara a fait sauter de la phrase mastodonte du Bramante et de Miguel Angel. Il n’a pas voulu ajouter une nouvelle incertitude à d’autres légendes créées par le mythomane vénézuélien sur cette curieuse affaire.
Simón Rodriguez après avoir inventé un texte absurde a successivement situé ce serment, tantôt en Suisse dans l’enthousiasme de Guillaume Tell et parlant au voyageur Alexandre Holinski, tantôt sur le Monte Sacro -en parlant à Uribe- et enfin dans la Basilique Saint-Pierre, sans que l’on puisse bien comprendre l’élection de ce lieu pour un jacobin mécréant qui se faisait une auréole de son athéisme.
Comme je ne suis pas tenu, Dieu merci, à de telles prudences diplomatiques, je vais vous lire in-extenso l’amusante note prise sur le vif pour le Commandant Souville et vous aurez ainsi un échantillon du style de ce brave marin:
«Gala de soir chez M. Bourcier. Il avait invité en notre honneur son seul ami, le chargé d’affaires de la Nouvelle Calédonie, espèce de petit pion à lunettes, niais démocratique et social bien fait pour représenter un pays qui se nourrit de la moelle de Babeuf. Il y avait aussi un français, honnête sellier nommé Houel, brave homme fort serviable. Venait enfin un troisième invité, qui ne parut pas au dîner, mais qui nous dédommagea largement dans la soirée: c’était un personnage éminemment curieux, l’ancien précepteur de Bolívar, Simón Rodriguez. Aux soins que prit M. Bourcier pour le mettre en scène il fut visible que c’était là le clou de la soirée, et qu’on attendait une forte impression sur nous. Le vieux Rodriguez est certainement ce que les Anglais appellent `a character`. Il a vécu en Europe, a assisté -si toutefois l’on peut l’en croire- à toutes les phases de la Révolution et de l’Empire, a suivi notre armée à Moscou, et y est resté après elle deux ou trois ans. Précepteur de Bolívar dans son enfance il l’a suivi ensuite dans toute sa carrière historique, et c’est devant lui que le héros prononça son fameux serment dans l’Église Saint-Pierre de Rome. Esprit hardi et paradoxal il absorba tout le fatras philosophique du dix-huitième siècle et se détraqua tout à fait au contact de nos révolutionnaires, s’appropriant leur pathos empoisonné et le donnant effrontément comme le produit de son cerveau. Ce soir-là le vieux cynique avait trouvé un auditoire. L’occasion était trop belle, et il déploya devant nous tous les trésors de ses utopies qu’il croyait, peut-être de bonne foi, inédites, en les assaisonnant de crudités licencieuses, révoltantes dans la bouche d’un vieillard. M Bourcier attendit en vain de voir éclater notre enthousiasme».
Parmi les innombrables études que l’on peut ou que l’on pourrait faire sur les psychologies collectives des peuples, rien ne serait aussi subtil et curieux que de parvenir à définir les sentiments des hispano-américains à l’égard de la France et, réciproquement, des Français en ce qui concerne notre Amérique.
Pour les créoles, la France lointaine est considérée en fonction des seuls sentiments qui lui sont prêtés: terre de liberté et de despotisme tout à la fois, justice sociale et anticléricalisme, patrie des sciences et du progrès… et tout cela variant suivant l’échelle du jugement et dans le climat de l’époque.
Cette France, souvent ennemie de l’Espagnol, hautaine et distante envers une Amérique retardée et supposée sauvage.
Connaissant mieux les voyageurs au Venezuela et en Colombie que ceux de l’Équateur, nous prendrons pour un exemple un Comte de Ségur qui fait tout à la fois un éloge de la société, de la beauté des femmes et du paysage, mais qui, en cette fin du XVIIIe nous donne une vraie caricature de l’administration espagnole et de l’Église: c’était la mode de son temps.
Jean Descola nous en parle savamment dans son livre, m’évitant ainsi quelques citations opportunes. Une cependant: “Là, le fanatisme et la soif de l’or tuaient pour convertir, ravageait pour s’enrichir, dépeuplaient pour dominer et, l’Évangile d’un Dieu de Paix à la main, allumaient partout des bûchers».
Monsieur de Ségur avait confondu les temps des rois catholiques avec l’année de son séjour au Venezuela.
Mais revenons à nos sentiments envers la France: Comment pouvions-nous nous expliquer à nous-mêmes, tout à la fois, notre douleur d’apprendre l’invasion de la Métropole par les armées de Napoléon cotisant des fonds considérables pour l’époque afin de soutenir la résistance espagnole, nous déclarant «junte de préservation des droits de Ferdinand VII `notre seigneur’ -cela en 1810- puis prenant les armes contre l’Espagne l’année suivante en nous réclamant, cette fois, de la Révolution française et de ses auteurs?
En même temps que nous sentions l’humiliation de la Mère Patrie -à quoi s’ajoutaient les atroces nouvelles transmises par les Anglais- nous obligions la métropole à soutenir un combat fratricide aux Amériques alors qu’elle était engagée dans une lutte mortelle pour sa propre libération. Position complexe ou l’affection et la haine se sont partagé les mentalités.
Quant à la France elle est une menace effective dès 1808, renouvelée en 1815 lors de la restauration des Bourbons, plus nette encore au Congrès de Vienne en 1822… et cependant son influence culturelle est déjà notoire, s’affirmant plus précisément en 1830.
Pourquoi ai-je abordé cet aspect incertain de choses mal élucidées? Parce qu’il peut expliquer en partie -et nous permettre de comprendre- les sentiments des Français voyageurs, qu’ils soient marins, hommes de science ou artistes. L’admiration et le dédain se mélangent constamment. Les aspects de nos guerres civiles ou «pronunciamientos» ne leur permettent pas d’admettre l’enfantement difficile et la fusion raciale de nos jeunes nations.
Tout cela est-il seulement du domaine du passé? Je ne le crois pas. Pour l’Europe, nous ne sommes pas encore des citoyens à part entière. Le livre de Darío Lara -pour qui sait lire entre les lignes- révèle tout cela de multiples façons.
Le vicomte de Kerret raconte qu’en Équateur gouverné dictatorialement par le Général Urbina: «Le vol, le pillage, l’assassinat, le sacrilège étaient à l’ordre du jour…».
Quant à Souville, il décrit ainsi la ville de Caracas lors de son passage au Venezuela: «Cette capitale est aujourd’hui en décadence, il ne lui reste plus que son nom, son chocolat et la tombe de Bolívar». Ni la geste pour l’indépendance ni ses héros ne retiennent son attention, et pourtant c’est un militaire.
Le livre dont nous parlons -à tort et à travers- nous le savons bien, révèlera encore- et dans un même ordre d’idées- la personne même de l’auteur, un autre persan de Voltaire à Paris, et cela en l’an de grâce 1973. Plus de vingt-cinq années en France et toujours sympathiquement étranger.
Peut-être sans le savoir et en tout cas sans y croire, Darío Lara -en plus du fait de ses découvertes de textes- a surtout écrit une page de l’histoire du malentendu existant entre l’Europe et l’Amérique Latine.
Par ailleurs il se devait d’épouser l’erreur de Paul Valéry qu’il cite: «Paris est une personne morale, chargée -en quelque sorte- d’une mission spirituelle permanente!», et je demande: Paris? et pourquoi pas: la France?
La France paysage, la France monumentale, la France artistique, la France scientifique, la France au langage ineffable… et alors Monsieur Valéry, tout cela ne serait rien? ou rien que Paris? Pour nous Paris est la duperie, le mirage, le miroir aux alouettes.
Mesdames et Messieurs, j’espère que vous ne vous trompez pas sur mes dires; c’est au nom de la France que je rejette Paris dans cette qualité exclusive de personne morale, chargée seule d’une mission spirituelle alors qu’il n’est qu’une parcelle de la culture qu’il se doit de partager avec tant de villes grandes et petites qui furent et restent des foyers intenses, et qui ont donné les plus grands hommes de l’Histoire.
L’admirable langage monumental de la Capitale, legs du Moyen-âge ou du siècle de lumières, ne s’explicite pleinement que dans le langage de la Nation. Pour belle que soit Notre Dame de Paris, son sens complet s’inscrit dans le réseau des Cathédrales.
Ceci dit, nous espérons que nous aurons bientôt l’occasion de gloser sur et autour du second et troisième volume par notre ami. Dans le premier il a donc traité de Kerret, de Charton et de Souville; dans le second nous trouverons le Lafond de Lucy dont nous avons dit quelques mots tout à l’heure; nous y verrons le Marquis de Monclar d’illustre famille huguenote dont le rôle culminant et sans doute la fin de sa carrière diplomatique fut le Vénézuéla; puis le Comte de Gabriac, fils d’un bouillant marquis qui fit bien parler de lui au Brésil; et enfin, Guillaume Lallemand que Darío Lara qualifie d’apôtre de la légende noire. Pour le troisième volet, c’est encore le mystère…
Et maintenant, cher Darío Lara, je vais vous céder la parole; vous pourrez ou me remercier -c’est ce qui se fait généralement- ou me pulvériser comme vous l’avez fait de la basilique vaticane. Soyez assuré que je souffrirai tout autant, de l’un, comme de l’autre.
«Des voyageurs français en Équateur au XIX° siècle»* – Le Vicomte René-Maurice de Kerret (1° partie)
ANNEXE : À LA RECHERCHE DE LA GLOIRE (1)
Miguel Yaulema, peintre équatorien authentique, riche de l’expérience de ses voyages en Amérique et en Europe, a déjà participé à plusieurs expositions et a obtenu des triomphes confirmés, dans ces dix dernières années. Il vit aujourd’hui à Paris, c’est-à-dire qu’il y travaille, comme l’illustre Garcín de «l’Oiseau Bleu» et tous les jeunes artistes de «Café Plombier» dans le comte de Rubén Darío, «Tous à la recherche de la gloire».
«La création m’a toujours intéressé plus que la perfection», lisons-nous dans une des dernières pages du au génie d’André Malraux. Cette pensée m’éclaire quand j’examine l’univers déconcertant et coloré de Miguel Yaulema. En vérité, ces origines américaines du tropique: paysage et couleur, exubérance débordante, convulsion sociale déchirante et coloris éblouissant guident sa peinture. Ou mieux, ce sont les racines élémentaires de son art qui nous entrouvrent la forêt de ses mondes turbulents et angoissés. C’est la création vitale, tourmentée qui heurte, peut-être, l’équilibre rigoureux et qui déconcerte par la force du sujet, toujours inusité, atrocement décharné. Pour beaucoup, ce n’est pas encore l’heure de la perfection; mais toujours la création de figures avec une hallucinante richesse d’ombres et de couleurs.
Cette richesse du coloris, les indéchiffrables figures qui s’entremêlent, qui se combinent et se confondent, produisent certaines idées obscures et puissantes d’excitation et d’exaltation. Yaulema accomplit ainsi le précepte de Van Dogen, pour qui: «Il faut qu’un tableau soit une chose excitante et exaltant la vie, car au fond la vie est triste et sombre».
La peinture de Yaulema est en outre un effort de création continue et constante. Viendront avec les années la pureté, la perfection que l’on atteint grâce à beaucoup de qualités et tout spécialement le désintéressement total pour l’art. Déjà Apollinaire le fit remarquer quand il se référait à l’art de Dérain: «C’est en encourageant l’audace et en tempérant la témérité que l’on réalise l’ordre, c’est-à-dira, la perfection. Mais il faut pour cela beaucoup de désintéressement».
Que Yaulema suive la règle d’Apollinaire. Et le reste viendra de surcroît.
s) A. Darío Lara
Paris, le 28 février 1971
(1) Cette note nous permet de présenter bien que brièvement le peintre qui illustrera de neuf très beaux dessins le livre présenté et qui pour la première fois seront reproduites en couleur, in: le Tapuscrit: «Miscelanea (II)», 1949-1975, Le Chêne-aux-Dames 2007, article numéro 21 (Buscando el viejo laurel verde : Miguel Yaulema, París, febrero, 1971).