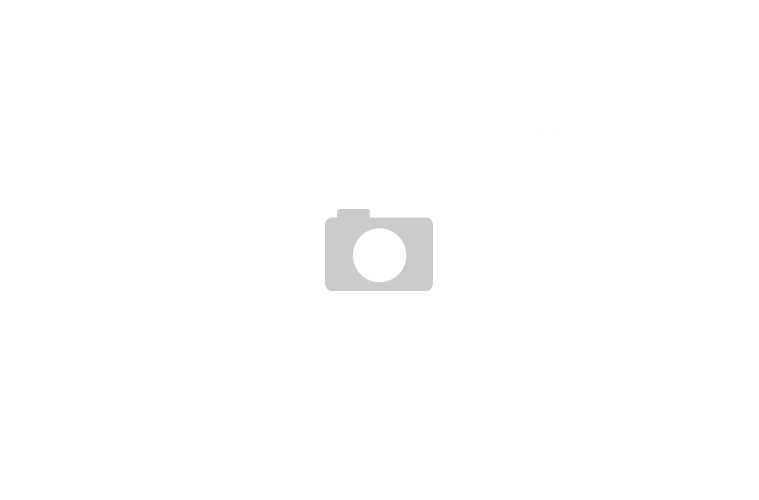La flânerie, action de se promener sans hâte ni but, permet de s’abandonner à l’impression du moment et suppose une forme d’inaction où le corps, bien qu´en mouvement, assume une disposition passive. D’où une forme d’errance par laquelle le flâneur s’exerce délibérément à la perte de soi (2). Le recueil de poèmes en prose de Telmo Herrera (Mira, Equateur, 1948), Desde la capital de los MalGenioS, qui a pour sous-titre Paris 1995-2000, publié en 2000, semble relever de cette flânerie, topique parisien depuis Baudelaire : il se construit en déambulations dans Paris mais aussi en déambulations intérieures, manifestes dans les pensées les plus intimes d´un « yo » poétique qui se livre au lecteur et, ce faisant, s´affirme comme conscience poétique. Déambulation et flux de pensée se combinent, entre Paris et Quito, pour créer une poésie du mouvement aux dimensions métatextuelles.
Comme Walter Benjamin l’a montré s´agissant de Paris (3), l’observateur y est confronté à un paysage urbain qui est aussi un ensemble de mouvements et de signes. La voix poétique équatorienne immergée dans Paris devient ici actrice de la mobilité ambiante. La voilà confrontée à une expérience sensorielle, et souvent sensuelle, qui prime, qui envahit la conscience et la submerge, rendant impossible la saisie globale non seulement de l´espace urbain mais de la pensée. Ce phénomène de la discontinuité se manifeste dans la forme originale du recueil, ensemble de fragments-impressions ou fragments-sensations. Ces derniers, alors, occupent l’espace physique de la page non pas comme une continuité textuelle, celle des phrases et des strophes, mais sous la forme, verticale, de groupes de mots superposés dont le découpage défie la syntaxe et la métrique. La verticalité associée aux ruptures abruptes préside à cette poésie du mouvement.
Comme nous tenterons de le montrer, la poésie de Telmo Herrera surgit de l´éloignement dans un Paris flâné, avec son lot de petits chocs et de rencontres, non sans humour. Il conviendra de cerner le Paris que ce « yo » poétique présenté d´emblée comme équatorien construit ou plutôt reconstruit, au prisme de son seul regard. Paris y apparaît comme un ensemble de signes qui résonnent et se font écho. Ils l´invitent à l’interprétation, moteur de l’écriture, et, simultanément, à une réflexion sur l´écriture même. L’écriture « musculaire », modulée par des rythmes qui rendent compte de la double mobilité, consciente et inconsciente, débouche ainsi sur des « fictions perceptives » (4), celles d´un Paris équatorianisé.
Genio et genios : Paris, ville-texte du poète équatorien
Le « yo » anonyme du recueil est avant tout un lecteur ; il lit sur le Pont des Arts, dans le métro, dans les cafés ; il évoque ses lectures avec ses interlocuteurs ou en son for intérieur, dans ses flux de pensée ; il rencontre plusieurs écrivains, connus et inconnus ; il écrit lui même et aspire à être lu. C´est à la lumière de ses lectures qu´il regarde Paris, un Paris qui, dès lors, n´est plus un espace urbain mais un espace littéraire dont Karlheinz Stierle rend compte dans un ouvrage au titre parlant, Le mythe de Paris. Signes et conscience de la ville (5). Le regard du « yo » poétique s´attache ici à relever les signes manifestes de ce Paris mythique, inscrivant d´emblée le recueil dans un réseau de topiques et de références qui donne à l´ensemble sa dimension métatextuelle. Ecrire à Paris autour de ses expériences parisiennes, c´est proposer un discours sur l´écriture et l´art, préoccupation au centre de toute l´oeuvre de Telmo Herrera, de ces précédents recueils, Algo así como un poema’78 de 1981, Correo Aéreo – Par avion – Air Mail de 1978, La publicidad, cuentos de hadas del siglo XX de 1977, comme de ses romans, notamment La Cueva de 1995 (6).
Le titre Desde la capital de los MalGenioS l´illustre, qui fonctionne lui-même comme une condensation de signes et de sens. La voix poétique s´exprime depuis une capitale qui est d´abord celle d´un génie que le regard, par la typographie, distingue d’emblée (« Mal » se détache de « Genio » par leur majuscule en gras respective) et au singulier (le S majuscule gras se détachant à son tour du mot « Genio », en minuscules). Ce génie, au singulier et posé comme universel, renvoie alors à un Paris présenté depuis Walter Benjamin comme la « capitale du XIXe siècle », centre de gravité de la pensée et de nouvelles formes d´écriture. Paris est elle-même génie ; elle irradie ; et se trouver dans cette capitale, c´est déjà s´abreuver à une source d´inspiration qui transfigure le « yo » promeneur en poète créateur. Paris est alors un génie au sens éthymologique du terme, un esprit qui influence, envahit, habite comportements et pensées.
Au pluriel, elle est la capitale de ces « Genios » avec la majuscule respectueuse, auteurs qui ont bouleversé les arts et auxquels la voix poétique rend hommage. Le recueil crée ici son Paris mythique. Aux côtés d´un Picasso, par exemple, se trouve l´allusion à la figure tutélaire de Juan Montalvo, glissée ludiquement dans les références techniques : « Este libro se acabó de imprimir en una « impresora laser » de un amigo del Arte, pariente de Juan Montalvo, el 24-05-2000 » (7).
La filiation de ce recueil avec Juan Montalvo est double, par le truchement de la personne de l´éditeur, mais aussi et surtout par celle de l´auteur, un intellectuel équatorien lui-même ami des arts. Rappelons que Telmo Herrera n´est pas seulement poète, mais romancier, dramaturge, graphiste abstrait, metteur en scène, acteur de théâtre ou de cinéma « cuando se presenta la ocasión » (8) comme il le dit lui-même. C´est le mythe d´un Paris capitale des arts, dans leurs multiples manifestations, que s’approprie du point de vue équatorien le recueil. En l´occurrence, la figure du génial Montalvo participe de l’appropriation de ce mythe, auquel elle reste associée en Equateur. Dès 1857, lors de son premier voyage à Paris, Juan Montalvo y avait rencontré des intellectuels influents, de Lamartine à Proudhon (9).
Paris représente également l´espace artistique par excellence, parce qu´il est en outre un espace-refuge pour des artistes assoiffés de liberté créatrice. A ce titre, la figure de Montalvo associée à ce motif parisien contribue à façonner une certaine représentation du travail de l´écrivain, assumée ici par le « yo » poétique. L´artiste doit renoncer à la facilité, accepter de nombreux sacrifices, travailler humblement dans l´ombre, pour créer une oeuvre digne de ce nom. A l´instar de Montalvo mort à Paris dans la misère, la pauvreté caractérise les amis artistes et alter ego du « yo » poétique. Pour se rendre à un dîner littéraire, l´artiste inconnu et méprisé doit s´endetter afin de trouver de quoi payer son repas :
La cena, claro, la
pagarás tú.
Es muy caro el precio
de entrada.
Solo para reservar ya
te han cobrado
una fortuna. (10)
La pauvreté est posée comme le garant de la liberté de pensée. Pour conserver cette liberté, Juan Montalvo, virulent polémiste, avait renoncé à plusieurs charges qui lui auraient assuré une sécurité matérielle, et fait le choix de s´exiler à Paris. C´est cette attitude que semble faire sienne le « yo » poétique (11). Pour ce dernier, l´artiste est nécessairement un artisan de l´ombre. Le recueil est d´ailleurs fabriqué à la main par l’auteur, en 21 exemplaires seulement. Montalvo, en son temps, tardait à publier, faute d´argent, refusant néanmoins tout compromis, Siete Tratados dont le premier tome paraît finalement, grâce à l´appui d´un entrepreneur de Besançon, en 1882 (12). Le mythe du Paris des arts, le motif de la liberté créatrice, le topique de l´artiste marginal et affamé se rejoignent dans la figure tutélaire de Montalvo ; ils se font écho pour proposer une réflexion sur le cruel labeur de l´écrivain et l´ingratitude de l´écriture.
Le flâneur narre en effet des rencontres qui alimentent cette représentation de l´artiste maudit. Associées au motif d´un Paris bohème, elles rappellent d´autres figures tutélaires de la littérature équatorienne, celles de la « génération décapitée » : Menardo Ángel Silva, Ernesto Noboa Y Caamaño, Arturo Borja et Humberto Fierro. Ces précurseurs du modernisme en Equateur, largement influencés par les symbolistes français, apparentés à ce Paris littéraire à travers les influences revendiquées de Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine, incarnent l´amour d´un art pur, dégagé de tout compromis, au nom duquel ils choisissent le suicide, sacrifice ultime. Ces thèmes de la douleur d´écrire, du mépris enduré par l´artiste, du désespoir de n´être ni lu ni reconnu, du suicide même, surgissent ici dès la dédicace. C´est à tous ces auteurs « décapités », à travers leurs avatars contemporains, fruits de ses rencontres parisiennes, que le « yo » équatorien à Paris dédie son ouvrage. Ce dernier, de nouveau, par le mythe de Paris, s´inscrit dans une communauté littéraire universelle, tout en reconnaissant sa filiation équatorienne :
Dedicado a los
La figure de l´écrivain marginalisé et maudit scande le recueil. Elle resurgit dès le rappel des droits d’édition :
Otros, ya ni intentan
Juan, de Guatemala,
Carlitos, de México,
Un mes después supe
La voix équatorienne se frotte aux mythes parisiens pour mieux s´affirmer comme créatrice, à l´écoute de ses propres génies, inspirations, angoisses, doutes, à leur tour décryptés et mis en formes. Déambulant dans une ville-texte autant, si ce n´est d´avantage, qu´une ville-espace, « yo » devient l´auteur de sa propre fiction poétique. Au-delà des recontres, il se rencontre lui-même. Tout se passe comme si lire et chercher à lire les signes de la ville était se révéler à soi-même comme conscience poétique. Le « yo » tire son propre génie d´un Paris des génies réappropriés.
Mal genio et malos genios : de la déconstruction à la réappropriation du mythe
Notons que « yo » écrit « depuis » Paris. Desde pointe en creux qu´il n´est pas de Paris, même s´il se trouve à Paris. « Yo » est un étranger qui découvre la ville au quotidien. En effet, s’il n’est jamais décrit, « Yo » se pose d’emblée comme un Equatorien à Paris, à travers des liens affectifs forts qu’il aime à évoquer. Le fragment 3 le dépeint en oncle ardemment attendu à Quito par une fillette, sa nièce :
Dicen que los pájaros
Le terme Desde du titre ancre le recueil dans le genre du récit de voyage. Les fragments-impressions sont les notes du témoin d´une réalité exotique, parfois insolite, pour un lecteur Equatorien. Il se crée alors un mouvement supplémentaire, sous la forme de va-et-vient entre un ici et un là-bas, manifestes dans l´évocation de ces parents, amis ou voisins restés à Quito, non sans nostalgie.
Pour le promeneur étranger, la ville est espace tangible, balisé par des référents bien réels et connus de tous, Saint-Michel, le Centre Pompidou ou Notre-Dame. « Yo » rend compte de ses découvertes les plus triviales. Là encore, le titre en témoigne. Avec humour, de nouveau par le jeu typographique, le titre évoque des Parisiens peu aimables voire grossiers. « MalGenioS » renvoie à l´expression familière « tener mal genio », et voilà Paris posée d´emblée comme la capitale de la mauvaise humeur, ce que confirment plusieurs poèmes, notamment le fragment 6 :
En París,
En vez del emblema
A la mauvaise humeur des habitants s´ajoute leur saleté. En témoigne le motif de la déjection canine, récurrent dans ce recueil, qui souille une ville déjà crasseuse, polluée voire asphyxiée. L´espace urbain y est hostile et le promeneur décrit en ces termes l´agonie d´un pigeon, figure dégradée de la colombe de la paix :
Picotea, todavía,
Mauvaise humeur, saleté, pollution, indifférence n´ont rien d´original et relèvent des clichés sur les métropoles. Pourtant, ils participent ici de la déconstruction du Paris Ville Lumière, représentation si prégnante en Equateur au XIXe (18). « La caca de perro » démythifie autant qu´elle démystifie ce Paris raffiné et luxueux, promesse de progrès et de culture, « où la ville semblait donner à l’esprit du temps une forme lisible » (19). Dans le fragment 43, de nouveau confronté à une déjection canine, « yo » se demande pourquoi l’homme se choisit pour compagnon un chien plutôt qu’un cochon, à l’intelligence bien supérieure. Dans ce Paris démythifié, figure de la médiocrité, la réponse s’impose d’elle-même : parce que le chien, justement, n’a pas l’intelligence du porc.
La humanidad es eso,
Siempre se ha tratado
L´entreprise de déconstruction s´attaque aussi au mythe littéraire parisien. Ainsi, dans le fragment 2 bis (notons que la numérotation des fragments-déambulations reprend le « bis » des numérotations des rues de la ville), un groupe de critiques snobs, présentés par la voix poétique comme « los que pretenden saber todo » ou comme des « comerciantes del arte », encense un auteur qui expose dans une galerie de la rue de Seine. Ce dernier est pourtant un producteur en série de livres, « como producto[s] y objeto[s] de venta y no como creación literaria » (21). Le Paris bohème des artistes entièrement dévoués à l´art pour l´art semble avoir disparu, au profit d’une industrialisation de la culture. La démythification se poursuit dans l’absurde transformation du brouillon du premier roman de cet auteur en une oeuvre d’art graphique, exposée rue de Seine, à force d´avoir été lue, raturée, tâchée. Voilà le romancier érigé malgré lui en artiste plastique, auteur de « grafismos abstractos ». Enrichi et célébré, il remercie la critique :
Gracias, les dice, con
Le fragment 48 revient de nouveau sur le mépris réservé à l´artiste-artisan par un Paris désormais réduit à un marché culturel. La parole créatrice n’y est plus entendue. Elle est même étouffée, alors que « luego, todo lo que él dirá será ley » (23) si l’artiste rencontre le succès. La vie de bohème n´y étant même plus tolérée, il ne reste à l’artiste qu´à rentrer dans le rang et disparaître :
El artista (que todavía
O sea, amor, familia,
L´entreprise de démolition du Paris mythique se trouve toutefois au service d´une réécriture du mythe. « Yo » déconstruit pour mieux offrir sa propre représentation de la ville. Il la réhumanise par son regard, reformulant la ville-texte qui devient mythe personnel. Le cliché, nouveau signe dans le réseau des signes, y sert de matériau poétique. Les représentations admises sont récupérées et réélaborées sous le signe de l´humour et de la tendresse, principaux vecteurs d´humanisation.
Ainsi la ville est-elle constamment associée à des visages féminins, souvent entrevus. Les rencontres furtives président alors à un retournement des clichés. Dans le fragment 11, la froideur de la ville, l´anonymat du métro, l’indifférence sont suspendus par un sourire aux effets magiques :
Ella empezó
Dejé de leer. Sonrió.
Le métro, espace parisien par excellence, à la fois mobilité et immobilité en raison du confinement obligé, est propice aux rencontres et devient le lieu privilégié de la réappropriation de Paris par le promeneur mais aussi par le poète. Ainsi, dans le fragment 49, « yo » admire-t-il la beauté d´une inconnue, songeant qu´elle le regarde peut-être dans le reflet de la vitre du métro (26). Le promeneur tient à retenir le nom de la station où elle descend, Les Halles ; le poète, lui, en prend note et met en mots cet échange de regards qui n´a peut-être pas eu lieu. La rencontre peut également être sensuelle, selon le topique de la Parisienne peu farouche. De nombreux fragments narrent des échanges érotiques passionnés. Non sans tendresse, ils sont parfois associés à des amours anciennes, restées en Equateur, si bien que Doris, Beatriz, Marie, Silvia ou María sont les facettes d´une même figure, celle de l´être aimé, qui habite « yo » et ses souvenirs. Là encore, la rencontre invite à la réflexion métatextuelle ; l´érotisme n’y est pas gratuit. Il alimente au contraire le travail de création, au sens propre lorsque les seins produisent du lait, au sens littéraire lorsqu´ils font naître le verbe poétique :
y el espíritu
Il est vrai que, depuis Quito, Paris est traditionnellement associée au vice et à la débauche, autre topique auquel les références sont ici nombreuses. Le fragment 5 évoque les propos de don Lucho, « el brujo de Santa Isabel de las Mercedes », sur la fuite de deux hommes du quartier après un fait divers sanglant : fidèles au topique, ils se seraient réfugiés à Paris, asile des déviances, dans le quartier homosexuel (28). Il se produit une profusion de références et de renvois qui participent d’un télescopage et d’un brouillage déréalisant des clichés et des mythes, lesquels donnent alors à voir « une image de la figure non décrite que forme l’ensemble du mythe de Paris » (29).
Car Paris, désormais mythologie personnelle, n’est ici jamais décrit. Signe en soi, Paris fonctionne en définitive comme le « Rosebud » du film Citizen Kane. La recherche de son sens est le véritable sujet de l’oeuvre, et la quête construit la narration. Les rencontres, si elles donnent des éclairages au lecteur, sont fragmentaires et ne lui permettent pas de saisir le sens dans sa globalité. Le mystère reste entier, Paris-« Rosebud » renvoyant à un mythe tout personnel, intime, que seul « yo », en dernier lieu, est à même de déchiffrer. Dans le fragment 8, un jeune homme annonce à ses amis qu’il part pour Paris, sans jamais y aller. Comme il a disparu, les habitants du quartier le croient bel et bien à Paris (30). Peu importe s´il s’y trouve physiquement ou non ; il porte Paris, son Paris, en lui.
Paris-« Rosebud » relève de la quête du sens de l’écriture. Dans le fragment 2, la voix poétique rencontre par hasard un des plus grands écrivains latino-américains, auteur du roman qu’elle est justement en train de lire. Elle lui demande pourquoi il a écrit cette phrase qu’elle vient de souligner :
Todavía no lo sé,
Paris est une mythologie personnelle, où des personnages de fiction peuvent s’autonomiser, prendre vie, converser, pour tenter, sans jamais vraiment y parvenir, de donner une clé de compréhension de soi comme artiste.
Paris existe-t-il vraiment dans Desde la capital de los MalGenioS ? Seul émerge véritablement un « yo » poète. En dehors de toute représentation conventionnelle, la métropole devient un terrain d’expérimentation privilégié pour trouver des formes novatrices, aptes à rendre compte de l’affirmation d’une conscience créatrice. Face à un Paris progressivement déréalisé, le dehors cède la place à l’expression du dedans. En d’autres termes et pour reprendre ceux de Stierle, Paris devient une « expérience de la subjectivité » (32) qui débouche sur un renouvellement formel.
Du poème en prose au « poema cuento » : chercher, c’est trouver
La quête, mouvement intérieur autant que spatial, est servie par la construction formelle des fragments, malléable et libérée de toute contrainte syntaxique ou métrique, à l’instar du corps du flâneur, en mouvement mais paradoxalement abandonné à lui-même. Le choix du poème en prose, associé au recueil Petits poèmes en prose de Baudelaire dont le titre fixe le terme, place d’emblée Desde la capital de los MalGenioS dans une tradition littéraire de la ville et de la flânerie, thèmes privilégiés du genre. Forme hybride, ni nouvelle, ni histoire brève, ni poème au sens traditionnel, le poème en prose se caractérise par son unité, ici celle du fragment, de l’impression, de la sensation, de la rencontre du moment. Il se distingue également, comme la flânerie, par sa gratuité. L’effet poétique prime, au détriment de la transmission d’une information, comme l’illustre le fragment 22 :
¿Un saltamontes en
Y no para impedir
Se trataba de una
Gesto simple
Le agradecí
Le poème en prose sert ici ce que Pierre Sansot appelle une « géographie sentimentale » (34) de la ville, laquelle est un ressenti et non un décrit. D’une part, le rythme de la ville ne surgit qu’avec la vitesse avec laquelle la parcourt la voix poétique, à pied ou en métro. Par sa souplesse, le poème en prose épouse ce rythme de la déambulation, nonchalant ; mais il rend aussi compte, par le découpage saccadé des mots sur l’espace de la page, des éventuelles ruptures qu’y introduit l’événement, survenu au hasard et forcément soudain. D’autre part, le flâneur déambule dans la ville « seul et incognito » (35), « yo » ne dévoilant jamais d’identité au-delà de sa propre conscience d’être dans Paris. La ville ne surgit qu’à travers ses sens. Les poèmes en prose y sont donc « profondément scopiques, au sens où c’est par le biais de son oeil » (36) que « yo » entre en contact avec la ville. Pour Cécile Kovacshazy, dans la flânerie, « c’est l’oeil qui est le lieu de rencontre du sujet avec l’autre […]. Le voir est un faire qui devient un écrire » (37). Simultanément, dans cette géographie sentimentale du ressenti, l’ouïe, en l’occurrence le chant du « saltamonte-cremallera », est constamment sollicitée, invitant à voir ce qui n’a pu être vu, la « moto negra » menaçante. Dans le fragment 72, c’est l’odorat qui fait surgir la figure d’une actrice. Elle vient de se changer et a laissé derrière elle, dans la loge, une forte odeur de sueur par laquelle, sans l’avoir jamais vue, « yo » décrit sa présence (38). Force est de le constater, cette appréhension sensuelle du « yo » poétique donne à l’ensemble sa cohérence.
Enfin, en tant qu’écriture de la flânerie, la poésie en prose de Telmo Herrera privilégie la quête plutôt que la trouvaille. Dans le fragment 74, le flâneur déambule dans le métro parisien. Progressivement, aux repères spatiaux, fixes, se substituent des silhouettes féminines, mouvantes. « Yo » en vient à errer de silhouette en silhouette, figures de la quête, dans un mouvement continu, car jamais il n’adresse la parole à ces femmes et ne met fin à la déambulation. « Yo » suit d’abord une blonde aux longs cheveux ondulés et monte dans une rame, quand une autre apparaît. Qui des deux regarder dans le huis-clos du métro ? Regarder l’une serait trahir l’autre. « Yo » s’en remet au hasard, acceptant de descendre seulement si une femme noire apparaît. Celle-ci survient, mais le problème se reproduit quand en surgit une autre ; et ainsi de suite :
Luego seguí a una
Les points de suspension sur lesquels se referme ou, plus exactement, reste ouvert le fragment disent la flânerie sans fin ni but. De fragment en fragment, s’opère un montage en mosaïque de petits mondes personnels qui se jouxtent sans s’interpénétrer, créant une géographie personnelle de la ville, où prévaut le mouvement comme une quête constante dont l’aboutissement n’est, paradoxalement, jamais recherché.
En d’autres termes, c’est cette quête qui est en soi trouvaille. Elle se dit métatextuellement sous les traits du fou à la recherche de sa liberté, dans le fragment 27. Ce fou, prisonnier de la statue de Rodin, qui a fait déjà fait le tour du monde 80 fois, s’adresse à « Yo » :
Rompe la estatua,
¿No puedes liberarte
Allá voy
Ce n’est pas la liberté qui importe mais la quête de la liberté, laquelle se cristallise dans un Paris devenu motif même de la recherche. Telmo Herrera crée, pour ce faire, le « poema cuento » que théorise le fragment 25. Ce dernier s’ouvre sur une interrogation, « ¿Cómo escribir un poema cuento? », à laquelle il s’efforce de répondre, montrant simultanément au lecteur comment il se construit en « poema cuento ». La flânerie, où marcher et penser vont de pair, en est le moteur :
Voy
La fragmentation de la phrase dans l’espace de la page isole, pour mieux les associer, « caminamos » et « inventando un cuento », le marcher et le créer. Le « poema cuento » est par essence péripatéticien. Il se présente également comme un work in progress, manifeste dans le détachement spatial, sur une seule et même ligne, de « a medida que ». Enfin, le « poema cuento » est aussi un « poema yo cuento ». « Voy » est mis en exergue, détaché en début de strophe, invitant à considérer le substantif « cuento » comme la conjugaison à la première personne du singulier du verbe « contar ». La voix poétique est donc avant tout une voix narratrice, qui raconte mais aussi qui se raconte. Elle suit en effet les pas d’un personnage qui le guide, si bien que mettre en scène le personnage, de façon réflexive, signifie nécessairement se mettre en scène soi-même.
Il n’est donc pas surprenant que le recueil se referme sur le départ du « yo », à la fois narré et narrant, dans le fragment 79. Notons que « yo » reste un flâneur ; la déambulation prend fin de façon abrupte comme elle a commencé, par hasard et sans raison :
A veces…
Y, sin embargo…
Y para qué, si al final
Mejor me voy. (42)
Nous l’avons compris, la poésie de Telmo Herrera rejette le principe d’illusion référentielle. Paris y est progressivement transformé en objet de visions personnelles. Les toponymes parisiens servent un « poema cuento », poème conte où je me raconte, forme hybride, apparentée au poème en prose, et qui, dans sa forme la plus épurée, peut déboucher sur l’haïku, alimentant le brouillage des genres.
A forte composante symbolique, l’haïku procède du vécu, du ressenti, de choses impalpables dont, par son extrême brièveté, il contribue à dire l’évanescence. Sorte d’instantané, sans exclure le cas échéant l’humour, il se présente bien comme une forme idoine pour le projet herrérien. C’est au haïku que le poète emprunte le travail spatial de mise en page du texte. Il crée ici une colonne textuelle, à l’instar de la calligraphie verticale du haïku. Il en conserve également le procédé par césure (le kireji) ainsi que la structure qui alterne court et long, certaines lignes étant composées de mots monosyllabiques ; d’où le rythme particulier de la poésie de Telmo Herrera. Et si les fragments sont parfois composés de plusieurs phrases, ils respectent l’esprit haïku qui ne doit pas décrire mais évoquer. Ce faisant, ils invitent le lecteur à se créer sa propre image, comme l’illustre le fragment 62 :
Luego
Nada más cruel. (43)
Le brouillage entre les genres narratifs et poétiques, manifeste dans la forme même de l’haïku, ni narration ni poème et pourtant à la fois narratif et poétique, participe du « poema cuento » où « yo » s’impose comme conscience créatrice. Dans un Paris déréalisé et érigé en mythe personnel, « yo » peut créer son « Museo imaginario ». Paris y devient atopie, car « yo » se trouve partout, à commencer dans son imaginaire, en se trouvant à Paris. Le fragment 57, de 6 pages, l’un des plus longs du recueil, est entièrement consacré à ce « Museo imaginario » :
“El arado con el cual
Bien sûr, l´expression même de Musée imaginaire renvoie à l´essai d´André Malraux, qui tente de penser une relation nouvelle à l´oeuvre d´art, délivrant cette dernière de sa fonction en tant qu´objet (45). Son apparition n´est pas ici gratuite, mais contribue à placer le recueil sous le signe de la quête du sens de l´art. Le Musée imaginaire incarne en soi une quête qui est déjà trouvaille et, par conséquent, porteuse de sens. A ce titre, il représente l´aboutissement de l´écriture-flânerie du « poema cuento ». « Yo », en effet, peut y convoquer toutes les oeuvres, toutes les rencontres et même les non-oeuvres et non-rencontres, à l´image des pas forcément perdus de la Gare Saint-Lazare, non-lieu par excellence et espace de tous les possibles. Le Musée imaginaire est ici un avatar de ce Paris atopique, mythe personnel herrérien, où le promeneur se transforme en créateur.
Conclusion
Dans Desde la capital de los MalGenioS, Paris se présente comme une ville-texte mythique, non seulement parce qu´elle assume les signes, topiques et clichés de la Ville Lumière et capitale des arts, mais aussi parce qu´elle relève de leur exact contraire, de la capital de los MalGenioS, de la ville « caca de perro » et de la ville des désillusions littéraires. Les multiples télescopages de ces références sont assumés par une écriture de la flânerie où le « yo » promeneur, à la fois personnage et narrateur, déconstruit les mythes et les représentations admises pour mieux reconstruire, par une appréhension sensitive et sensuelle de la ville, un espace mythique personnel dans lequel et par lequel il s´affirme comme voix créatrice. La flânerie sans but devient alors, paradoxalement, une quête, celle d´un Paris atopique densifié dans le mythe, et une trouvaille formelle, le « poema cuento ».
Dès lors, « yo » n’est plus un Equatorien à Paris, mais un Parisien équatorien. Par l’appropriation personnelle de la ville, il est désormais de Paris. Il assume d’ailleurs cette double appartenance, parisienne et équatorienne, dans le fragment 54, par le biais de la nostalgie des êtres aimés :
Lo mismo de siempre,
Ahora que estoy en
El resultado, de todos
Le terme nostalgie, du grec ancien νοστος nostos (« retour ») et ἀλγος algos (« douleur »), renvoie étymologiquement au mal du pays. Parce qu’il existe désormais pour « yo » un mal du pays qui est un mal de Paris, le poète équatorien est bien, aussi, un poète parisien.