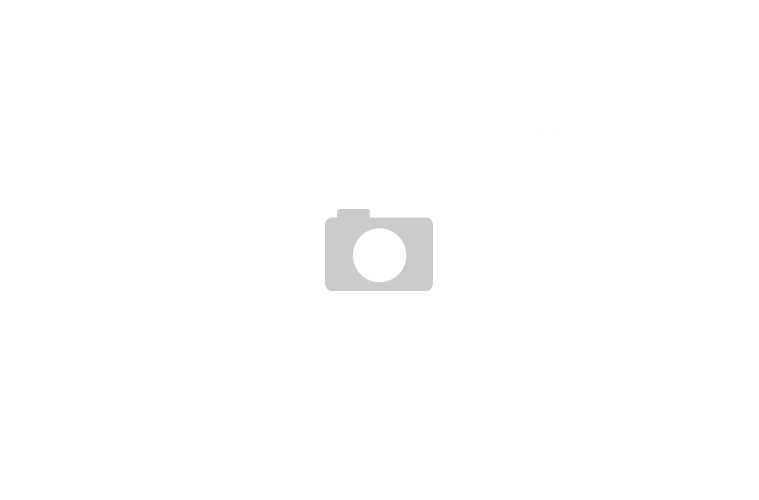Emmanuelle SINARDET
SOURCE :
Emmanuelle Sinardet, « Les figures paternelles dans A la Costa de Luis MARTINEZ (1904) : l’impossible construction de soi », in : Amadeo LOPEZ (éd.), L’image parentale dans la littérature de langue espagnole, Nanterre, GRELPP – Centre de Recherches Ibériques et Ibéroaméricaines, Université de Paris X-Nanterre, 2000, pp. 185-198
Les figures paternelles dans A la Costa de Luis MARTINEZ (1904) : l’impossible construction de soi
Le roman de l’auteur équatorien Luis Martínez, A la Costa1, paru en 1904, est considéré comme le premier roman véritablement équatorien, dégagé de l’imitation des modèles européens en vogue à l’époque. Les critiques insistent en l’occurrence sur la description d’une réalité proprement équatorienne, celle de la «Sierra» d’une part (qui correspond à la première partie du roman) et celle de la «Costa» d’autre part (la seconde partie), avec ses paysages, ses parlers et ses différents types «psychologiques» (selon les termes de l’auteur), de nette inspiration «costumbrista». Le voyage des Andes vers la Côte, qui donne son titre au roman, serait le prétexte littéraire à une incursion dans ces deux univers géographiques, sociaux et culturels que sont la «Sierra» et la «Costa», deux idiosyncrasies et deux facettes de la nation Equateur dont il s’agirait ici de dégager l’âme.
D’autres critiques, pour leur part, voient dans l’opposition systématique des caractères et paysages de la «Sierra» et de la «Costa» la démonstration idéologique de la supériorité du libéralisme sur le conservatisme, en cette période d’institutionnalisation de la Révolution Libérale de 1895. L’univers de la «Sierra», qui assume les valeurs du conservatisme ultramontain, incarnerait une société moribonde. Il se caractérise par la dégradation et la destruction. En revanche, la Côte, exaltation de la vitalité, symboliserait le dynamisme et l’optimisme d’une société libérale naissante, prospère et juste. Certes, Luis Martínez est député libéral de 1898 à 1899, puis ministre de l’Instruction Publique. Son engagement auprès d’Eloy Alfaro, le charismatique leader libéral, ne fait aucun doute. Cependant, la démonstration idéologique est loin d’être aussi systématique. En effet, l’univers de la «Sierra» / pôle de mort produit aussi des caractères sains et énergiques, comme Luciano, ami du héros Salvador Ramírez. De même, l’univers de la «Costa» / pôle de vie s’avère aussi porteur de dégradation et de mort que l’univers de Quito. Les maladies tropicales déciment la population ; beaucoup d’habitants y sont brutaux et assassins.
En d’autres termes, la construction symétrique autour de l’opposition des deux pôles vie / mort, «Costa» / «Sierra», ne peut être réduite à une idiosyncrasie régionale d’inspiration «costumbrista» ni à la démonstration pro-libérale. Nous nous proposons ici de considérer le jeu d’oppositions et d’échos entre ces deux pôles comme la manifestation d’un itinéraire intérieur autant que spatial, celui de la difficile construction de soi par l’exercice de la liberté. Car Salvador Ramírez, dans son voyage à la «Costa», cherche à se dégager du modèle imposé qui définit la fille comme double de la mère et le fils comme double du père. Bien que ni le narrateur omniscient ni les personnages ne semblent en avoir conscience, ce voyage est principalement un voyage initiatique par lequel le personnage prétend conquérir autonomie et énergie vitale, en adhérant – librement cette fois – à de nouvelles figures, situées du côté du pôle de vie.2
Dans un premier temps, nous nous attarderons sur les figures du père et de la mère et leur rôle dans la construction de l’identité de leurs deux enfants, Mariana et Salvador. Cette construction prédéfinie, imposée et aliénante, apparaît comme une nouvelle manifestation des ravages du pôle de la mort quiténien. Dans un second temps, nous analyserons les deux trajectoires, tentatives désespérées de gagner une autonomie après le décès du père qui, par l’absence, semble enfin rendre possible la libre construction d’une trajectoire propre. Si la première tentative, celle de Mariana, échoue, la seconde, celle de Salvador, semble être un succès. Emigré vers la Côte et après avoir surmonté difficultés et obstacles, il gagne un bonheur mérité. Cependant, comme nous le verrons dans un troisième temps, la rupture n’est qu’apparente. Soudain, le pôle de la
- Nous nous baserons sur l’édition de la collection Antares de Libresa : Luis A. MARTINEZ, A la Costa, Quito, Libresa, 1989 (1904), 240 p.
- Nous n’utiliserons pas les concepts freudiens Eros et Thanatos, quoiqu’ils recouvrent en partie le sens d’élan (de vie ou de mort) que nous donnons aux termes pôle de vie / pôle de mort. Freud parle de pulsions, ce que nous ne
mort, sous la forme d’une paralysie, rattrape Salvador qui disparaît avant même que ne naisse son enfant. Cette incursion de la mort dans la «Costa» / pôle de vie est l’incarnation d’une fatalité, celle d’une figure paternelle initiale omniprésente et de ce fait irrémédiablement aliénante. Elle signifie ici l’impossible conquête d’une identité propre.
1. La reproduction imposée de la figure parentale
Nous ne reviendrons pas sur les valeurs qu’assument les paysages dans les longues descriptions du roman.3 Précisons seulement qu’ils assument aussi les traits «psychologiques» des personnages et les amplifient. Dans le cas de Quito, univers stérile et moribond, les personnages sont minés par les vices (tous les péchés capitaux y sont déclinés) et la folie (les hommes sont hypocondriaques, les femmes hystériques). Surtout, ils semblent figés en ce sens qu’aucune évolution ne semble possible. Ils sont inexorablement appelés à être broyés et détruits, leur trajectoire-«destin» étant immanquablement la dégradation. Les parents du héros Salvador Ramírez sont les types mêmes de cette dégradation dont ils portent en eux, biologiquement autant que moralement, les germes. Le père est physiquement chétif. Moralement, il est certes droit, mais dépourvu de volonté, indécis, hésitant, triste, sans énergie, et de plus en plus solitaire, angoissé et hypocondriaque. Cette faiblesse explique d’ailleurs la progressive dégradation du statut social des Ramírez et la ruine totale qui s’en suit. Précisons que les personnages sont dépourvus de réelles nuances psychologiques : ils sont avant tout un type. Leur identité se réduit en définitive à l’appartenance à l’un des deux pôles mort / vie.
L’identité se lit donc autant dans les caractéristiques physiques que morales des personnages, les premières étant le reflet des secondes et pouvant même y être assimilées. Ainsi, parlant du Docteur Ramírez, le narrateur explique que la solitude, la pauvreté, la faiblesse de caractère ont œuvré «para llevarle sin esfuerzo a ese estado psicológico, o más bien fisiológico»4 de religiosité quasi fanatique qui caractérise l’ensemble de l’univers quiténien. De même, l’aspect physique de la mère, Camila, révèle ses traits «psychologiques» les plus secrets. C’est une «cuarterona». Sa bouche et ses formes généreuses révèlent une personnalité «mezcla informe de pasiones ardientes
pouvons faire ici dans la mesure où les personnages n’ont pas de réelle profondeur psychologique. Ils sont un type et surtout une trajectoire.
3 Pour plus de détails sur la construction de ces paysages, voir notre article : “A la Costa de Luis A. Martínez : ¿La defensa de un proyecto liberal para Ecuador ?”, Bulletin de l’IFEA, Quito, N°27, 1998, p. 285-307.
y de frialdades extrañas[1] ; de entusiasmos momentáneos y cálculos ruines»[2], tensions qui débouchent non seulement sur le fanatisme religieux mais aussi l’hystérie[3] (que le narrateur pose comme des «maladies» généralisables à l’ensemble de la gente féminine quiténienne).
Evidemment, ce couple miné par les «enfermedades nerviosas»[4], replié sur lui-même, obsédé par le respect de la norme sociale et religieuse, attaché sans transgression possible aux codes définis par le conservatisme idéologique, s’oppose à tout changement et rejette violemment ce qui vient de l’extérieur. Le temps n’est pas linéaire mais cyclique, répétition des mêmes événements. Logiquement, la reproduction du même s’applique aussi aux filiations. Il est intéressant de remarquer que le couple Ramírez a pour enfants un autre couple, Mariana et Salvador, comme si la procréation ne devait pas viser la multiplication et l’expansion, éventuellement introductrices de changement, mais uniquement la reproduction exacte de ce qui existe déjà. D’ailleurs, la relation frère / sœur n’est pas dénuée d’une série d’ambiguïtés qui peuvent laisser croire à l’existence d’un amour incestueux, comme si cette fratrie reproduisait le modèle parental jusqu’aux sentiments que les parents sont censés se porter.
Les enfants doivent reproduire, sans jamais les modifier, les normes qui leur sont transmises. Ces normes définissent leur identité, à savoir leur appartenance au pôle quiténien. L’éducation formelle et informelle est l’un des relais privilégiés de la transmission de l’héritage normatif. Elle se définit par une série d’interdits stricts, imposés sans aucune explication par les diverses figures parentales : les parents au sein de la famille, les «padres» de l’Eglise pour la société quiténienne et plus précisément les «padres» éducateurs (Jésuites et Sœurs du Sacré Cœur) à l’internat. La transmission des valeurs et normes, parce qu’elle passe par l’interdit, s’effectue exclusivement par la définition de limites, de barrières à ne jamais franchir. D’où la description récurrente de l’univers familial, et plus largement social quiténien, comme une prison. Les enfants sont isolés, «aprisionados física y moralmente»[5], et totalement passifs dans le processus éducatif.[6] Evidemment, dans ce monde clos qui vise sa reproduction à l’identique, l’éducation doit être la construction de doubles du père et de la mère, amenés à prendre la place de ces derniers. L’éducation conditionne l’enfant, passif, à reproduire la trajectoire du père : «[Salvador] seguía exactamente las huellas del padre»10. Salvador deviendra docteur en droit comme son père, après avoir étudié dans les mêmes institutions. Comme lui, il évitera le tabac et l’alcool, s’isolera, se détournera des femmes. Si le texte insiste sur les interdits, c’est pour signaler combien ils visent l’intégration de l’enfant au pôle de mort. Il s’agit bien de priver l’enfant de la jouissance et avec elle de ses élans vitaux. L’éducation normative fait de l’enfant un élément interchangeable : il existe seulement pour remplacer son père. Elle n’a pas pour but de le préparer à créer son propre espace mais à prendre une place déjà existante. L’identité de l’enfant, c’est celle de son père, la négation même de l’individualité. Autrement dit, la figure parentale le construit, sans possible exercice de la liberté. En ce sens, Salvador n’a pas d’identité propre.
L’éducation est loin d’être le seul facteur de production d’un double. Cette production est également physiologique, pour ne pas dire génétique. La nouvelle génération doit nécessairement incarner les figures parentales non seulement parce que telle est la volonté de ces différentes figures mais parce que telle est celle des gènes, de la loi naturelle. En quelque sorte, les enfants sont prisonniers d’un déterminisme biologique, peu surprenant chez le libéral Martínez influencé par les courants positivistes anglo-saxons. Toutefois, il ne faudrait pas réduire ce déterminisme à l’influence positiviste. Il joue bien ici un rôle primordial dans une démonstration qui s’érige en système. Ainsi le fils, amené à reproduire le père en tout point, hérite-t-il de la constitution physique et psychologique de ce dernier, en d’autres termes de son type. En ce sens, la figure parentale est source unique de l’identité et exclut toute liberté chez l’enfant.
Dans le cas de Mariana, la fille reproduit l’héritage de la «cuarterona», la bouche pulpeuse et les rondeurs sensuelles. Par conséquent, chez elle aussi luttent «dos principios contrapuestos y hostiles»11, triomphent momentanément la «fantasía» et les hallucinations, et alternent exaltation et apathie, traits indiscutables, dans le roman, de l’hystérie qui doit pousser Mariana, comme sa mère, vers le fanatisme religieux. Mariana est une nouvelle Camila. Elle porte dans ses gènes la
prédéfini. Les élans sont détruits, la volonté réduite à néant et les sentiments vidés de leur contenu. L’amour n’est qu’un mot creux et Quito représente le pôle de la mort parce que les modèles artificiels et vides qui président à la construction de l’identité tuent l’élan vital.
- Luis MARTÍNEZ, Cit., p. 51.
- Ibid., p. 47.
figure maternelle. Aussi ne peut-elle échapper à une «identité» définie comme la reproduction de la mère.
Elle tente bien de vivre l’idylle amorcée avec Luciano, l’ami de son frère, alors que sa mère le lui a formellement interdit. Elle se donne même à lui. Cependant, il ne faut pas voir dans cet élan une transgression de la norme, une rupture avec les modèles imposés et l’affirmation d’une volonté propre qui permettrait à une Mariana actrice la construction de soi et le passage vers le pôle de vie. L’acte d’amour est ramené à un acte sexuel. Il n’est rien d’autre que la réalisation des pulsions sensuelles de Mariana – la «cuarterona», l’obéissance à une nature héritée de sa mère. Cet épisode reste d’ailleurs sans suite, puisque Mariana rejoint le foyer familial. La passivité qui définit son appartenance au pôle Quito / mort ont raison de la révolte. L’épisode a pour seul effet d’accentuer les crises d’hystérie de la fille, l’assimilant davantage encore à la figure maternelle. La révolte, exercice de la liberté, étant vaine, aucune construction d’une identité propre – à travers celle d’un destin propre – ne s’avère possible.
Il en va de même pour Salvador qui ressemble à son père trait pour trait. Il est pâle, blond, délicat et même faible[7], «débil» étant le terme récurrent pour le caractériser comme il l’était déjà pour son père. Sa faiblesse physique révèle l’ampleur de sa faiblesse psychologique. La figure de Luciano souligne, par contraste, l’appartenance de Salvador au pôle de mort. Luciano, transgresseur des normes, jovial, optimiste, ami des plaisirs, incarne la vie, l’énergie, le triomphe de la volonté. Son aventure avec Mariana s’explique ainsi par le «deseo de saltar los obstáculos»[8] et de braver l’interdit des Ramírez qui définit chez Luciano l’appartenance au pôle de vie. L’amitié de Luciano et de Salvador peut paraître surprenante. Elle est en réalité un élément supplémentaire de la démonstration :
El uno rubio, blanco, débil como una señorita ; el otro moreno, robusto, gigante. Salvador pálido, preocupado, los ojos tristes y como acobardados de mirar de frente ; Luciano, sanguíneo, de grandes ojos pardos, de mirada firme y generosa. El uno representaba una raza mal configurada para la vida, que pronto sería eliminada ; el otro, la generación nueva, fecunda, incontrastable.[9]
La force de cet héritage physique / psychologique témoigne de l’impossible autonomie vis à vis de la figure paternelle. Malgré l’influence bénéfique de Luciano, Salvador reste le double de son père, privé de liberté, passif et de ce fait irrémédiablement situé du côté du pôle de mort.
D’ailleurs, lorsque son père lui interdit de revoir Luciano, Salvador, malgré sa peine et sa rage, se résigne et rompt avec son ami.
Un indice de cette identité passive, qui s’inscrit en creux telle une empreinte, est sans doute la sexualité mal définie de Salvador. Celui-ci prétend reproduire le schéma du couple hétérosexuel que les figures parentales lui imposent. Mais ce modèle, imprimé de l’extérieur, n’accompagne pas une évolution propre et lui reste étranger. Après un amour plus que fraternel avec sa sœur, reproduction dégradée du modèle parental, Salvador ressent pour Luciano de tendres sentiments (à tel point que le narrateur n’a de cesse de préciser combien ils sont innocents et purs, insistant ainsi sur l’ambiguïté de leur nature). D’ailleurs, Salvador est défini comme une «señorita». Il paraît privé de virilité. Ce vide est le pendant de l’absence d’une volonté et d’une énergie qui lui permettraient, si elles existaient, de se construire un destin et une identité propres.
2. Substitutions de la figure paternelle : conquête de l’autonomie et construction de soi
Dans cet univers clos physiquement et mentalement, un événement représente soudain une ouverture, une échappatoire possible pour Mariana et Salvador. Il s’agit de la mort du père. Il est intéressant de noter le vide que laisse cette disparition, lequel explique en partie le jeu de substitution de la figure paternelle qui s’opère par la suite. Ce vide n’est jamais compensé par la figure maternelle. Au contraire, la mère est la première à déserter le foyer, se consacrant davantage encore à ses activités religieuses. Elle renonce à son pouvoir normatif dans la transmission des interdits. En fait, la disparition du père signifie celle des normes qui régissent l’univers des Ramírez. La misère extrême qui frappe la famille après le décès du père témoigne sur le plan social de cette désagrégation. En définitive, c’est bien la figure paternelle seule qui préside à la construction de l’enfant, à la définition de ses repères et, par ricochet, de sa trajectoire.
La mort du père implique l’explosion des barrières et limites, offrant une ouverture que saisissent Mariana et Salvador pour tenter d’exercer leur liberté et de se découvrir une volonté susceptible de leur permettre l’accès au pôle de vie, indissociable de l’affirmation de soi. Il s’agit bien pour eux de se construire une identité propre, non plus en creux mais en relief. Toutefois, dans les deux cas, la tentative passe obligatoirement par le choix d’une nouvelle figure paternelle leur permettant de s’inscrire dans une nouvelle filiation. Autrement dit, la disparition de Ramírez ne signifie pas la disparition dans le roman de la figure paternelle et de ses fonctions. Au contraire, l’autonomie ne se gagne que par le choix libre et actif d’une nouvelle figure paternelle.
La première tentative, celle de Mariana, échoue. En effet, loin de rompre avec les modèles parentaux imposés, elle substitue à la figure paternelle initiale celle du père religieux, le «Padre» Justiniano. Celle-ci appartient encore au pôle de la mort et n’est qu’un avatar de la figure paternelle initiale. La trajectoire ne peut donc être modifiée. Violée par Justiniano, enceinte, acculée à la prostitution, Mariana est victime de l’inceste par lequel elle accélère sa destruction sociale, physique et morale. Et loin de ressentir uniquement de la honte, Mariana a plaisir à aimer ce père, «un poquillo de satisfacción o más bien de orgullo»[10], assouvissant ainsi un désir œdipien. Par la satisfaction de ce désir, elle réduit à néant la possibilité de se construire comme être autonome, tue l’élan de vie et reste irrémédiablement du côté du pôle de mort.
En revanche, la seconde tentative, celle de Salvador, passe par une rupture totale avec ce pôle. Il se choisit une trajectoire radicalement différente et devient acteur. Il émigre vers la Côte (rupture géographique) comme «peón» dans une hacienda (rupture professionnelle et sociale), puis opère la substitution de la figure initiale. Il désigne comme nouvelle figure paternelle celle de l’hacendado Velázquez, son employeur, beau, riche, sage, volontaire, représentation par excellence de la vitalité créatrice (choix symbolique du pôle de vie), qui favorise l’idylle avec Consuelo et le mariage (conquête de la virilité). Placé grâce à cette nouvelle figure paternelle – Salvador voit en Velázquez «un verdadero padre»[11] – sous le signe de la vitalité, il surmonte dans l’hacienda de cacao tous les obstacles. Son voyage vers la Côte devient ainsi une véritable initiation à la liberté et à la vie. D’ailleurs, choisir la Côte est déjà s’inscrire dans le pôle de vitalité qu’assume le paysage. Dans cette nature, «la vida, siempre la vida triun[fa] de la muerte»[12].
L’initiation passe par l’apprentissage de plusieurs vertus. Le conseil récurrent porte sur la patience : «Aquí, blanco, el único remedio es tener paciencia»[13]. Car les obstacles sont nombreux. Salvador doute en retrouvant dans l’hacienda une nouvelle «prisión sin esperanza de libertad»[14]. Mais cette «paciencia de Job»20 lui permet de se forger une volonté et une pugnacité qu’il ne se connaissait pas. Dans tous les cas, il est acteur. Cette transformation psychologique [15]s’accompagne d’une transformation physique, selon le système développé dans le roman. La «señorita» de Quito devient un homme fort et énergique.
Cette force nouvelle va de pair avec la conquête de la virilité. Les symboles phalliques abondent dans la narration de ces étapes initiatiques. Salvador tout d’abord apprend l’art du «machete»[16] grâce auquel il effectue le «desbosque»[17] de plusieurs hectares, dominant symboliquement une nature toujours définie au féminin. Simultanément, il fait la connaissance de Consuelo, fille de Roberto Gómez émigré comme lui de la «Sierra» en vue d’une vie meilleure. Celle-ci est dans un premier temps une «sœur», «une mère», un «ángel tutelar»[18] pour Salvador qu’elle soigne et qu’elle console dans les moments de découragement. Comme pour Luciano, lumière de vitalité, l’onomastique fait ici sens. Consuelo accompagne aussi le parcours du pôle de mort vers le pôle de vie. Au fur et à mesure qu’il s’approche de ce dernier et qu’il gagne en virilité, Salvador la considère comme une femme désirable. Elle est en quelque sorte l’indicateur de la conquête de la vitalité. Le projet de mariage naît ainsi après une nouvelle épreuve qui marque l’affirmation de la virilité. «Armado sólo de un palo»[19] éminemment phallique, Salvador vainc El Cortado, «peón» violent et «terror de la hacienda»25, avec un courage unanimement célébré dans la plantation. Enfin, la grossesse de Consuelo peu après le mariage assoit définitivement la conquête de la virilité.
La transformation radicale de Salvador à l’image de la nouvelle figure paternelle de Velázquez est le corollaire du libre choix d’une trajectoire assumée, garant de la conquête du pôle de vie :
Salvador, rejuvenecido moralmente, encontraba en él energías nunca sospechadas y una voluntad férrea para el trabajo. Se veía fuerte, enérgico, y confiaba en sus fuerzas.[20]
Le nouveau père reconnaît d’ailleurs cette transformation et récompense Salvador après chaque victoire par une promotion sociale. Il fait du peón un «tendero»[21], puis – après sa victoire sur El
Cortado – il le nomme administrateur de la plantation[22], c’est-à-dire son bras droit et symboliquement son fils. Salvador s’est construit ainsi une filiation placée sous le signe de la vitalité et fait désormais partie du pôle de vie, comme en rend compte la sensation d’accomplissement et de bonheur du jeune homme. La substitution d’une figure paternelle par une autre a pleinement fonctionné, et ce dans les deux sens : un fils s’est choisi un père qui a accepté de le reconnaître.
3. L’impossible conquête de la liberté ou la figure paternelle omnipotente
Au moment même où Salvador constate sa transformation et son intégration au pôle de vie, où «[comienza] recién a gozar de [la vida]»[23], un mal mystérieux et soudain le frappe. Ce mal provoque une progressive paralysie, métaphore de la dégradation de la force et de l’énergie, qui atteint d’abord les membres, les sens – «el tacto»[24] -, puis les fonctions vitales jusqu’aux poumons. Le roman se conclut sur la mort du héros après une douloureuse agonie. Le pôle de mort rejoint Salvador jusque sur la Côte, lui interdisant toute «jouissance» de la vie.
La mort de Salvador implique aussi celle du héros comme éventuelle figure paternelle. Car Salvador décède avant la naissance de son enfant. Plus encore, il s’efface comme éventuelle figure paternelle. En effet, il reçoit sur son lit de mort la visite de son ami Luciano qu’il charge de protéger Consuelo et son enfant à naître : «ésta es mi mujer, Luciano, abrázala»[25]. Cette phrase, quelque peu théâtrale, mérite d’être soulignée dans la mesure où elle rappelle les formules des rites du mariage. Salvador préside ici à un mariage symbolique par lequel il donne à Luciano non seulement sa femme, mais son enfant qui entrera dans une nouvelle filiation et se construira sous l’égide de la figure paternelle de Luciano. Ainsi l’enfant de Salvador naîtra-t-il du côté du pôle de vie.
Echapper au pôle imposé dans l’enfance par la figure paternelle s’avère impossible. Salvador n’est pas dupe et voit dans son destin tragique la marque d’une fatalité. D’ailleurs, à plusieurs reprises, la conclusion de la trajectoire, en l’occurrence la destruction totale, est annoncée. Salvador n’est-il pas le «[representante de] una raza mal configurada para la vida, que pronto sería eliminada»[26] ? En fait, la trajectoire de Salvador démontre que l’adhésion au pôle de vie est illusoire sans au préalable une rupture totale avec le pôle de mort. Et le roman invite à une relecture de la phase initiatique qui permet de comprendre les raisons de son échec.
Il s’avère que la substitution de la figure paternelle initiale, celle de Ramírez, n’est pas complète. Une fois socialement installé, Salvador reprend contact avec sa mère et avec Quito. Il lui fait parvenir de l’argent et assume ainsi le rôle du chef de famille qui lui incombait après la mort de son père mais qu’il avait refusé par son départ vers la Côte. En assumant pleinement ce rôle, il renoue aussi une filiation, celle du pôle de mort, et met en question la rupture totale qu’il avait projetée.
Enfin, le choix de Consuelo comme épouse témoigne des ambiguïtés de l’orientation vers le pôle de vie. Consuelo n’est pas la fille d’un Luciano ou d’un Velázquez mais d’un Roberto Gómez, double de Salvador, émigré de la «Sierra» vers la «Costa», faible et résigné, assassiné par El Cortado, figure pitoyable de l’échec. Par le mariage, Salvador reçoit une nouvelle figure paternelle, située du côté du pôle de mort. Il considère d’ailleurs Roberto Gómez comme un père dont il écoute les conseils. Certes, Salvador désigne Velázquez comme figure paternelle et idéal à atteindre. Mais il choisit parallèlement celle de Roberto Gómez, oscillant entre les deux pôles vie / mort. En d’autres termes, le choix du pôle de vie ne signifie pas ici le rejet total du pôle de mort.
La rupture totale avec un pôle et avec la figure paternelle qui lui est liée est une illusion, que Salvador semble saisir au moment même où il rend l’âme, comme en témoigne la dernière phrase du roman : «Los ojos vidriosos quedaron fijos en el Chimborazo que allá, en el confín del paisaje inmenso, resplandía (…)»[27]. Le volcan des Andes s’impose à la Côte, narguant en quelque sorte le pôle de vie et faisant mentir les descriptions du narrateur qui voyait dans les paysages côtiers la victoire de la vie. En définitive, l’élan de mort vainc l’élan de vie, niant toute liberté à l’individu.
Toutefois, à notre sens, il ne faudrait pas voir dans cet échec la défaite de l’élan de vie. En effet, Luciano, incarnation de la vitalité, s’impose comme figure victorieuse. Il faudrait y lire plutôt la critique des modalités choisies pour se construire, à savoir la substitution d’une figure paternelle par une autre. Ce qui perd Salvador, ce n’est pas une fatalité qui donnerait inévitablement la victoire au pôle de mort, mais la complète soumission à une figure paternelle, même lorsqu’elle est librement choisie. Il existe une véritable contradiction à vouloir gagner autonomie, volonté et liberté… par l’adoption d’une figure paternelle essentiellement normative, aussi «vitale» soitelle. Salvador ne se construit pas librement mais devient le double de Velázquez. Il croît échapper à l’aliénation et en choisit une nouvelle. Avec la trajectoire de Salvador, le roman démontre moins l’impossible existence de la liberté individuelle que le non-sens de la construction de soi sous l’égide d’une figure paternelle omnipotente.
Conclusion
Le roman, au-delà du «costumbrismo» et de la démonstration idéologique, est la narration d’une filiation tronquée. Avec Salvador disparaît aussi le dernier Ramírez. Salvador, en dépit de son nom, ne trouve aucun salut. Il le porte seulement lorsqu’il renonce à être père et figure paternelle, sauvant son enfant à naître en l’insérant dans une autre filiation, celle de Luciano, incarnation de la vitalité. Condamné à être un double de la figure paternelle, choisie ou imposée, Salvador est aussi condamné à ne jamais être lui-même. Cette mort finale est sans doute la conclusion logique d’un itinéraire qui confond choix et liberté. En ce sens, le roman peut être lu comme une parabole sur les ravages des fonctions normatives omnipotentes de la figure paternelle qui, par son pouvoir, rend illusoire toute conquête de l’autonomie. A la Costa est l’illustration de cette histoire juive que reprend à son compte David Cooper, dans Mort de la Famille, pour dénoncer la dictature de la figure parentale :
Un jeune homme tomba amoureux d’une belle princesse qui habitait une ville voisine. Il voulut l’épouser, mais elle y mit la condition qu’il lui rapportât le cœur de sa mère. Il rentra chez lui et, profitant du sommeil de sa mère, lui découpa le cœur. A moitié satisfait seulement, il courut à travers champs vers la princesse. A un moment donné, il trébucha et tomba. Le cœur s’échappa de sa poche et, comme le jeune homme était étendu là, le cœur lui dit : «T’es-tu fait mal, mon fils ? »[28]
Comme Salvador, le jeune homme prétend rompre totalement avec une figure aliénante, sans jamais y parvenir. Car la princesse n’est qu’un avatar de la figure maternelle, comme Roberto Gómez l’est aussi de la figure paternelle initiale. Dans les deux cas, les protagonistes choisissent une figure omnipotente et tout aussi aliénante que la figure initiale. Par conséquent, tous deux ne peuvent que trébucher, tomber et échouer.
[1] Luis MARTINEZ, Op. Cit., p. 43.
[2] Ibid., p. 42-43.
[3] Martínez reprend ici la conception soutenue par Charcot selon laquelle l’hystérie, c’est l’hérédité plus les agents provocateurs.
[4] Luis MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 43.
[5] Ibid., p. 46.
[6] Dans ce contexte, l’amour filial lui-même perd son sens dans la mesure où il est ramené à une norme qui le codifie. Chez ces enfants qui ne reçoivent ni tendresse ni affection, il doit exister parce qu’il est un devoir social et moral
[7] Ibid., p. 76.
[8] Ibid., p. 89.
[9] Ibid., p. 76.
[10] Ibid., p. 131.
[11] Ibid., p. 229.
[12] Ibid., p. 163.
[13] Ibid., p. 188.
[14] Ibid., p. 192.
[15] Ibid., p. 190.
[16] Ibid., p. 192.
[17] Idem.
[18] Ibid., p. 198.
[19] Ibid., p. 219. 25 Idem.
[20] Ibid., p. 229.
[21] Ibid., p. 217.
[22] Ibid., p. 226.
[23] Ibid., p. 236.
[24] Ibid., p. 231.
[25] Ibid., p. 239.
[26] Ibid., p. 76.
[27] Ibid., p. 240.
[28] David COOPER, Mort de la famille, Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 20-21.