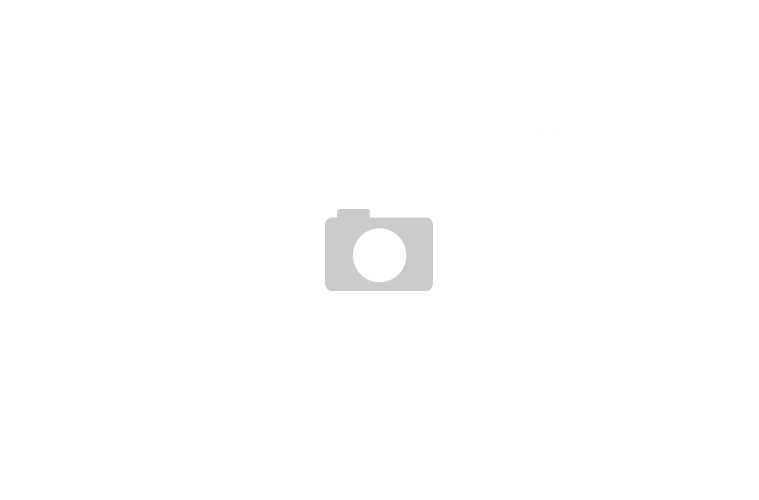Par Claude Lara
Nous avons présenté bien brièvement en une vingtaine de pages cette «œuvre franco-équatorienne». Maintenant, nous nous attachons à mieux faire connaitre cette dernière en reproduisant en français plusieurs de ses articles (C). Ici, en tant que responsable culturel à l’Ambassade de l’Équateur en France et, plus particulièrement à Paris de 1957 à 1983. Nous commencerons par cette publication d’Ambassade au nom si évocateur «l’Équateur vous attend…».
Voici donc, chers lecteurs, les premiers articles que nous transcrivons:
NOTES:
TRADUCTION DU POÈME «ÉLOGE DE L’ÉQUATEUR» DE JORGE CARRERA ANDRADE
Équateur, mon pays, émeraude du monde
enchâssée dans la bague équinoxiale,
tu consacres l’alliance de la terre et de l’homme,
l’union tellurique avec l’épouse profonde
– oh! ses seins de volcans, son corps de céréales –
l’épouse tous les jours endimanchés
sous le soleil laboureur, père des semences.
Je veux couvrir de baisers ton corps vert, tes cheveux de forêt,
ton ventre de maïs, ta chair de canne à sucre,
Et sur ton sein fleuri laisser dormir ma tempe.
de l’arbre généreux, de l’arbre guérisseur,
des oiseaux parleurs plus colorés que des fruits,
nouvelle zoologie d’un monde fabuleux,
et l’histoire d’un peuple
qui gémit jusque dans ses danses, lançant vers les nuages ses espoirs,
en bouquet d’artifice,
traînée de feu qui s’évanouit en larmes bleues.
C’est toi qui m’as fait aimer l’univers,
accepter mon destin d’habitant planétaire,
berger de vigognes fantomatiques
errant par des cités étranges dans lesquelles
nul ne vient au secours de l’étoile blessée
qui se noie dans la mare.
et solidaire de tout ce qui vit,
humble comme le vase empli d’ombre fertile.
Je suis aride, abrupt comme la Cordillère,
Profond comme une grotte aux trésors incasiques.
Dans mon être sommeille un lac sur un cratère.
Mon front est un plateau désolé sous la pluie,
mon cœur un cactus altéré
qui demande une aumône de rosée.
je viens danser sur ton sol vert,
danser jusqu’à la mort,
écouter battre ton vieux cœur
de terre sèche et de piment.
Je frappe de la main la harpe séculaire,
éveillant la musique en son cercueil de poussière
et le dieu ancien du tonnerre.
Donne-moi ta bienvenue de rosée,
embrasse-moi de tes bras verts,
oh, mère couronnée de glace et colibris!
Montre-moi le chemin de la mine perdue
qui garde les métaux profonds de l’origine.
Donne-moi tes plantes magiques,
donne tes baumes prodigieux,
le talisman de pierre mémorable
où le soleil grava
ses signes protecteurs.
– CUENCA ET SON POETE NATIONAL REMIGIO CRESPO TORAL*
Cuenca a été le berceau des hommes les plus remarquables qui ont contribué au prestige de l’Equateur. C’est pourquoi le Bulletin a le plaisir de présenter un article, certainement très peu connu, que Don Gonzalo Zaldumbide, Ambassadeur de l’Equateur et grand maître de la prose espagnole, dédia (dans la «Revue de l’Amérique Latine», Paris, 1925) à l’un des fils les plus remarquables de Cuenca: Remigio Crespo Toral, très connu en tant que poète, car il fut couronné de son vivant comme le poète de la nation. Mais, Crespo Toral était aussi, et l’on serait tenté de dire qu’il était surtout un grand écrivain, tant sa prose est pure et vigoureuse, ses idées nettes, son tour d’esprit d’une exquise élégance. Historien, critique et essayiste aux vastes perspectives, humaniste profond, sa poésie est nourri d’érudition et rien ne lui était étranger; ignoré dans son asile, sa ville natale, la docte et souriante Cuenca.
Cuenca (130.000 habitants) est la capitale de la province de l’Azuay.
REMIGIO CRESPO TORAL, POETE NATIONAL
Gonzalo ZALDUMBIDE
* A. Darío Lara, Ambassade de l’Équateur en France. Publication de l’Ambassade N°9: novembre-décembre 1969; pp. 4-5 et 7. Cet article est illustré par les photos Ortiz de: Remigio Crespo Toral, Gonzalo Zaldumbide, Palais de la Municipalité de Cuenca, sa cité universitaire, du Parc Calderón, sa nouvelle cathédrale, ainsi que de la colline de Turi et du Lac de Gurocucho, situés près de Cuenca.
– LE VRAI VISAGE DE L’EQUATEUR… *
… Quito, assise sur le plateau des Andes, entre les deux cratères du volcan de Pichincha, cette ville domine les cours d’eau et les grands bassins des deux versants qui descendent dans le Pacifique et dans l’Atlantique. Si cette région centrale de l’Equateur était plus peuplée, si l’on savait en développer les ressources de tout genre, Quito pourrait devenir la souveraine de l’Amérique méridionale…
Quito néanmoins a des attraits naturels qui en rendent le séjour digne d’envie, un air pur, un site admirable, une température douce et agréablement rafraîchie par la brise des montagnes, une abondance et une variété de vivres extraordinaires…
Enfin et surtout, l’aménité des habitants, leur humeur bienveillante et hospitalière…
En somme, Quito serait peut-être l’une des villes les plus charmantes… La population quiténienne est un sujet d’étude intéressant. La noblesse des types, la variété des costumes, le bon goût inné qui, jusque dans les classes inférieures, préside à la coupe des vêtements et à l’arrangement des couleurs, forment un ensemble pittoresque et harmonieux à la fois; nulle part, même chez les races les mieux douées, je n’ai trouvé à un égal degré le sentiment artistique».
* A. Darío Lara, Ambassade de l’Équateur en France. Publication de l’Ambassade N° 12: juin-juillet-août 1970; pp. 4-5 et 8. Cet article est illustré par des photos de:
– Le Cotopaxi, éternellement enneigé, domine la Cordillère des Andes.
– Quito, l’arc de Carondelet, la place de l’Indépendance et le Palais du gouvernement.
– Ici passe la ligne équatoriale, au fond la cime du Pichincha.
– Le lac Cuicocha, près de Quito, au fond le mont Imbabura.
– A Guayaquil le monument érigé à la gloire de Simón Bolívar et de San Martín.
– La Compagnie de Jésus, vue depuis le couvent de San Francisco. – Les apôtres par un artiste inconnu dans l’église Asunción del Carmen.
– ALFREDO GANGOTENA, POETE EQUATORIEN ET FRANҪAIS*
– Portrait d’Alfredo Gangotena par Coloma Silva, 1943.
– Jean Cocteau avec cette annotation: «… Gangotena vous avez du génie. C’est quelque fois dommage, toujours merveilleux. Ne dites à personne votre projet de gloire. Je m’en charge…».
(A) Carlos Tobar Zaldumbide a été un grand ambassadeur et sa mission diplomatique en France a été très remarquée. Pour cela il nous a paru très intéressant de transcrire ce document inédit, les Lettres de Créance qu’il a remises en main propre au Président de la République française, le Général de Gaulle, le 21 décembre 1963, lequel a du être particulièrement sensible à ces paroles:
«Monsieur le Président,
C’est un singulier privilège que de remettre à Votre Excellence les Lettres de Créance qui m’accréditent auprès d’Elle en qualité d’Ambassadeur de l’Equateur.
Des circonstances heureuses confèrent à cet acte une signification qui m’est particulièrement chère: c’est en qualité de Sous-Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères de mon pays, en 1944, que j’ai eu l’honneur d’intervenir dans la reconnaissance du Gouvernement Provisoire présidé par Votre Excellence qui, alors que l’Europe se débattait encore dans l’incertitude et l’angoisse, faisait face à la tâche historique et exaltante de lutter pour l’honneur et la gloire de la France. Si je me suis permis de rappeler ces faits, c’est bien parce que l’Equateur a été le premier pays d’Amérique Latine, et certainement l’un des premiers du monde, qui a adopté cette attitude, dont le souvenir nous est cher.
Maintenant que la France, guidée par Votre Excellence, a assumé la place directrice qui lui est due dans le monde, le moment est sans doute arrivé où les pays d’Amérique Latine, et particulièrement ma Patrie, traditionnellement unie à la Votre par une culture commune et des idées analogues sur la primauté du Droit, la Liberté et le respect de la personne humaine, s’efforcent d’atteindre une coopération croissante de plus en plus efficace, fondée sur les principes auxquels la France et l’Equateur ont toujours été fidèles: l’égalité juridique des Etats et le respect de leur indépendance nationale.
Telle est, Monsieur le Président, la conviction du peuple et du Gouvernement de l’Equateur. C’est dans cet esprit qu’il m’est donné d’initier la mission dont j’ai été chargée auprès de Votre Excellence. Je suis convaincu que ma décision de travailler en vue de resserrer les liens qui unissent l’Equateur et la France dans tous les domaines, et très particulièrement dans ceux de la coopération technique et économique, trouvera la généreuse compréhension du Gouvernement de Votre Excellence.
(B) Nous reproduisons en annexe ce très beau témoignage et de grande valeur, puisque M. Carlos Tobar Zaldumbide nous signale: «… et j’eus moi-même le privilège de me compter parmi ses amis».
CHANT D’AGONIE * A Julien Lanoë
Les mille tonnerres où frémit la Terre
L’ouragan, autour des flammes dans l’éblouissement
de sa colère,
Et dans l’espace s’écriant :
O nuit je m’en souviens:
Jadis, au clair des astres, j’ai bien connu
Son corps de grâces et de beauté,
Son corps lesté d’amour, au bord des flammes,
m’étreignant dans ma fluide éternité».
A Pierre-André May
Ores qu’une force étrange me fait claquer des dents,
Qu’un sifflement océanique de trombe me brise les yeux:
Dans mon âme vente l’écho d’une voix profonde.
Solitudes d’un monde abstrait,
Solitudes à travers l’espace mélodique des cieux,
Solitudes, je vous pressens.
L’esprit d’aventure, de géométrie,
En avalanche me saisit,
Et ne suis-je peut-être que l’acrobate
Sur les géodésiques, les méridiens!
Mais comme toi jadis, petit Blaise,
A la renverse sous les chaises,
En grand fracas, je ronge les traversins.
O nuptiale saison de l’épousée!
La pentecôte des feuilles d’automne enlumine les carreaux,
Souvenir! O patiente et douce mémoire vivifiant ses eaux.
Dans l’amoureuse et chaude enceinte des rideaux.
O battement vertigineux
De ces ailes sous les tempes,
Ombre interne de mes mains!
Route solaire de la ma puissance.
Et route du pain: l’épi violent.
Les prunelles avides de l’écolier se consument à l’ombre des greniers;
Les gouttières sèment leurs glaïeuls de cristal,
Et toute la grange succombe à la grâce de Dieu.
Brisez-vous, portes: le jour qui vient de naître
Flambe en la feuille limpide de la fenêtre.
La lune déjà s’éteint aux brises du monde:
Hâte-toi,
O mon âme et réveille, dans l’octave de ton chant,
Le florilège de la prairie!
Comme ils boivent, au fil de l’ombre, les versants et les vallées,
Comme ils s’abreuvent de ces lymphes jaillissant à même l’entraille métallique du roc:
Je me désaltère à la gourde du ventriloque.
Ah! même sous la menace des signes sidéraux,
Fuis donc, ami -enjambe les monts et les ténèbres-
Même au risque de périr
Dans la braise foudroyante des vitraux!
Ecoute! entends comme grince au loin le carrefour:
Genèse de ton souffle,
Clavier du voyageur.
[…]
Annexe: Le poète GANGOTENA
Trait d’Union Inconnu de l’amitié Franco-Equatorienne
M. Carlos TOBAR ZALDUMBIDE
Ambassadeur de l’Equateur
Au printemps dernier, le Comité France-Amérique, sous la présidence de M. Edmond Giscard d’Estaing, Membre de l’Institut, organisa, conformément à la tradition de ses réceptions diplomatiques, un diner en l’honneur de S. Exc. l’Ambassadeur de l’Equateur et de Mme Tobar Zaldumbide, M. Jacques Chastenet, de l’Académie Française, Président-adjoint de France-Amérique, qui accomplit au cours des récentes dernières années, un voyage en Equateur dont il conserve un chaleureux souvenir lui exprima la bienvenue du Comité. Nous reproduisons ci-dessous la réponse S. Exc. l’Ambassadeur Carlos Tobar Zaldumbide, une belle et charmante page d’histoire, de littérature et d’amitié franco-équatorienne.
«Gangotena, vous avez du génie. C’est quelques fois dommage – toujours merveilleux. Ne dites à personne notre projet de gloire. Je m’en charge. Venez vite avec le reste. J’ai déjà prévenu Rivière que je lui préparais une surprise. Votre Jean COCTEAU »
«Mon cher Gangotena; On compose votre livre… Je suis heureux d’être le parrain – et mérite une dédicace sur un des poèmes – ce qui ferait beaucoup plaisir à votre vieil admirateur. Jean COCTEAU »
«Cher Gangotena; Heureux comme tout avec votre offre de poèmes. Je parlais de prose par timidité. Votre «Orogénie» est une coupe du ciel. Ne m’oubliez pas. Sans l’amitié de poètes comme vous, je respire mal… Inutile de vous dire mon émotion en voyant votre dédicace au «Roseau d’Or». Vous savez comme je vous admire et que, malgré nos rares rencontres, je vous aime beaucoup. Votre très fidèle Jean COCTEAU».
«Cher poète, très cher: échangeons donc les souhaits selon l’usage à cette époque et l’amitié toute l’année. L’amitié j’y compte, sur les lettres, je compte peu car vous ne me gâtez pas. Je suis plein d’indulgence, une indulgence admirative! car les nombreux, si contradictoires travaux où je vous vois en proie me laissant pantois. On ne lit que de vos vers et vous ne laissez pas le temps d’exprimer une admiration que vous ne l’exhaussiez par quelque autre merveille. Vos vers sont royaux, loyaux, joyaux! Vastes, astres, pilastres et Zoroastre, fastes, chastes, aristocrates, acrobates, Goliath, amphithéâtre et opiniâtres. Je ne me lasserai de le dire : vous êtes le… non! soyons prudent. Un des seuls qui… soyons encore prudent… La préface (de votre livre) appartient à Supervielle qui est votre inventeur français. Elle appartient plutôt encore à quelqu’un de votre génération: une génération doit désigner elle-même dans son sein celui qu’elle élit comme «maître de préface». Une génération doit se suffire. Pour votre génération vous avez l’admirable aristocrate qu’est Jouhandeau. D’ailleurs si vous saviez combien ma voix porte peu, est peu écoutée, peu entendue. Je suis littéralement écrasé par les écraseurs. Il est vrai que c’est ainsi depuis 25 ans!… Je vous félicite de tous vos succès, je vous serre la main, vous couronne et vous embrasse à la face de Dieu. Max JACOB. »
«Votre livre «Absence» me fait l’effet d’un son de grosse cloche, et j’en écoute le son avec plaisir. Il dit: C’en est fini des amusettes artistiques, des petits pittoresques». Une époque tragique veut une poésie tragique, une époque déchirante des poètes déchirés. Et voici que de vos Amériques nous arrive votre voix de métal, votre verbe ferme et odorant et votre cœur chargé d’un mal atroce, le mal du pays, mal qui nous a donné le grand poète Ovide et d’autres exilés. Cette voix nous arrive chaude encore des Equateurs, désolée comme les 6530 mètres du Chimborazo et rouge de douleur comme ses pierres cuites par les soleils implacables. Bravo pour ce livre fondamental qui ne quittera plus ma vie. Max JACOB.»
Carlos Tobar Zaldumbide.
«France – Amérique » (magazine)
REVUE DES NATIONS AMERICAINES
3ème trimestre 1964
– DEUX SOMMETS DES LETTRES HISPANO-AMERICAINES ET GRANDS ADMIRATEURS DE LA FRANCE: JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO ET JUAN MONTALVO*
José Joaquín Olmedo, le chantre de Bolívar, le poète de l’émancipation hispano-américaine, qui introduisit Bolívar -vivant encore- dans une espèce de légende homérique. Olmedo fut l’Ambassadeur de Bolívar à Paris et Londres. «Don Juan Montalvo», apôtre de la liberté et de la dignité de l’homme, «le Cervantes hispano-américain», fit de Paris le centre de son activité littéraire et dans cette ville décéda (1889), au numéro 26 de la rue Cardinet. A la place de l’Amérique Latine (Champerret) s’élève son buste, à côté des plus grands écrivains: Rubén Darío, Martí, Rodó, Bello, entourant le «Libertador»: Simón Bolívar.
JUAN MONTALVO
Víctor Manuel Rendón
Ancien Ministre de l’Equateur en France.
LA VICTOIRE DE JUNIN-Hymne à Bolívar.
Avec un bruit terrible et sourd qui continue
Par les airs embrasés, il annonce en tous lieux
Qu’il est un Dieu puissant, maître absolu des cieux.
Et la foudre dans Junin frappe et disperse
Les Espagnols dont la multitude perverse
Menaçait, plus féroce encore que jamais,
Par le fer et le feu d’asservir désormais
Tous les peuples vaincus; et le chant de victoire
Dont porte au loin l’écho l’impérissable gloire,
Sa voix assourdissant de ses cris répétés
Les hauts sommets abrupts, la plaine et les cités,
Proclament à leur tour Bolivar sur la terre
Arbitre de la paix, arbitre de la guerre.
Hardiment jusqu’au ciel, vrais temples qu’il pensait
Destinés à parler aux peuples d’âge en âge,
Car des serfs y gravaient dans un pompeux langage
L’éloge des tyrans, ces pyramides-là
Ne sont que des hochets du temps qui les frôla
Légèrement de l’aile et les coucha par terre,
Quand le vent, dont le jeu facile les altère,
Eût effacé déjà les mots menteurs inscrits.
Confondus, oubliés, gisent sous les débris
Le prêtre avec l’autel, les dieux avec le temple,
De folle ambition et de misère exemple! ».
Cet article est illustré par des photos de:
– Monument érigé à Quito, à la gloire de Simón Bolívar «El Libertador».
– Don Juan Montalvo, apôtre de la liberté (portrait).