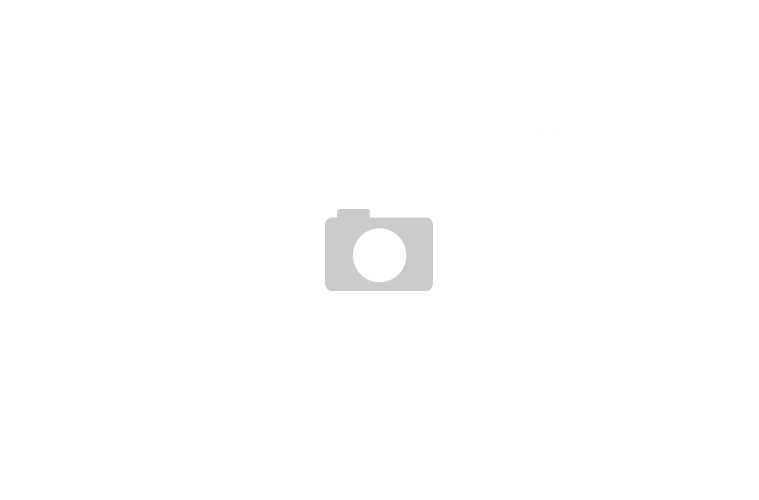Références:
Emmanuelle Sinardet, «La satire, arme contre la barbarie équatorienne : Las Catilinarias de Juan Montalvo», in: Françoise Aubès, Florence Olivier (ed.), América. La satire en Amérique latine, formes et fonctions. Volume 1: La satire entre deux siècles, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008, pp. 321-332.
Las Catilinarias, rédigées et publiées entre 1880 et 1882 par l’Equatorien Juan Montalvo (Ambato, 1832 – Paris, 1890), alors exilé au Panama, semblent se présenter avant tout comme un long pamphlet contre la dictature du général Ignacio Veintemilla, auteur du coup d’état de 1876 puis élu à présidence en 1878 par une Constituante fantoche, réunie pour légitimer a posteriori le putsch. Il est vrai que le ton est combatif, l’attaque virulente. De nombreux passages relèvent de la diatribe. Unamuno, dans son prologue à l’édition parisienne de 1925, ne s’y trompe pas. Il souligne la multiplication des «insultos tajantes y sangrantes» (1) qui font mouche. Et s’il émet des réserves sur le style précieux, bourré de références érudites, au «cervantismo no poco pueril» (2), il reconnaît l’indignation de l’homme de bien injustement proscrit, auquel il s’identifie alors qu’il se trouve lui-même en exil à Paris :
Fue la indignación lo que hizo de lo que no habría sido más que un literato con la manía del cervantismo literario, un apóstol, un profeta encendido en quijotismo poético ; es la indignación lo que salva la retórica de Montalvo (3).
L’indignation, l’engagement politique, le recours systématique à l’invective, Montalvo lui-même les revendique en baptisant catilinaires ses douze essais. Il s’inscrit non seulement dans la filiation du Cicéron patriote foudroyant un Catilina fourbe, comploteur et traître à Rome, mais aussi dans celle du juste Cicéron appelant à décréter la mort du criminel, qu’il présente comme un monstre. En effet, tout en poursuivant son ambition de sauvegarder la pureté de la langue castillane, de récupérer des tournures et un lexique classiques qu’il estime malmenés en Equateur, Montalvo, libéral radical convaincu, se pose en polémiste vengeur. Transformer le cours de l’histoire équatorienne en exhortant ses compatriotes à agir et à renverser Veintemilla, telle est sa mission.
Il estime avoir déjà atteint cet objectif s’agissant du président conservateur ultramontain García Moreno. Dans La dictadura perpetua, son pamphlet acerbe de 1874, censuré en Equateur et également publié au Panama, Montalvo appelait la jeunesse équatorienne à se sacrifier et, à l’instar de ces héros de la Rome classique qu’il se plait à célébrer, à exécuter celui qu’il nomme le «tirano» (4). Lorsque Garcia Moreno est effectivement assassiné, en 1875, Montalvo aurait déclaré, avec (et en raison de) cette arrogance qui lui a souvent été reprochée: «Mi pluma lo ha matado» (5).
Pourtant, Las Catilinarias diffèrent des pamphlets rédigés contre García Moreno. Il s’agit là, à notre sens, d’une œuvre originale, jugée injustement mineure, de laquelle se dégage une tonalité sombre, désespérée, mais où, malgré tout, le lecteur rit. Rappelons que, lorsqu’il rédige la dernière de ses douze catilinaires, Montalvo, déjà âgé de soixante ans, organise son départ pour Paris, vers un exil qu’il pressent définitif. Amer, sans illusions, torturé par un profond sentiment d’injustice, il laisse derrière lui un Equateur selon lui voué au chaos. Car si García Moreno était un «tirano», roué mais cultivé, Veintemilla en revanche ne serait qu’un «tiranuelo» (6). C’est justement cet «excremento de García Moreno» (7) qu’il livre au comique grinçant, où le ridicule se marie au grotesque et à l’ordurier. Loin de s’en tenir à la diatribe, Las Catilinarias semblent aussi relever de la satire.
Cette étude tentera ainsi de comprendre en quoi consiste le mode satirique à l’œuvre, par l’analyse des modalités de communication propres à la satire et de leur visée normative. Elle s’efforcera de mettre en lumière la norme sous-jacente, notamment par l’approche de la construction protéiforme et capricante ainsi qu’en observant le rôle du ridicule, pour cerner la formidable rhétorique de démolition au service de la dénonciation. Dans cette perspective, il s’agira de montrer dans quelle mesure Juan Montalvo se présente comme l’héritier de Juvénal (8), pour qui «le rire sarcastique va de pair avec la véhémence de l’accusation» (9).
1. – Las Catilinarias au-delà du pamphlet: la visée morale derrière des cibles foisonnantes
Las Catilinarias relèvent d’un mode pouvant être analysé comme un processus communicationnel qui, face au lecteur destinataire, met en place deux actants propres à la satire: la cible et le satiriste. Montalvo s’attaque ici à une apparente multiplicité de cibles: à Ignacio Veintemilla en premier chef, qui sert de «rufián a Lucifer» (10); à García Moreno, le dictateur assassiné en 1875, accusé, entre autres, d’avoir livré le pays à l’obscurantisme clérical et au fanatisme religieux; au président renversé en 1876, Antonio Borrero, un libéral catholique et modéré en qui Montalvo avait d’abord déposé ses espoirs de réformes, mais ici qualifié de «madre Celestina que tanto sabe de filtros y bebedizos» (11) parce que sa mollesse aurait jeté la nation insatisfaite dans les bras d’un Veintemilla démagogue; à Manuel Gómez de la Torre, ministre de Borrero, incapable, imbécile, fourbe, ennemi personnel de Montalvo; au général José María Urbina, qui a appuyé le putsch de Veintemilla, traître à la patrie et aux rincipes libéraux, dont le visage porterait «quince años de desgracia depravada y perversa» (12).
Toutefois, la cible ne saurait se limiter aux dictateurs ou à leurs complices ni, à travers eux, à la tyrannie, même si celle-ci se trouve au cœur du propos. A leurs côtés apparaît une foule grouillante de personnages secondaires, des subalternes qui partagent et déclinent, à tous les degrés possibles, les travers des puissants : les députés, maires et ministres tant conservateurs que libéraux modérés, les universitaires pompeux, les étudiants soumis, les ecclésiastiques hypocrites, les béates fanatisées, les soldats ignares, les fonctionnaires arrivistes, les cholos et chagras vulgaires, les indiens abrutis, les noirs alcoolisés. La liste ne saurait être exhaustive, tant les portraits se multiplient. Cette galerie de personnages permet de mettre en scène des institutions dévoyées (la justice, la constituante, le parlement par exemple) ou des travers sociaux (le pédantisme, le snobisme ou l’ambition démesurée). Cependant, tous puisent à une seule et même source: le vice, à l’origine du chaos qui frappe le pays.
Las Catilinarias s’attachent à traquer et révéler le vice, un «vicio disfrazado de virtud» (13). Elles s’attaquent à la dissimulation et à l’imposture pour «creuser l’écart entre apparence et réalité» (14). Elles poursuivent bien cette visée morale propre à la satire. En témoignent les termes relevant de la morale – «moral» étant lui-même récurrent – qui, répétés, déclinés, associés, scandent véritablement le texte et le construisent en un jeu d’oppositions systématiques. D’un côté, «engaño», «crimen», «robo», «vicio», «males», «maldad», «malicia», «hipocresía», «mentira», «codicia», «bajeza», «cobardía», «ambición», «soberbia», «avaricia», «lujuria», «ira», «cólera», «gula», «envidia», «pereza», «pasión ciega», «depravación», «odios», «celos», «venganza», «ignorancia», «perversión», etc. Ils sont associés aux «tinieblas» et à la «irracionalidad». Ils s’opposent à «deber a la patria», «inteligencia», «sabiduría », «verdad», «virtud», «honestidad», «honradez», «instrucción», «saber», «conocimiento», «dignidad», «sagacidad», «valor», «mérito», «generosidad», «justicia», «probidad», «juicio», associés à la «luz» et à la raison.
La présentation du vice sous tous ses angles possibles est permise par la construction capricante et protéiforme du texte. Les douze catilinaires semblent en effet disjointes, et pourraient d’ailleurs être inversées sans que leur sens n’en soit altéré. Chaque essai se présente lui-même comme un enchaînement de séquences a priori disjointes, de longueur variable et aux formes multiples: souvenirs, témoignages, expériences du satiriste, anecdotes rapportées, paraboles, légendes, lettres retranscrites, proverbes, poèmes, chansons, outre les exposés, les monologues ou les dialogues des personnages mis en scène dans une grande variété de lieux et cadres. Il est fort difficile de dégager une structure cohérente tant l’auteur procède par détours, ramifications, bifurcations, mais aussi par accumulations et compilations qui érigent la digression, la digression de la digression, la digression de la digression de la digression et ainsi de suite, en mode de construction.
L’auteur revendique cette spirale vertigineuse, intitulant par exemple une séquence «Digresión» ou «Página para un proceso, a modo de nota» dans sa sixième catilinaire. Il procède là de l’esthétique de la satura romaine, «farcissure et diversité» (15). Le texte prolifère pour fouiller les aspects plus variés de la vie des personnages-cibles, construisant un prodigieux catalogue des vices, lequel constitue en réalité le véritable sujet de Las Catilinarias.
Evidemment, cette construction, tout comme le jeu entre ténèbres et lumières qui la sous-tend, participe de la peinture d’un monde dégénéré, déchu par la prolifération du vice, où règnent la confusion et la dégradation. Il rappelle «l’imagerie démonique» (16) définie par Frye. L’Equateur de Veintemilla se présente comme un lieu de souffrance, de folie, de violence déchaînée, de chaos absurde, condamné à une déchéance irrémédiable. Las Catilinarias relèvent ainsi d’une «visión maléfica» (17), à l’instar des satires de Juvénal.
Face au vice généralisé, Montalvo se présente comme un personnage qui en prend le contre-pied et se place d’emblée du côté de la raison et de la morale. Le «yo» du narrateur se construit, pour le lecteur, autour d’éthé (ou «airs» selon Barthes) qui s’apparentent aux trois traits constitutifs du satiriste: le sens moral et l’esprit critique, nous l’avons vu, mais aussi le comique (18). En effet, afin de rabaisser sa cible, Montalvo en déforme la représentation par le biais du comique, selon les termes de Frye pour définir le mode satirique (19). Comment Montalvo parvient-il à se poser, tel Juvénal, en satiriste missionné? Il s’agit ici d’observer les procédés par lesquels le rire surgit pour servir la critique.
2. – Le comique satirique ou le ridicule qui tue: dégradation et exclusion de la cible
Parmi les paroles de combat, seule la satire recourt au comique. A ce titre, Las Catilinarias ne sauraient être définies comme un texte pamphlétaire, lequel exclut le discours d’autrui pour ne développer que ses propres idées, ni comme un texte polémique, qui réfute point par point le discours adverse pour avancer ses propres arguments. Elles procèdent par distorsions, tendant «à l’ennemi le miroir déformant de l’exagération comique» (20). Et même si elles ont parfois recours au registre parodique, elles ne sont jamais des parodies: elles ne visent pas des textes mais des cibles extra-littéraires bien réelles dans l’Equateur des années 1870 et 1880.
D’ailleurs, elles reposent sur une série de conventions d’authentification qui ancrent dans le réel la fiction, une fiction qui se prétend retranscription d’événements «vrais». Les lieux sont systématiquement nommés et souvent décrits; les dates et les allusions à l’actualité nationale ou européenne maintiennent un contact avec la réalité extra-textuelle.
C’est cette réalité qui subit un travail d’analyse, de décomposition, de grossissement et de réduction, qui débouche sur la dégradation des cibles visées. Montalvo privilégie ainsi une forme «d’anatomie du réel» (21), démembrant le corps social et le fragmentant en individus censés représenter chaque couche de la société équatorienne et les vices de celle-ci. Toutes les institutions, y compris l’instruction publique, sont observées; toute la hiérarchie sociale, depuis les noirs et indiens jusqu’au sommet de l’Etat, est répertoriée. Chaque individu s’y présente comme un type sans profondeur aucune, réifié, mécanisé, vu de l’extérieur et de façon partiale. En effet, Montalvo isole les traits censés le définir puis s’emploie à les grossir jusqu’au monstrueux, produisant un ridicule saisissant, aux effets dévastateurs.
Ainsi Montalvo retient-il la partie pour décrire le tout: «Los señores prebendados y canónigos, con sus respectivos vientres asentados sobre la cabeza de la silla, van allí de modo pontificial, desabotonada la sotana hasta arriba». Seul le ventre bedonnant est retenu pour construire un type, celui du «canónigo gordo». Le trait est décliné jusqu’au grotesque par le recours à l’hyperbole, puis confronté à un jeu de contrepoints avec des personnages nobles. Le «canónigo gordo» se présente alors comme le seigneur des puces, car dans ses plis généreux «soberbias pulgas tienen sus palacios». Et le satiriste de citer Goethe puis d’enchaîner les comparaisons entre le «canónigo gordo» et le noble seigneur du Faust, charitables avec leurs puces. Il en vient enfin aux différences, lesquelles confortent encore le ridicule, pointant de nouveau le trait réducteur définissant le personnage:
(…) El rey le hizo cortar [a la pulga] calzón y capa con su sastre Casandra. Mis canónigos no son para tanto: sus pulgas se están en su lecho sin calzoncillos ni gorro de dormir, trebejos que no han menester, pues el calor natural del palacio en que habitan les sirve de ropa de por casa, siendo como es todo buen canónigo, más que medianamente gordo y sanguíneo (22).
Le personnage est ramené à son apparence jusqu’à l’absurde. Celle-ci s’inscrit en réalité dans un système d’identification morale basé sur des correspondances. Le physique exprime le vice. Ainsi le «canónigo gordo» pèche-t-il par gourmandise et paresse. Son activité, loin d’être religieuse et spirituelle, se limite à dormir et à manger, Montalvo décrivant longuement ses divers repas. La conclusion débouche sur le grotesque: «hay afinidad electiva entre un canónigo, un prior muy gordos y la morcilla: bien hacen de quererse; sus entrañas son unas mismas» (23). De même, le type du «canónigo gordo», en définitive inoffensif, s’oppose à celui du «canónigo flaco», redoutable, nerveux, nécessairement hypocrite, dont la principale activité consiste à nuire à la Patrie. Ils ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les maniaques obsessionnels, victimes de leur humeur, qui peuplent les comédies de Ben Johnson.
En effet, dans cette construction caricaturale, les personnages sont toujours conçus par l’assemblage de traits physiques/vices. Manuel Gómez de la Torre est ainsi associé à la vanité, au pédantisme, s’inventant une origine noble et trichant sur son âge. Alors que cet «excelentísimo señor conde de Puño en rostro, don Manuel Torre de la Goma» vient d’avouer coquettement à Montalvo quelque quarante-deux printemps, voici le portrait macabre qu’offre de lui, pour illustrer sa déclaration, le satiriste:
La lujuria cansada, el pecado desmayado estaban corriendo por esos lagrimales que semejaban sepultura de gusanos; ojos garzos sin lumbre de inteligencia ni fuego de amor, parecían en él difuntos que se mueven por obra del galvanismo. La barba rucia y enmarañada, servía de palacio a mil insectos de esos que cría la cabellera de las paredes arruinadas : yo mismo vi salir de entre ella un caballo del diablo que venía arrastrando una araña negra de vientre cenizoso (24).
L’attaque se fait ensuite explicite contre «la mentira». Nous sommes alors loin de l’ironie légère. Justement, la variation des tons et des modes, du rire à l’effroi, de l’implicite à l’explicite, contribue à la dénonciation. Car c’est bien sur tous les tons et par tous les modes que Montalvo répète les amalgames, multiplie les angles d’attaque et crée l’amplification de la dépravation qui préside à la visión maléfica de la société équatorienne.
Pour associer aux diatribes, explicites, l’exposition du vice, implicite, sur le mode du rire, le satiriste reprend les recettes traditionnelles du comique; à commencer par la déformation physique. Ainsi, dans une description qui n’est pas sans rappeler celle du nez de Cyrano de Bergerac, Veintemilla se voit-il affublé de pieds si grands qu’ils ressemblent à des cercueils et que les béates se signent sur leur passage. La transcription de parlers populaires ajoute également au ridicule, tel l’accent chagra, donc vulgaire, d’un Veintemilla s’efforçant d’exposer sa légitimité à la présidence: «electo, fui, verdad, a juego, mochachos» (25). Dans cette perspective, le satiriste multiplie les associations dénigrantes, zoomorphiques et à caractère racial – et raciste sous la plume de Montalvo: «aquí somos nobles de confianza con orejas de burro y pies de chagra, como el señor general don Ignacio Jarrín de Borbón» (26).
L’onomastique, qui dit les turpitudes cachées tout en dégradant la cible, est également un recours privilégié. Nous l’avons vu avec Manuel Gómez de la Torre, rebaptisé d’un «Don Manuel Torres de la Goma» qui pointe sa suffisance. En fonction de l’épisode narré, les noms – étiquettes, synecdoques du caractère pour l’objet, affichent le travers dominant et contribuent à la déshumanisation du personnage en type fantoche. «Jarrín de Borbón» vise autant la manie nobiliaire de Veintemilla que son penchant pour le «jarro» de chicha et les alcools en général. Il peut être aussi le «feldmariscal von Jarrín» (27) pour ses prétentions militaires et ses supposées amitiés avec les têtes couronnées, ou bien «Ignacio de la Cuchilla» en raison de ses penchants criminels, ou «Ignacio de Píllapilla» piochant dans les caisses de l’Etat, ou encore «Ignacio de Ventimolla» lorsque le dictateur inculte s’avère incapable d’écrire sans faute son propre nom et qu’il confond les voyelles de l’alphabet. Il peut aussi être, entre autres, «el señor general Chinchilla», «Ignacio de Chinchilla», «El Gran Mudo», «su Alteza Monseñor el Gran Duque de Jarrín», «don Ignacio Cochinilla», «General Ventimolla». Chaque personnage-cible voit ainsi son nom à plusieurs reprises déformé, puis cette déformation déclinée, mariée à d’autres déformations et ce, tout au long des douze catilinaires. Dernier exemple, l’italique soulignant l’ajout par le pédant d’une particule, comme dans «Ignacio de Veintemilla», finit par contaminer «Ignacio de Ventimolla» jusqu’à «Manuel Gómez de la Torre» (28).
Dans cette exposition du vice, Montalvo aime à confronter ses personnages à la figure de l’étranger, lequel assume la fonction du naïf dont l’ignorance des mœurs équatoriennes permet de révéler le mal caché et son ridicule. Le satiriste crée alors une mini-intrigue, narrant la visite d’un étranger, toujours cultivé, en Equateur ou faisant voyager sa cible en Europe. Ainsi, pointant une nouvelle fois l’ignorance et la vanité de Veintemilla se faisant appeler de Veintemilla, le satiriste narre un épisode à Paris:
Andando un día por las calles de París, la nariz arremangada, origen de los dos Nilos que están fluyendo eternamente hacia el mar muerto de su boca; andando así, como un bausán dotada de pesada locomoción: echó de ver un letrero en una esquina, y preguntó: ¿Qué dice ahí ? Rue de Veintimille, respondió su adlátere. ¿No te había dicho? yo soy francés; mi familia pertenece a la nobleza de Francia: allí tienes mi nombre (29).
Le ridicule à l’œuvre crée une complicité entre le satiriste et le lecteur dont la fonction est, d’une part, de rejeter la cible, de la pointer tout en la mettant à distance et, d’autre part, de la dégrader et de la flétrir. A ce titre, le ridicule se présente pour Montalvo comme une arme vengeresse aux pouvoirs meurtrissants voire meurtriers. Symboliquement, par ce rire d’exclusion, il sanctionne ses ennemis et les met à mort. Le ridicule renvoie ici au pouvoir magique des origines de la satire, où l’imprécation est censée détruire la victime. D’ailleurs, la mort ne doit pas être que symbolique ou sociale chez Montalvo. Comme dans La dictadura perpetua en 1874 contre García Moreno, il appelle le peuple équatorien à en finir avec Veintemilla, «a alzar el brazo y dar al través con ese malvado» (30).
C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre les jeux de synecdoques onomastiques qui martèlent les douze catilinaires. Nommer la cible par son vice, c’est la désigner comme victime, la mortifier, la fustiger, la déshonorer et briser sa réputation. Montalvo rappelle de nouveau la figure du Juvénal hargneux, animé par le dépit, qui met la force du Verbe au service de l’attaque vengeresse, diffamatoire le cas échéant. Le ridicule doit tuer et servir cette visée correctrice que la satire est seule à posséder.
Pour définir le mode satirique, Frye évoque à ce titre, chez le lecteur, «la reconnaissance, au moins implicite, d’une norme morale, soutien essentiel d’une attitude militante en face de la vie» (31). En quoi consiste cette norme dans Las Catilinarias? A notre sens, elle recoupe l’opposition civilisation – barbarie, au centre de tous les essais équatoriens de l’époque, chez le conservateur Juan León Mera comme chez le libéral Montalvo. Evidemment, contrairement à un Mera, Montalvo tient des propos très anticléricaux. Toutefois, comme chez Mera, l’intelligence, la morale, la raison illustrent la civilisation à l’œuvre, placée du côté de la lumière. Pointées par le ridicule, le vice et l’ignorance relèvent de la barbarie et de ses ténèbres.
3. – La norme de la civilisation: le satiriste Montalvo contre le troglodyte Veintemilla
Dans le jeu des oppositions morales à l’œuvre dans Las Catilinarias, la civilisation est portée par la persona, le satiriste, qui incarne les valeurs positives, par opposition à la cible, Veintemilla et tous les personnages dérivés, déclinaisons d’une barbarie équatorienne. Si le dictateur se trouve au cœur du propos, c’est parce qu’il apparaît comme le principal symptôme de cette barbarie. De même, les vices dénoncés n’en sont que les manifestations. La barbarie, telle est la cible finale du propos satirique: une barbarie qui n’est pas seulement politique mais sociale et culturelle.
Elle apparaît d’emblée politique, tant le fonctionnement de l’Etat et l’application du texte constitutionnel sont déficients. Ils marchent d’ailleurs à l’envers: le crime est la norme et s’avère payant, la justice se charge d’organiser l’impunité. La délinquance se trouve en effet au sommet de l’Etat. Les libertés fondamentales et les garanties essentielles, chères au libéral Montalvo, sont donc systématiquement bafouées et le satiriste vertueux se présente comme la victime du «monstruo» au pouvoir. Ce dernier incarne à lui seul le vice, se voyant attribué, pour traits principaux, les sept péchés capitaux que la seconde catilinaire décrit avec emphase et outrance. L’analyse institutionnelle et politique repose ainsi sur l’exhibition de la corruption du système, corruption personnifiée par Veintemilla. Tel un cancer, la dépravation du dictateur contamine la vie publique et plonge dans l’anarchie une société de fait sans gouvernement.
Car Veintemilla ne se présente pas comme un pervers, lequel connaît la Loi même s’il ne la respecte pas, mais comme un «troglodita» pour qui le vice est Loi. Montalvo, en effet, définit le peuple troglodyte comme obéissant à des anti-valeurs: «entre ellos, la importancia personal de un individuo se graduaba por el número de acciones atroces, o por los actos que hacen temblar la naturaleza» (32). Veintemilla inscrit ainsi l’Equateur dans un ordre qui est celui de la barbarie, selon le topique d’un mundus inversus qui est aussi un mundus perversus. Il est «el mutilador de sus semejantes, el infamador de los difuntos, el violador de las hijas de sus hermanos, el traidor a la patria, el asesino nocturno, el codicioso de los bienes ajenos, el impío por ignorancia, el hijo del crimen y padre de los vicios (…)» (33).
Dès lors, la barbarie est aussi sociale. L’organisation du groupe repose sur les «iniquidades y torpezas» constituant les «costumbres» des troglodytes. A ces derniers est associée la figure du chagra peuplant le pays: «Quitadle el chagra al Ecuador, y le habréis quitado la flor de su idioma: sin el nombre, el sujeto vendría a quedar en contingencia; y una vez desaparecido tan curioso personaje, la nata de la población del Nuevo Mundo se ha perdido» (34). Le chagra est présenté comme le troglodyte équatorien par excellence, une nouvelle facette de la barbarie : arriviste, sans scrupules, pédant, inculte, satisfait, fainéant, cupide, alcoolique et lascif, entre autres. Il se décline en «chagra-soldado», «chagra-coronel», «chagra-jefe», «cholo», «mestizo ladrón» avec des ramifications chez l’indien, tantôt «ebrio» et violent, tantôt abruti et passif, chez le «zambo» ou chez le noir, primitif, homme de main du «chagra-jefe» Urbina ou Veintemilla (35), nécessairement possédé par la danse et l’alcool lors de fêtes orgiaques.
A l’instar du «troglodita», le chagra apparaît associé au vice et le terme à lui seul représente une insulte. Dans ce système de correspondances qui associe la couleur de peau au degré de civilisation et à ses vertus, «indio» sert à son tour à décrire la laideur physique et morale de Veintimilla: «fuera del color, todo es indio en esa fea, desmañada criatura». Par opposition, les Français, blancs, aux côtés des Européens en général, se présentent comme «cultos», «amables», dotés de «ingenio», «chispa», «cortesía», «gracia», «elevación moral» (36).
Dans un Equateur gouverné et majoritairement peuplé par des chagras, les travers sociaux font donc office de «costumbres». La pédanterie en est le symptôme flagrant, les chagras cherchant à se blanchir par la «falsificación de símbolos nobiliarios» (37), nous l’avons vu. Même le «curtidor Chinchilla firm[a] Pedro de Chinchilla» (38). Mais le vice fondamental sur lesquels prospèrent ces travers est l’ignorance, l’inculture généralisée. La barbarie est aussi et surtout culturelle, dans un pays qui néglige l’instruction publique.
La septième catilinaire est consacrée à la description des bienfaits de l’éducation sur la société, qu’elle présente comme le moteur de la prospérité, du progrès et de la paix. Citant Voltaire qui observait la généralisation de l’instruction publique dans les pays du Nord de l’Europe, le satiriste affirme: «del Norte es de donde nos viene la luz (…); las luces humanas salen del Norte para guiar y mejorar a los hombres» (39). Les associations lumière-culture-vertu relèguent l’Equateur, par le jeu des oppositions, dans les ténèbres de l’ignorance, mère de tous les vices, qu’illustre de nouveau Veintemilla, «un irracional sin noticia de ciencias, artes, instituciones, filosofía, moral, derecho público ni civil, político, ¡nada!» (40). De même, le Sud/Nouveau Monde, foyer de la barbarie, s’oppose au Nord/Europe, principe de civilisation.
Dans cette logique, le chagra, lorsqu’il monte dans la hiérarchie sociale, n’est jamais qu’un parvenu, illettré, aux manières grossières et qui, de Paris, connaît davantage Pigalle que le Louvre, tel Veintemilla qui ne l’a jamais visité. Le dictateur ignore tout de l’Opéra et, à la vitesse où il se cache de ses créanciers, il fuit les Tuileries lorsque Hayden y est joué: la beauté de la musique noble agit sur lui comme «una culebra» (41).
C’est cette approche qui permet d’expliquer l’omniprésence, l’obsession de la dénonciation de la folie nobiliaire équatorienne. Unamuno la trouve exagérée (42); à tort, à notre sens, à la lumière du mode satirique: elle sert la condamnation de l’inculture, qu’elle pointe par le biais du ridicule. En témoigne la scène hilarante du dîner où Manuel Gómez de la Torre, autre faux noble parvenu, invite à un festin de gourmet le président Borrero que le satiriste, sur le ton du respect feint, appelle Don Antonio. Le dîner représente un topique satirique par excellence depuis les banquets d’Horace et Juvénal. D’une part, il permet de mettre en scène un microcosme représentatif, «une société en miniature»; d’autre part, «parfaite expression (en théorie) des conventions, [il s’avère] (dans la pratique) le contexte le plus propice au déchaînement des instincts» (43) et des travers. Les personnages y singent la noblesse cultivée d’Europe, torturant la langue, ignorant tout du savoir-vivre, incapables de reconnaître et d’apprécier un vin fin:
Después de una pierna de Borrego: «Cate vuencencia estotra agüita de canela». Echaselo al coleto don Antonio, y contesta : chato margo. Qué chato margo, dice don Manuel; si es valdepeñas (44).
Durant tout le repas, «chato margo» sera la seule réponse du grand homme face aux vins les plus exquis, jusqu’à ce qu’il finisse par tomber juste et… reconnaître une chicha, boisson chagra par excellence, que le satiriste dépeint justement comme «una cosa amarilla, agria a la vista, abominable al espíritu» mais dont Don Antonio se délecte «cual si fuera el elíxir de la vida» (45).
Certes, la norme qu’évoquait Frye et qui sert de soutien au propos militant du satiriste, est la civilisation par opposition à la barbarie, mais une civilisation qui repose principalement sur une conception élitiste: celle d’une culture savante, raffinée, «blanche». Cette norme est en définitive un modèle: l’Europe d’alors ou, plus exactement, les élites européennes, intellectuels, noblesse et grande bourgeoisie, tels que se les représente Montalvo. Implicitement, le projet de faire entrer l’Equateur dans le concert des nations civilisées, défendu ici par le libéral Montalvo, passe par une nécessaire européisation de l’Equateur et par son blanchiment. A l’image du satiriste. Contrepoint du chagra parvenu, il est, lui, issu d’une bonne famille, blanc, honnête homme, cultivé, nourri d’une culture érudite présentée comme universelle. Il est ici le marqueur même de la norme.
4. – La langue de la civilisation contre celle de la barbarie: le satiriste linguiste
C’est comme stratégie de marquage qu’il faut comprendre le goût de Montalvo pour les références encyclopédiques censées appuyer ses propos. Elles sont proprement effarantes tant par leur nombre que par leur diversité. Elles puisent à toutes les sources de la culture savante, donc – selon lui – de la civilisation. Elles sont aussi bien religieuses, artistiques, littéraires, scientifiques qu’historiques, géographiques ou philosophiques, relevant de toutes les époques depuis l’Antiquité. Jamais une idée, une anecdote, un souvenir ne sont présentés sans une ou plusieurs de ces références, pour certaines si peu connues qu’elles relèvent de l’érudition pure et simple.
Citons-en quelques-unes, pêle-mêle et à simple titre d’exemple: «Claudio», «Catón», «Eros», «Anteros», «Harmadio», «Aristógiton», «Don Vicente Quesada», «Eugenio Hartzembusch», «Vampa», «Trucaforte», «Roque Guinart», «Apolo», «Bolívar», «Vicente Rocafuerte», «Olmedo», «Epicuro», «Morgante Maggiore», «Sandanápalo», «Pitágoras», toute une série de gladiateurs, de saints, de personnages de l’ancien et du nouveau testament, Cicéron, Dante, Fray Luis de León, Cervantes, Louis XIV et Versailles, La Bruyère, Boileau, Molière, Racine, mais aussi Napoléon, Jules César, Alexandre le Grand, le roi de Prusse, la reine d’Angleterre, «Bonnefoi», «Juan de Mallarca», «Orlando y Angélica», «Quijote y Dulcinea», «Don Gafeiros y Melisandra», «Abelardo», «Leandro», «Guillermo Hohenzollern». Ce catalogue insistant invoque LA civilisation.
A ce titre, une des principales manifestations de la barbarie équatorienne est ici linguistique, prolongement logique de la barbarie culturelle. A l’instar de leur physique difforme qui signale leur vice, la langue des personnages exhibe leur inculture. Ils parlent le barbare, en quelque sorte. La déformation comique de la réalité s’attaque alors à la langue.
Le parler populaire est non seulement retranscrit mais mis en scène, comme si la mini-trame était créée pour faire répéter à un Don Antonio de pacotille «chato margo». Le satiriste se charge ensuite de corriger les fautes de langue et de prononciation dans de multiples et minutieuses digressions linguistiques.
Le chaos linguistique ne concerne pas seulement le castillan mais le français, langue par excellence de la civilisation selon la norme qui sous-tend le propos. Le satiriste qui, pour sa part évidemment, maîtrise parfaitement le français, met en scène des barbares équatoriens à Paris. Convaincus de s’exprimer dans la langue de Molière, ils parlent un charabia incompréhensible, avec des malpropismes et un très fort accent. Manuel Gómez, présenté au passage comme un avare, s’exprime ainsi dans son hommage funèbre à un compatriote:
Es un joven sen fortuna que vino per estudié: nu lui vinimos enterrande. Unos dicen que del fígado, otros que del pulmón: el fecho es que se murí. Conténtese señor cura con unes trescientes fran: ques tuce que puvon doner a vu nu (46).
Le satiriste se met alors en scène pour mieux redoubler le ridicule du chagra. Au prêtre qui lui demande «¿Qué lengua habla este señor?», il répond «La francesa, señor cura», avant de commenter: «Hasta hoy estoy oyendo la carcajada del imprudente clérigo». Manuel Gómez prend conscience de ce rire excluant et se vexe. Mais il se ridiculise encore, par son incapacité à comprendre son travers d’abord, par son castillan chagra ensuite, en s’adressant au satiriste qui note ironiquement: «en buen castellano dijo: ¿De qué se ríe este monigote?» (47).
Car les valeurs culturelles positives qu’incarne le satiriste s’illustrent à longueur de texte dans sa maîtrise recherchée du castillan. L’emploi d’un registre savant, le goût des tournures précieuses, le «casticismo» effréné, les constructions archaïsantes, ont souvent été qualifiés de pédants. Unamuno lui-même les désapprouve. Pourtant, ils n’ont ici rien de gratuit: ils constituent autant de marqueurs de la norme, dans cette stratégie d’opposition systématique entre civilisation et barbarie. La civilisation, selon Montalvo, se distingue (dans tous les sens du terme) par son purisme linguistique, nouvelle facette de la culture d’élite, raffinée et exigeante, celle des penseurs rigoureux, de la noblesse digne, de la bourgeoisie industrieuse d’Europe.
Notons que, malgré sa préciosité, le style n’est jamais ampoulé. Au contraire, à la recherche de l’effet et, souvent, de l’outrance, il s’appuie sur une emphase et une grandiloquence qui donnent un réel souffle au texte, rappelant celui de Victor Hugo que Montalvo admire et qu’il cite d’ailleurs à plusieurs reprises dans ses catilinaires. Les constructions ternaires, la scansion des noms, l’énumération des vices, fabriquent un rythme imprécateur qui sert la dénonciation. Tel Juvénal, le satiriste se fait prédicateur et se pose ici en «civilisateur des barbares équatoriens» (48).
En effet, le sursaut est possible: «Pueblo es un vasto conjunto de individuos cuyas fuerzas reunidas no sufren contrarresto: su voz es trueno, su brazo rayo» (49). Et Montalvo prétend participer de ce sursaut en en appelant au peuple équatorien: «pueblo, pueblo, pueblo ecuatoriano, ve a la reconquista de tu honra, y muere si es preciso» (50). Pourtant cet appel au sacrifice est désespéré: il reste emprunt d’un fort pessimisme qui donne cette tonalité sombre à Las Catilinarias.
Car si Montalvo, dans ses invectives, s’adresse directement aux Equatoriens, c’est également pour les désigner, eux aussi, comme cible. «Pueblo, pueblo, la honra ha huído de tu pecho, la vergüenza de tu rostro» accuse-t-il. Il dénonce leur passivité face à Veintemilla, leur «vil aguante» (51). Surtout, leur lâcheté se nourrit cette même inculture sur laquelle prospère la barbarie. Le peuple équatorien relève alors de ces «pueblos de escasas luces y abundante mala fe» (52). Il partage en définitive les vices de ses gouvernants. Tel troglodyte, tel peuple barbare ; voilà qui pourrait résumer la démonstration à l’œuvre dans Las Catilinarias.
Face à «esa obra de destrucción e ignominia» conduite par la barbarie en marche, ceux qui se voient condamnés à l’exil sont les hommes de bien auxquels, par le «nous», s’associe le satiriste/marqueur de la norme. Ils quittent l’impossible Nation Equateur ou, plus exactement, une Anti-nation Equateur selon le topique du mundus inversus, où la vertu est proscrite et le vice célébré: «¿Qué patria queda? ¿Dónde está la patria? Huyamos, sí, huyamos de hombres entre los cuales los de bien y de corazón sucumben, aunque no aborrezcamos al pueblo donde preponderan los inicuos» (53).
Montalvo prétend ne pas haïr le peuple équatorien, malgré ses invectives. Pourtant, les types qu’il construit, à caractère raciste, traduisent un profond mépris. Au mieux fait-il preuve de pitié condescendante: «Pobre pueblo», «Pobre Ecuador», «Triste cosa es el pueblo» répète-t-il. Certes, à travers la norme de la civilisation, Montalvo défend les honnêtes gens, le respect de la loi, la liberté, l’ordre citoyen. Mais, non sans paternalisme, il défend surtout une société inégalitaire, où les femmes, les indiens, les chagras, les noirs, les analphabètes et ignorants, sont forcément ses subalternes (54).
Conclusion
Consumé de colère et de frustration, Montalvo, comme Juvénal, apparaît animé de cette indignation vengeresse qu’Unamuno évoquait et que rappelle la première des seize satires de Juvénal: «A défaut de génie, c’est l’indignation qui fait les vers […]» (55). A ce titre, il partage avec Juvénal le souffle et la force d’un entraînement verbal qui donne aux mots ce rythme et cette verve créant la «délectation morose» (56) du lecteur fasciné par tant de vice.
Chez Juvénal, la déchéance de Rome se mesure à l’aune des vertus mythiques d’un âge d’or révolu; celle de l’Equateur se mesure à l’aune du modèle européen, tout aussi mythique, de nation civilisée. Dans les deux cas, la satire dépeint la barbarie d’un monde apocalyptique, ordurier et obscène. A la nostalgie passéiste d’un Juvénal épouvanté fait écho le pessimisme amer de Montalvo. Certes, les tyrans meurent, mais leurs vices survivent et de nouveaux tyrans surgissent, dans un Equateur condamné au chaos, telle la Rome décadente dénoncée par Juvénal. Et c’est bien l’apocalypse qu’annonce avec grandiloquence Montalvo. Il présente l’Equateur comme un enfer, un «hervidero de sangre podrida», en guise de conclusion:
Mira allí, poeta, ese hervidero de sangre podrida en donde están saltando las larvas y sabandijas que crecen y suben y se vuelven grandes monstruos: es la sangre de los malvados que van muriendo. Pero de ella nacen otros, de ese hervidero salen los que prolongan su vida, y acaece que parezca no tener fin la de estos enemigos de Dios y de los hombres (57).
NOTES
(1) L’étude du texte se base sur cette édition: Juan MONTALVO, Las Catilinarias, Quito, Libresa, 1990, p. 55.
(2) Ibid., p. 61.
(3) Ibid., p. 56.
(4) Juan MONTALVO, La dictadura perpetua, in Las Catilinarias, El Cosmopolita, El regenerador, Barquisimeto – Venezuela, Fondo Editorial de la UCLA, 1977, pp. 91-107.
(5) Etude introductive de Gonzalo ZALDUMBIDE à Juan MONTALVO, Juan MONTALVO (estudios y selecciones de Gonzalo Zaldumbide), Mexico, J. M. Cajica, Colección Biblioteca Ecuatoriana Mínima, 1960, p. 48.
(6) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 262.
(7) Ibid., p. 79.
(8) La tradition critique et littéraire souligne l’héritage formel des satiristes latins, qui fixent les codes de la satire régulière en vers tout en lui conférant une certaine ambiguïté. Mais elle distingue deux esthétiques, contradictoires: celle héritée d’Horace et de sa muse enjouée, celle héritée de Juvénal et de sa muse indignée. La postérité retient en effet de Juvénal l’image d’un satiriste excessif, maniant l’emphase et la déclamation, qui s’abaisse au besoin à l’ordurier, alors qu’elle retient d’Horace l’image d’un satiriste modeste, au style simple, prônant la clémence et le juste milieu.
(9) Sophie DUVAL, Marc MARTINEZ, La satire, Paris, Armand Colin, 2000, p. 84.
(10) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 84.
(11) Ibid., p. 141.
(12) Idem.
(13) Ibid., p. 121.
(14) Sophie DUVAL, Marc MARTINEZ, op. cit., p. 184.
(15) Ibid., p. 234.
(16) Northrop FRYE, Anatomie de la critique, Paris, Gallimard, 1969, p. 180.
(17) Ibid., p. 289.
(18) Nous reprenons ici les traits constants dégagés par les théoriciens de la satire, dans Sophie DUVAL, Marc MARTINEZ, op. cit., p. 184.
(19) Northrop FRYE, op. cit., p. 272.
(20) Sophie DUVAL, Marc MARTINEZ, op. cit., p. 185.
(21) Ibid., p. 191.
(22) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 284.
(23) Ibid., p. 285.
(24) Ibid., p. 339.
(25) Ibid., p. 79.
(26) Ibid., p. 311.
(27) Ibid., p. 310.
(28) Ibid., p. 324.
(29) Ibid., p. 319.
(30) Ibid., p. 72.
(31) Northrop FRYE, op. cit., p. 272.
(32) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 68.
(33) Ibid., p. 321.
(34) Ibid., p. 78.
(35) Ibid., pp. 152-153.
(36) Ibid., p. 319.
(37) Ibid., p. 73.
(38) Ibid., p. 313.
(39) Ibid., p. 197.
(40) Ibid., p. 221.
(41) Ibid., p. 220.
(42) Ibid., p. 61.
(43) Colette ARNOULD, La satire, une histoire dans l’histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, pp. 24-26.
(44) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 324.
(45) Ibid., p. 325.
(46) Ibid., p. 303.
(47) Idem.
(48) Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage de Juan Carlos GRIJALVA, Montalvo: civilizador de los bárbaros ecuatorianos. Una relectura de ‘Las Catilinarias’, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar – Abya Yala / Corporación Editora nacional, 2004.
(49) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 64.
(50) Ibid., p. 72.
(51) Idem.
(52) Ibid., p. 140.
(53) Ibid., p. 208.
(54) Telle est également l’idée soutenue par Juan Carlos GRIJALVA, «El imaginario étnico de las tiranías en Las Catilinarias de Juan Montalvo», Procesos, revista ecuatoriana de historia, Quito, N°17, II sem. 2001.
(55) JUVENAL, Satires, Paris, Les Belles Lettres, 1967, vers 79.
(56) Selon l’expression de Désiré NISARD au sujet de Juvénal, Etudes sur les poètes latins de la décadence, Paris, Hachette, 1888.
(57) Juan MONTALVO, Las Catilinarias, op. cit., p. 362.