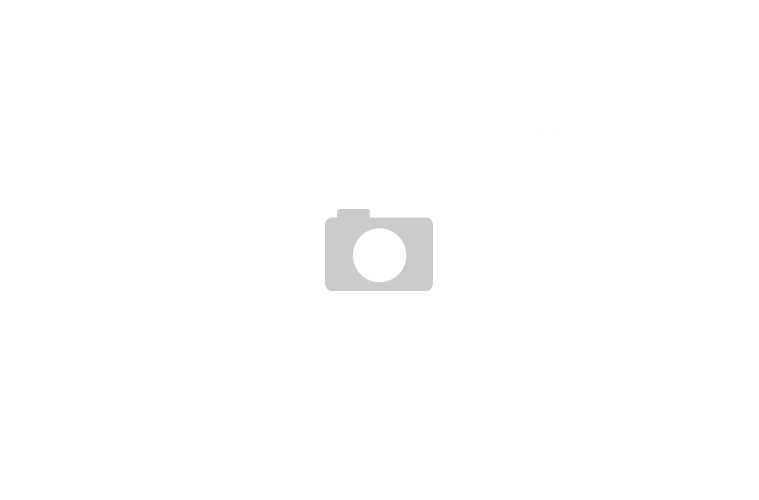Mentionnons cette belle scène parisienne du marché aux timbres, situé au Rond-point des Champs Elysées:
“-Monsieur avez-vous un timbre de cette série de Juan Montalvo? demanda un adolescent qui avait dans sa main un timbre équatorien avec l’effigie du célèbre écrivain…
-Pourquoi t’intéresses-tu à Juan Montalvo? demanda à l’adolescent [le Chargé des affaires culturelles de l’Ambassade du Venezuela, M. Pardo de Leygonnier, académicien, historien, conférencier… philatéliste amateur lui aussi]…
Surpris par cette question, l’adolescent répondit: mon papa m’a raconté que nous appartenons à la famille de Juan Montalvo et à ce qu’il paraît ce fut un grand écrivain…
-Si tu veux des timbres sur Juan Montalvo et en savoir plus sur lui ajouta le diplomate vénézuélien, adresse-toi à ce monsieur et sur une carte de visite il écrivit: Monsieur A. Darío Lara, Ambassade de l’Équateur 34, avenue de Messine Paris 8º, tél.: Laborde 10-21” (1).
Ainsi grâce à cet heureux hasard, notre auteur a découvert en France le fils de Juan Montalvo: Jean Contoux, en septembre 1963, et Darío Lara publiera le fruit de toutes ces recherches dans: Montalvo en París (2), en deux tomes, comprenant la descendance française de Juan Montalvo, ainsi que de nombreux articles oubliés ou inconnus du grand Ambaténien. Par ailleurs, toute une correspondance s’établira entre eux, elle sera publiée en espagnol dans Este Otro Montalvo (3) en 1996. Par ailleurs, dans l’article «Au sujet de Jean Contoux, fils de Juan Montalvo», le lecteur trouvera une présentation de cet échange épistolaire ainsi que la traduction de plusieurs lettres d’importance.
Notes:
Vigie de la Tour Eiffel
Un fils de Juan Montalvo vit actuellement en France*
Par A. Darío Lara
A Don Gonzalo Zaldumbide, avec ma fervente admiration,
A.D.L.
Aujourd’hui, mardi 24 septembre 1963, à partir de 3 heures de l’après-midi, j’ai eu ma première conversation émouvante avec M. Robert Simard, petit-fils de Juan Montalvo. Homme de cinquante et un ans, robuste, en bonne santé et plein de délicatesse, il porte des lunettes; de taille moyenne, le front dégagé, les rares cheveux peignés en arrière, sa conversation est agréable, cordiale.
Né à Paris, en 1912, sa mère fut madame Suzanne Contoux, fille de Juan Montalvo** et de madame Augustine Contoux; Suzanne, décédée très jeune, fut la sœur cadette de Jean Contoux, le fils parisien de Juan Montalvo, homme d’environ 78 ans, qui vit actuellement dans une ville du sud de la France.
La vague rumeur que Juan Montalvo avait une descendance dans la capitale française arriva plus d’une fois jusqu’à moi. Il y a peu de détails, des allusions timides chez les biographes de Montalvo lorsqu’ils se réfèrent à la vie sentimentale parisienne du célèbre Ambaténien.
Gonzalo Zaldumbide est sûrement l’Équatorien qui – porte-parole insigne – a contribué avec le plus de zèle à propager la renommée illustre de notre compatriote. Son brillant «Montalvo» n’a pas été dépassé, bien que, comme il le note lui-même, les plagiaires ou les paraphraseurs n’aient pas manqué… lesquels ne l’amélioraient même pas ni ne le complétaient. Son travail sur Montalvo («Travail désintéressé dans la diffusion de sa plus grande gloire à l’étranger», comme il l’avait dit), peut-être mal connu de tous les Équatoriens, réalisé à Paris, surtout, a été et restera sans égal. De ce maître sans pareil, j’appris à Paris l’atticisme, dans ses pages raffinées, dans ses réalisations dans le marbre, dans le bronze et dans le livre, l’admiration docte de la figure de proue qu’est Juan Montalvo, le «Prince de nos lettres».
Le vendredi 20 septembre, j’écrivais une de mes collaborations pour «El Comercio». Dans cet article, je me référais précisément à une promenade à Paris, en compagnie d’amis guayaquiléniens et à notre visite au numéro 26 de la rue Cardinet, où mourut Juan Montalvo. Par une de ces coïncidences mystérieuses, exceptionnelles qui arrivent de temps en temps – comme si les mânes de don Juan me visitaient alors – le téléphone sonna et un appel vint interrompre mon travail et couronner à cet instant merveilleux tant d’années d’attente patiente de ma part, tant de jours de recherches parisiennes, dans des archives et des bibliothèques…
Je réserve pour une étude plus complète le dialogue cordial qui s’ensuivit alors (ainsi que les détails minimes que permit ce premier contact). J’ajouterai seulement qu’à la fin de notre étrange conversation, mon interlocuteur ajouta simplement, en confiance: «Je suis un petit-fils de Juan Montalvo. Mon nom est Robert Simard».
Effectivement, hier matin 23, il me rappela et nous nous donnâmes rendez-vous pour cet après-midi. Ainsi aujourd’hui mardi je viens de parler longuement avec lui surtout de la vie de Juan Montalvo, son illustre grand-père. Nous avons rappelé les trois moments où il vécut à Paris, 1857, la première fois, en qualité de diplomate, la deuxième, en 1869, en tant qu’exilé ainsi que la troisième, à partir de 1881 jusqu’à sa mort, le 17 janvier 1889. C’est-à-dire la plus grande partie de ces années à propos desquelles Montalvo écrivit: «Si je pouvais donner les 8 années d’Europe de mes trois voyages, bien qu’elles n’aient pas été complètement inutiles; si je pouvais les donner en échange de quatre jours de pur bonheur familial, je n’hésiterais pas une seconde».
Jean Contoux, premier fils français de Juan Montalvo y de madame Augustine Contoux, dut naître vers 1885, car actuellement il doit avoir près de 78 ans et il vit dans une ville du sud de la France. Jean a une fille, Eveline, 54 ans, qui travaille actuellement au Luxembourg, au Pool Charbon-Acier. Suzanne Contoux, fille de Juan Montalvo, dut naître vers 1888; elle a épousé Roger Simard et elle a eu quatre enfants: Robert, 51 ans (qui me rend visite aujourd’hui), Yolande, 47 ans, Raymond, 45, et René, 43. Suzanne mourut très jeune.
En contemplant une photographie de Juan Montalvo, Robert Simard reconnaît émerveillé l’énorme ressemblance avec son oncle Jean, quand il était jeune, tout comme avec celle de son fils Robert, âgé de 24 ans. Le portrait qu’il ébauche d’eux concorde avec ces phrases que Núñez de Arce écrivit à propos de Juan Montalvo: «Grand, maigre, les cheveux noirs et frisés, le front dégagé… la bouche dédaigneuse, peu enclin au rire et les yeux brillants»; ou avec ces autres de Blanco-Fombona: «Un homme de haute stature, plutôt maigre, de bonne apparence. Le teint brun de l’homme blanc né sous les tropiques, la chevelure de jais frisée s’enroulait sur son très grand front… les yeux sombres, grands, lumineux…, le nez droit, long…»
Et même dans le portrait qu’il trace de Jean, il signale comme traits caractéristiques ; «fier, polémiste acerbe, bourru, hautain…» pour employer quelques-unes des épithètes que Gonzalo Zaldumbide attribue à Juan Montalvo, dans le Discours mentionné ci-dessus.
Paris, 24 septembre 1963
Note: Le 25 septembre, j’écrivis ma première lettre à monsieur Jean Contoux. Aujourd’hui, 4 octobre, datée du 29, je viens de recevoir une réponse. C’est une lettre très gentille et précieuse, qui m’apporte, entre autres, deux éclaircissements importants: 1. Jean Contoux naquit en octobre 1886, il aura donc 77 ans dans quelques jours; 2. sa mère mourut à Paris en 1950, à l’âge de quatre-vingt-dix ans. C’est-à-dire qu’elle naquit en 1860 et avait vingt et un ans quand Juan Montalvo arriva à Paris, pour la troisième fois. Mon contact avec Jean Contoux est donc établi et aujourd’hui même je lui ai écrit ma deuxième lettre.
(Tiré de «El Comercio». Quito – Équateur, Dimanche 20 octobre 1963).
** Voir la rectification que A. Darío Lara écrivit dans le tome I de son livre: Juan Montalvo en París, Subsecretaría de Ambato-Ilustre Municipio de Ambato, page 25 et suivante où il indique que: «… Jean Contoux Montalvo en discutant avec lui à Paris, en avril 1964, me manifesta qu’il a été l’unique fils de Juan Montalvo et d’Augustine-Catherine Contoux. Suzanne Contoux a été sa sœur utérine puisqu’elle naquit en 1895, six ans après la mort de Juan Montalvo. »
(1) Sur ce point, voir la rectification que le docteur A. Darío Lara écrivit dans le tome I page 25 et suivante.
* Nous remercions très chaleureusement Mme. Nicole Fourtané d’avoir traduit cet article.
Vigie de la Tour Eiffel
Il y a soixante-quinze ans que Juan Montalvo est mort*
Par A. Darío Lara
Soit, peut-être, parce que très peu de journaux nous arrivent de l’Équateur de temps à autre, soit, surtout, parce que la mémoire est fragile et oublieuse, je n’ai rien lu dans la presse nationale qui, au cours de la seconde quinzaine de janvier dernier, rappelle cet anniversaire ni la figure de notre illustre prosateur.
Le ciel dégagé, d’un beau bleu, d’une journée merveilleusement exceptionnelle semblait s’unir à notre hommage. Pendant ce temps, – dans cet austère paysage hivernal – se succédait inlassablement au-dessus de nos têtes un monotone battement d’ailes de centaines de pigeons.
Avant tout, grâce à l’acte de naissance que j’ai entre les mains, je dois confirmer que Jean Contoux-Montalvo naquit à Paris le 17 octobre 1886 et que, par conséquent, il est déjà entré dans ses 78 ans. Sa mère fut madame Augustine Contoux, née à Garnat département de l’Allier, le 17 octobre 1858 et morte à Paris le 5 janvier 1949 à 91 ans.
Déjà dans sa lettre du 1er octobre dernier, Jean m’écrivait: «Je possède, en effet, des souvenirs de mon père (des photos, des exemplaires de quelques-unes de ses œuvres, de la correspondance…) qui ont pour moi une valeur sentimentale. J’ai aussi, naturellement, des souvenirs personnels sur mon enfance, les relations de ma mère, morte en 1949 à 91 ans, et les miennes jusqu’à 18 ans, sur les personnalités équatoriennes, officielles ou privées, en mission ou résidant à Paris… Comme je vous l’ai déjà écrit, j’ai encore après tant d’années ces souvenirs matériels, si je peux m’exprimer ainsi, qui ont pour moi une valeur sentimentale, puisque c’est tout ce qu’il m’est resté de mon père. Si ceux-ci sont de nature à vous intéresser, pour mieux faire connaître la vie en France de mon père, je suis disposé à m’en séparer».
En feuilletant ces notes, lisons, en premier lieu, celles-ci sur la vie parisienne de Juan Montalvo.
Il aimait recevoir, en particulier à la fin de la journée, quelques amis de la colonie sud-américaine; parmi les Équatoriens, spécialement monsieur… Je me souviens de ce dernier, parce qu’il me prenait sur ses genoux pour jouer avec moi. Ce souvenir me poussa à intervenir en sa faveur auprès de mes collègues (1) des quotidiens parisiens, quand, en 1934, il fut compromis dans l'»affaire» Stavisky, pour que son nom fût cité le moins possible. Je me sentis heureux de l’avoir obtenu de leur amitié. Naturellement, monsieur… ne sut rien de tout cela et n’eut pas, par conséquent, à me remercier.
Vers la fin de l’après-midi, il allait, assez fréquemment, au journal «Le Figaro», alors le grand quotidien littéraire et mondain de la rue Drouot, auquel il donnait, de temps en temps, des articles pour augmenter ses revenus. Il rencontrait là-bas dans les salons et la salle de rédaction des écrivains célèbres et des journalistes connus avec lesquels il prenait plaisir à s’attarder.
Dans sa lettre du 27 janvier dernier, il écrit: «Je vous envoie une note susceptible de compléter votre documentation. En fouillant dans de vieux papiers, j’ai trouvé quelques lignes de ma mère, relatives à la maladie et à la mort de mon père. Je les ai mises au propre à votre intention:
Au bout d’un mois, le docteur Léon Labbé qui le soignait, inquiet de ne pas constater d’amélioration, provoqua une consultation avec ses collègues qui estimèrent que la fièvre était d’origine nerveuse et les douleurs de simples névralgies.
Le docteur Labbé pensant, au contraire, qu’il devait s’agir d’une déchirure de la plèvre, procéda le lendemain à une ponction et à l’extraction d’un liquide qui, après examen, se révéla de nature séreuse. Quelques jours plus tard, les douleurs devenant de plus en plus intenses, une nouvelle consultation de médecins conclut qu’une intervention chirurgicale était nécessaire et urgente.
Mais cette douloureuse épreuve fut inutile, le germe purulent s’était déjà répandu dans tout son organisme. Quand il s’en rendit compte, mon père exigea d’être reconduit chez lui, au 26 rue Cardinet, pour mourir là-bas à nos côtés. Deux jours après, le 17 janvier 1889, il demanda d’être revêtu de son frac et il attendit ainsi la fin.
J’ai rappelé auparavant que Jean Contoux-Montalvo a 78 ans. Son unique ambition, déjà à la fin de ses jours, est la suivante, comme il me l’écrivit dans sa lettre du 13 novembre 1963: «Je serais heureux de me recueillir sur la tombe de mon père…»
(1) Dans mon article du 20 octobre, j’ai déjà écrit que Jean Contoux-Montalvo exerça le journalisme, à Paris, pendant trente ans.
Vigie de la Tour Eiffel
Augustine-Catherine Contoux, compagne de Montalvo à Paris, nom pour les lettres équatoriennes*
Par A. Darío Lara
Il y a quelques semaines, s’éteignit à Madrid Francisca Sánchez del Pozo, la fille du jardinier du roi de la Casa de Campo qui, au printemps 1809, captiva le cœur du poète de 32 ans, Rubén Darío, et fut, jusqu’à la mort du grand hispano-américain ou, tout au moins jusqu’à son dernier voyage en Amérique en 1914, la fidèle compagne qu’il immortalisa dans ces vers de «Los años de Mundial»:
à l’heure sûre;
…………………………….
Francisca Sánchez
accompagne-moi»;
vers signés, précisément à Paris le 21 février 1914 et que nous répétons aujourd’hui remplis d’émotion.
Dans la revue «Cuadernos Hispanoamericanos» du mois de mars 1963, Oscar Echeverría et, dans le numéro de juillet, Irina Darlée, ont évoqué le souvenir de cette femme qui fut si intimement liée à la vie de Rubén Darío et dont le nom appartient aujourd’hui à l’histoire des lettres hispano-américaines.
Irina Darlée, dans un luxe de détails, nous rapporte sa visite, à l’hôpital San Juan de Dios de Madrid, «à la fidèle castillane de Rubén Darío, une après-midi de dimanche ensoleillée». Elle la trouva alors: «seule, vêtue d’une robe noire et coiffée d’un foulard blanc, selon l’usage des vieilles paysannes de Castille» et dans un dialogue simple, très savoureux, elle nous rappelle cette «femme qui a inspiré les vers les plus sublimes de Rubén Darío et lui a laissé plusieurs enfants». Déjà à 88 ans, à la veille de sa mort, elle évoque la figure du poète aimé et elle confesse simplement: «Il apparaît toujours, toujours, partout où je vais. Depuis le premier jour où je l’ai connu, nos deux âmes furent une…» Et la vieille femme admirable pleure avec de tels souvenirs.
Nous savons que Francisca Sánchez s’est mariée après la mort de Rubén Darío. Rappelant ce qu’elle appelle ses deux «mariages», elle dit: «La première fois m’a apporté l’amour, le cœur. La seconde fois, la religion… J’ai hérité de Rubén la poésie, de mon autre mari, la Sainte Croix».
Echeverría dans son bel article: «Francisca Sánchez o la éternidad del amor» se réfère aussi, en premier lieu, à sa visite du «Séminaire-Archives» du poète, à Madrid, où son directeur, Antonio Oliver Belmás, qui a publié dernièrement son livre: Este otro Rubén Darío (Editorial Aedos; Barcelona, 1960) est la «fervente sentinelle de la mémoire» de Rubén Darío. Ensuite Echeverría nous relate sa visite, le 30 mars 1963, à Francisca Sánchez. Il nous dépeint l’ambiance qui l’entoure et le vif souvenir qu’elle gardait de Rubén Darío, dont «elle parlait comme si elle l’avait dans ses bras et, jusqu’à un certain point, elle croyait être encore le guide envoyé par Dieu sur mon sentier…»
En révélant aujourd’hui pour les lettres équatoriennes le nom d’une Française qui a sa place aux côtés de Francisca Sánchez, je veux dans cet article répondre affirmativement à Oscar Echeverría. Je n’ai pas rappelé en vain – peut-être avec un excès de détails – la figure de la fidèle castillane qui adoucit les heures amères, les jours gris du poète de «Azul», aujourd’hui que j’ai le privilège de découvrir le nom d’Augustine-Catherine Contoux qui sans doute calma aussi l’âpreté des heures, des longues journées d’exil, jusqu’à la mort, de Juan Montalvo.
Augustine-Catherine Contoux fut la jeune Française qui dut captiver le cœur de Juan Montalvo; qui l’accompagna pleine d’attentions et qui lui donna encore la joie d’avoir une descendance, à Paris, à lui qui aimait tant les enfants (n’oublions pas ces pages admirables: «les enfants sont sur la terre ce que les étoiles sont au ciel: innocents, purs brillants. La maison où il n’y a pas d’enfants est triste, solitaire, presque lugubre…»). Elle l’accompagna finalement jusqu’à ses derniers moments et, après la mort de Montalvo en 1889, à la différence de Francisca Sánchez, elle ne pensa plus à créer un nouveau foyer, durant les longues soixante années qui suivirent, au cours desquelles elle garda fidèlement le souvenir de celui qui fut, peut-être, l’unique amour de sa vie, jusqu’à sa mort en 1949, à 91 ans.
Après m’être occupé du fils de Juan Montalvo, dans mon article du 1er. mars dernier, il est normal que je me réfère à cette noble femme, dont le nom a été ignoré en Équateur.
J’ai entre mes mains l’extrait de l’acte de naissance de madame Contoux, grâce à la gentillesse du maire de Garnat-sur-Engièvre, petit village du département de l’Allier, au centre de la France. La traduction dudit document est la suivante: «Année 1858 – Acte N° 24 – Le dix-sept octobre mille huit cent cinquante-huit, naquit dans le village Augustine Catherine Contoux, de sexe féminin, de François Contoux tailleur et de Marie Reverdy, son épouse, domiciliés dans le village de cette commune. – Mention marginale: Morte à Paris, 10, le 6 janvier 1949. Extrait conforme au registre, délivré à la Mairie, le deux mars mille neuf cent soixante-quatre…»
Personne mieux que son fils Jean, qui, comme nous le verrons ensuite, l’accompagna jusqu’à ses derniers jours, ne pourra nous donner des détails sur la vie de sa mère. Je le citerai ci-après. Dans une lettre du 28 novembre, il m’a envoyé une note de laquelle j’extrais ces lignes: «Ma mère, née le 17 octobre 1858 à Garnat (Allier) mourut en 1949, à Paris chez moi, 104 rue du Faubourg Poissonnière. Elle était dans ses 91 ans. Ses obsèques furent célébrées à l’église Saint Vincent de Paul et l’inhumation eut lieu au cimetière de Pantin».
«Après la mort de mon père, elle dut, très vite, se mettre à travailler dans son ancien métier de couturière, parfois péniblement, parce qu’à cette époque, les avantages sociaux n’existaient pas. Elle put, cependant, non sans difficultés, me permettre de poursuivre des études aidée de temps en temps, jusqu’à mes quinze ans, par des Équatoriens de Paris: Víctor Manuel Rendón, les frères Seminario, Carlos Winter, Consul général à Paris, en 1900; Angel Miguel Carbo, son successeur, et, quand il venait en France, monsieur Agustín Yeroví… Dès que le journalisme me procura quelques gains, je l’aidai. Plus tard après mon mariage, je continuai à le faire dans la mesure du possible. Ce ne fut qu’en 1927, alors qu’elle était déjà très fatiguée, qu’elle consentit à venir vivre dans mon foyer, où elle se rendait toujours utile. Jusqu’à ses derniers jours, sa vue lui permettait de lire, d’écrire et de coudre sans lunettes. Elle avait conservé une excellente mémoire et gardé vivant le souvenir des années passées avec mon père, mais elle n’aimait pas en parler».
«À proprement parler, elle ne mourut pas de maladie. Elle était fatiguée de l’existence et elle ne voulait plus vivre. Elle avait supporté trois guerres: celle de 1870-71, avec le siège de Paris et la Commune; celle de 1914-1918, durant laquelle je fus mobilisé; celle de 1939-45, avec l’exode, où la voiture dans laquelle elle se trouvait avec mon épouse fut bombardée sur la route. Et elle craignait encore une quatrième guerre…»
«Comme beaucoup de vieux, elle ne pouvait pas s’adapter aux conditions de vie après la guerre et, surtout, à l’augmentation constante des prix. Pendant ses derniers mois, elle s’alimentait à peine; mais elle ne resta au lit que quatre jours, prise d’une congestion pulmonaire. Sa fin, cependant, fut paisible grâce à notre médecin. Elle n’eut pas d’agonie et elle cessa de respirer tranquillement».
Les années ont passé. Je me suis référé dernièrement au soixante-quinzième anniversaire de la mort de Juan Montalvo, et soixante ans après à celle d’Augustine Catherine Contoux. Le temps et la distance séparent ces deux tombes. Sur celle de l’illustre Ambaténien, comme l’avait dit Hugo en une autre occasion: «Se dresse la gloire, astre tardif» et j’ajouterai, sur la tombe du cimetière populaire de Pantin: «le temps dort immobile»…
J’ai opportunément mentionné que la vie de notre illustre compatriote à Paris n’est pas encore bien connue. Et il me paraît presque incompréhensible que des écrivains équatoriens de valeur qui résidèrent dans cette ville aient manifesté si peu d’enthousiasme pour éclaircir plusieurs points de cette biographie.
Quelle est, par exemple, la qualité et la quantité de sa collaboration au «Figaro»? Ce sont quelques-uns des thèmes qui occuperont mes prochaines recherches.
Je crois que la publication de tous ces documents servira à une meilleure connaissance de l’œuvre de Juan Montalvo. Nous souvenant d’une belle pensée de Madame de Stael, désireux d’éclaircir la biographie d’une personnalité aussi brillante qui se détache par: «la supériorité de l’esprit et de l’âme… et parce que tout comprendre rend très indulgent et que sentir en profondeur inspire une grande bonté…», j’ai présenté aujourd’hui des sujets qui appartiennent exclusivement à sa vie privée, – laquelle mérite tout notre respect et notre compréhension.
Paris, 25 mars 1964
(Tiré de «El Comercio») – Année LIX Numéro 21 741, Quito, Equateur, dimanche 12 avril 1964.
* Nous remercions très chaleureusement Mme. Nicole Fourtané d’avoir traduit cet article.
Vigie de la Tour Eiffel
Ma première rencontre avec le fils de Juan Montalvo à Paris*
Par A. Darío Lara
Dès que mon contact avec Jean Contoux-Montalvo fut établi, grâce à sa réponse à ma première lettre du 25 septembre 1963, comme je l’ai raconté dans mon article de «El Comercio» du 20 octobre, je rêvais de le rencontrer le plus vite possible. Le docteur Luis Jaramillo, alors Chargé d’Affaires de l’Équateur à Paris, me manifesta très généreusement qu’il invitait avec plaisir Jean Contoux-Montalvo à venir quelques jours à Paris.
L’invitation transmise dans ma lettre du 4 octobre fut immédiatement acceptée et le voyage à Paris fixé du 22 au 30 décembre, à l’occasion des vacances de Noël. La rigueur de l’hiver, d’abord, la santé précaire de son épouse, ensuite, firent que cette date fût repoussée au printemps.
La journée était splendide et un soleil resplendissant répandait à merveille, sur la ville transfigurée, les premiers enchantements du printemps nouveau, enfin de retour. Comme l’heure du déjeuner approchait, le docteur Jaramillo nous invita au restaurant pour l’apéritif. En bon habitant de la Côte d’Azur, Jean demanda, et nous l’imitâmes, le «pastis» aromatisé, délice des jours d’été.
Nous sommes installés maintenant au dernier étage de l’UNESCO, dominant la région nord-ouest de la ville, où se détachent depuis l’Arc de Triomphe jusqu’à la Basilique de Montmartre, là, à nos pieds, à côté de la Tour Eiffel, l’École Militaire… Ceci suffit pour raviver les souvenirs de ses années de soldat, pendant la guerre de 1914/1918, qui, pour lui, dura jusqu’en 1919. Ennemi de la guerre par tempérament et par conviction, il fut obligé de porter l’uniforme militaire. Dans son essai d’ «autobiographie», il note: «Mobilisé, affecté au service auxiliaire, je fis la guerre sans grands risques et sans gloire. Je fus démobilisé en 1919 avec le grade de sous-lieutenant et en qualité de chef du secteur de la Reconstruction Industrielle, pour le département du Pas-de-Calais». Ce qui ne l’empêcha pas d’aller finir dans une armée du Proche-Orient, où la malaria le mena au bord de la mort, mais quelques «louis» lui avaient permis de payer une petite barque qui l’avait conduit en Grèce, puis à Malte, jusqu’à son pays natal.
Il consacra le dimanche 5 à ses parents parisiens. Le lundi 6, nous pûmes converser longuement, tout l’après-midi, en nous promenant de la Madeleine aux Champs Élysées. Alors je pus éclaircir plusieurs points qui m’intéressaient spécialement, confirmer plusieurs faits obscurs de sa biographie, de la vie de sa mère, de la vie de Juan Montalvo, à Paris. Nous consacrâmes le mardi 7 à la visite des lieux fréquentés par Montalvo dans cette capitale: la maison où il mourut; le buste de la Place de Champerret et nous refîmes la promenade que don Juan faisait tous les jours de la rue Cardinet, au parc Monceau, aux grands Boulevards, à l’Opéra… Pour Jean, le parc Monceau fait revivre son enfance: il venait là, comme beaucoup d’enfants parisiens, en compagnie de sa mère, de son père ou de la domestique et, dans le lointain, il évoque ses jeux enfantins d’alors. Il ne peut pas oublier, à l’heure du déjeuner, son père de retour de sa promenade, «toujours avec quelque chose, quelque cadeau dans les mains; il ne rentrait jamais les mains vides», affirme Jean.
Ce même jour, 7 avril, j’eus la chance de l’avoir parmi les miens. «J’avais l’impression, m’écrira-t-il ensuite en se remémorant ces heures, d’être avec des amis de longue date».
Si je devais offrir un résumé de nos conversations, en révisant mes notes, prises jour après jour, je les regrouperais dans les paragraphes suivants: les souvenirs que Jean conserve de ses parents; les souvenirs autobiographiques; les relations de sa mère et de Jean avec les Équatoriens; les documents authentiques qui confirment ces affirmations.
Il ne faut pas oublier la période terrible et elle dura après la mort de son père. La situation fut très difficile pour sa mère; pour Jean, elle signifia l’angoisse de ne pas pouvoir achever ses études, comme il l’aurait désiré. Après avoir obtenu son baccalauréat, il continua à la Faculté de Droit, mais il ne put pas terminer sa formation, en raison de l’urgence de travailler pour gagner le pain des siens. Ici s’ouvre le chapitre très important des relations de sa mère et de Jean avec les Équatoriens résidant à Paris. Dans notre correspondance, Jean m’a déjà rapporté, plus d’une fois, des données précieuses. Les noms qui reviennent alors sont: les frères Seminario, Agustín Yerovi, Víctor Manuel Rendón, Carlos Winter (ce dernier, me dira Jean en passant devant la maison où il vécut, «m’habilla de pied en cap pour ma Première Communion en 1900»). Miguel Angel Carbo, E. Dorn y de Alsúa, Olmedo Alfaro… lesquels manifestèrent un intérêt digne de tout éloge pour la veuve et l’orphelin de l’écrivain équatorien.
Paris, 28 avril 1964.
* Nous remercions très chaleureusement Mlle. Catherine Lara d’avoir traduit cet article.
Vigie de la Tour Eiffel
Recherche dans les archives du fils de Juan Montalvo
Par Dario Lara
Tel qu’accordé alors, je souhaite présenter rapidement aujourd’hui quelques-uns de ces documents qui s’avèrent confirmer la filiation de Jean Contoux Montalvo. Mon intention n’est naturellement pas de revenir ici sur tout le processus qui m’a amené à découvrir puis à me convaincre d’une telle filiation; l’espace limité propre à une chronique ne me le permettrait d’ailleurs pas. Dans mon article du 20 octobre 1963, je donnai brièvement une idée de l’aventure. Tout cela sera étudié en profondeur dans un travail à venir qui complètera la bibliographie relative à la vie de Juan Montalvo en France, encore peu connue, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le signaler.
Il s’agit, en premier lieu, d’une lettre de Juan Montalvo à son frère Francisco. Nous sommes le 22 août 1888, moins de cinq mois avant la mort de Juan Montalvo. Sa santé est gravement atteinte ; alité, il dicte une lettre adressée à son frère Pancho. Augustine Contoux, qui lui tient lieu de secrétaire, a gardé une copie de cette lettre écrite de la main de l’auteur. À ne pas s’y méprendre, le style est celui du grand écrivain. Nous y lisons des détails au sujet de sa maladie (durée, caractéristiques): «Mon cher Pancho: j’ai reçu la lettre que tu m’as écrite, après avoir appris ma maladie. Je l’attendais, et je l’ai lue avec tendresse. Ma santé n’a pas été mauvaise au cours de ces sept dernières années passées à Paris: bien au contraire. Mais le dernier hiver fut si exceptionnel et terrible, que j’y ai payé tout mon dû… Après six mois de grandes souffrances, je me trouve encore entre les mains d’un médecin». Vient ensuite cette phrase célèbre que nous connaissons tous: » Cette longue période de douleur durant, ni Dieu ni les hommes ne m’ont fait défaut» (3).
Cette lettre nous donne en outre deux informations supplémentaires. Poursuivons-en la lecture: «Je suis si faible, que je peux à peine dicter ces quatre lignes. Trois mois de fièvre et d’anéantissement auraient suffi à m’achever si ce n’était du fait de la présence de celle qui est mon ange gardien. Après avoir vécu six ans en famille, elle m’a sauvé la vie trois fois par amour pour moi, et m’a donné Juanito, de deux ans…» Ceci prouve tout simplement que Juan Montalvo connut Augustine Contoux vers 1882, d’après l’hypothèse que je formulais dans ma chronique du 12 avril dernier. Nous savons d’autre part que Jean naquit le 17 octobre 1886.
Dans la même lettre à son frère, Juan Montalvo multiplie les louanges: «présence de celle qui est mon ange gardien» ; auparavant, il manifestait encore: «pour cette femme si admirable… elle m’a sauvé la vie à force de nuits blanches et grâce à sa vigilance». À la fin de sa lettre (troisième page), Augustine Contoux rajoute à son compte un paragraphe à l’attention de «Monsieur Montalvo». Je traduis ces lignes, écrites en français. «C’est que ce que je fais est très naturel car comme mon pauvre ami vous le dit, il est père de mon fils Jean et je l’aime donc je n’ai aucun mérite à le faire (…) «.
S’en suivent deux lettres de Francisco Montalvo à Augustine Contoux. La première date du 20 février 1890; il s’agit d’une réponse à une lettre d’Augustine Contoux. La lettre en question fait référence aux démarches menées par Agustín Yerovi pour mener à bien la publication des oeuvres de Juan Montalvo et ainsi venir en aide au petit Jean, qu’il pense par ailleurs emmener en Équateur afin qu’il y soit élevé par la famille paternelle.
En réponse à la lettre de Mme. Contoux, M. Montalvo manifeste que «si sa situation n’était pas aussi malheureuse, il aurait protégé cet enfant coûte que coûte, de la même façon qu’il le fit avec son frère dès que cela lui fut possible…»
Auparavant, Madame Contoux lui avait écrit deux lettres, toujours inspirées par le même motif: demander une aide pour l’éducation de Jean. Les raisons invoquées par M. Montalvo pour justifier son refus sont immuables. Tout en lui assurant néanmoins qu’il «…n’y a pas eu de malentendu, chère madame; ce qu’il y a, c’est une incapacité qui échoue à vaincre la volonté…». La lettre est naturellement pessimiste, puisqu’elle annonce le terme des espoirs du voyage de César en Europe. En outre: «La fille légitime que Juan a laissé ici réclame ses droits sur les écrits de son père, ce qui nous empêche de mener à bien quelque projet que ce soit par rapport à leur publication. Il n’y a rien que je puisse faire pour cet enfant, je vous le répète».
Nous savons que plus tard, César ira à Paris avec une commission de M. Yerovi. Sa fin tragique dans un hôtel de la rue du Faubourg-Montmartre et l’échec de sa mission ont également mis fin aux espoirs de Madame Contoux de recevoir une aide quelconque pour l’éducation de son fils; ce fut-là la raison principale du terme à ses relations avec l´Équateur. Ainsi que l’écrira Jean cinquante ans plus tard: «Ce fut suite à cet incident que ma mère refusa d’entendre quoi que ce soit du passé, et s’abstint de demander quoi que ce soit à qui ce soit, pas même pour me permettre de poursuivre mes études».
Je laisse pour une prochaine chronique le commentaire d’autres lettres adressées à Madame Contoux par M. Agustín Yeroví, Víctor Manuel Rendón, M. Seminario, ainsi que la lettre d’un Ministre des Affaires Étrangères Équatoriennes, qui souligne le traitement stupéfiant auquel eurent droit Madame Contoux et le fils de Juan Montalvo de la part des «libéraux de 1900». Un Président de la République à qui Jean écrivit beaucoup plus tard ne fit guère mieux…
Paris, mai 1964
NOTES :
Vigie de la Tour Eiffel
Révélations dans les Archives du fils de Juan Montalvo
Par Darío Lara
En guise de confirmation des propos du frère de Juan Montalvo, Yerovi affirme que: «… l’intention de M. Francisco est d’envoyer son fils César Montalvo, afin qu’il participe à la correction des épreuves». Avant de renchérir : «Ce serait César lui-même qui se chargerait de ramener l’enfant…».
J’ai évoqué ailleurs l’aide constamment apportée par les frères Miguel et Ezequiel Seminario à la famille de Juan Montalvo. Le 6 août 1900, à Paris, un des deux frères Seminario (l’emploi d’une seule initiale ne permet guère d’être plus précis au sujet de son identité), écrit à Madame Contoux et lui demande de préparer Jean «… qui m’a dit que vous consentiriez à le laisser passer deux mois de vacances à Joinville-le-Pont».
Pour la décoration du Pavillon de l’Équateur, ce furent les bustes de Olmedo, Montalvo et Alfaro qui furent choisis. Le 6 novembre 1899 (4), M. Rendón écrit à Madame Contoux, 75 Avenue Ledru Rollin (elle a quitté, nous le savons, la rue Cardinet) «… afin d’accuser réception de sa lettre d’hier où elle m’envoie, sur demande, les portraits de Juan Montalvo en sa possession». Il rajoute: «Je n’ai gardé qu’un portrait et vous rend l’autre avec votre fils».
Ces affirmations catégoriques, -auxquelles se joignent d’autres commentaires de nature semblable-, sont une preuve manifeste de l’énorme intérêt porté à Madame Augustine Contoux et son fils Jean par ces équatoriens de renom: Agustín Yerovi, Víctor Manuel Rendón, Carlos Winter, Miguel Ángle Carbo, les frères Seminario, ainsi que me le rappelait également Jean lui-même dans sa lettre du 27 janvier dernier. Lors de son voyage à Paris, il se remémorait ces noms avec gratitude, comme ceux d’amis bienveillants qui diminuèrent pour beaucoup les souffrances de sa mère et l’aidèrent dans son éducation. À propos des frères Seminario: «… ils me recevaient régulièrement et me remettaient des petites sommes d’argent pour ma mère, afin de contribuer aux frais de mes études et mes besoins matériels. Agustín Yerovi en faisait de même lors de chacun de ses voyages en France», écrit Jean dans des documents autobiographiques.
La lecture de ces quelques lignes d’un des «philosophes et maîtres de la révolution de 1895» ne peut que nous en faire admirer la logique des convictions: «Je me vois dans l’obligation de vous manifester que mon gouvernement déplore très sincèrement ne pouvoir protéger votre fils comme vous le demandez, car ce dernier ne porte pas même le nom de son père…» Et après une telle infamie : («… mon gouvernement déplore très sincèrement ne pouvoir protéger votre fils comme vous le demandez»), la dernière phrase protocolaire de la lettre du Ministre -«Je reste Madame, votre fidèle et dévoué serviteur …»-, a sans aucun doute profondément aigri une femme déjà désemparée et angoissée qui, tel que le notera plus tard son fils Jean, décida alors de rompre pour toujours tout contact avec notre pays et ses représentants officiels, qu’elle avait jusque là considérés comme des amis de Juan Montalvo.
Pour conclure cette chronique, je me référerai finalement à plusieurs photographies que Jean m’a remises. On y trouve la photo de Juan Montalvo qui servit de modèle au buste mentionné plus haut. Parmi les autres, deux se distinguent tout particulièrement: il s’agit de celle de la Première Communion de Jean, et celle de son portrait en tenue militaire, prise en 1914. Plusieurs équatoriens à qui je les ai montrées ont été profondément frappés par les traits de cet enfant de 14 ans ou de ce jeune homme de 28 ans, qui ne sont pas sans rappeler le Cervantes Américain; ce sont aujourd’hui ceux d’un vieillard de 78 ans, qui espère pouvoir un jour se rendre sur la tombe de son père à Ambato.
NOTES
Le même mois, le 2 mars plus exactement, M. Rendón écrit au Ministre des Affaires Étrangères, José Peralta: «Les bustes de Olmedo et Montalvo tout juste terminés par M. Michelet sont splendides. Je lui ai confié la réalisation du buste du Président de la République sur le champ; elle doit figurer auprès du mur central du Pavillon, ainsi qu’en usent toutes les Nations avec leurs chefs d’État…».
Ces bustes de Olmedo, Montalvo et Alfaro se trouvent encore dans les bureaux de l’Ambassade de l’Équateur à Paris. Lors de sa visite à l’ambassade en avril dernier, Jean reconnut le buste de son père et nous donna tous les détails du portrait historique qu’il achemina lui-même, ainsi que de la place occupée par ce buste au sein du Pavillon de l’Équateur, où, alors âgé de 14 ans, il se rendait presque tous les jours afin d’y rencontrer ses amis équatoriens.
(5) Miguel Angel Carbo, Consul Général de l’Équateur à Paris.
Après les articles, les livres et les conférences de Darío Lara sur la descendance parisienne de Juan Montalvo, nous reproduisons ici, en langue française, son dernier entretien avec Yolande Simard sur des aspects très intéressants de la vie et de la personnalité d’Augustine Contoux et de Jean Contoux-Montalvo.
Entretien avec Mme. Yolande Simard et son fils Jean-Jacques Curtet-Simard*
Par A. Darío Lara
Deux témoignages, c’est de l’Histoire».
(André Malraux)
Avant mon voyage à Ambato en vue du Colloque à l’occasion des 150 ans de la naissance de Juan Montalvo en 1982, je pris contact avec Yolande SIMARD, fille de Louise-Susanne Contoux et Émile SIMARD, sœur de Robert SIMARD, à l’origine de mes relations avec Jean CONTOUX-MONTALVO, le fils français de Juan Montalvo.
Malgré l’imminence de ses 80 ans, Yolande nous donna d’emblée l’impression de se trouver en bonne santé. Entre midi et demie et une heure et demie de l’après-midi, une longue conversation s’en suivit dans le bureau; celle-ci se prolongea au cours d’un déjeuner convivial auquel nous fûmes invités par Claude Lara. Au cours de cette agréable rencontre, il nous fut donné d’éclaircir plusieurs aspects et données rattachés à la vie et la personnalité d’Augustine Contoux et de Jean Contoux-Montalvo.
Yolande Simard connut intimement Augustine Contoux, car à la mort de sa propre mère -Louise-Suzanne Contoux, demi-soeur de Jean-Contoux Montalvo- survenue alors qu’elle n’avait que dix ans, son enfance et son éducation furent placés sous la vigilance et les bons soins de celle qui fut sa grand-mère maternelle, qu’elle accompagna pratiquement jusqu’à la mort de cette dernière, en 1949, alors qu’Augustine avait 91 ans. Yolande nous présente sa grand-mère comme une femme au grand cœur, extrêmement douce, et dotée d’une intelligence clairvoyante, toujours soucieuse du bien-être des siens. Elle parlait souvent de Juan Montalvo, dont elle reconnaissait l’immense valeur d’écrivain, confirmée à ses yeux par ses relations avec des personnalités de l’époque. Elle nous cite les noms de Victor Hugo, Edmond Rostand, Manuel María de Peralta, ainsi que ceux de plusieurs équatoriens; propos qui, pour ne citer que quelques exemples, ratifient à leur tour les affirmations de Jean Contoux-Montalvo dans ses lettres du 28 novembre 1963, du 27 janvier 1964 ou du 29 septembre 1964 (Tome I de Juan Montalvo en París).
En ce qui concerne sa vie familiale et quotidienne, Yolande est formelle: bien que Juan Montalvo et Augustine Contoux ne fussent pas d’une grande richesse, ils étaient loin d’être dans le besoin, tel que l’ont prétendu certains biographes. Il est flagrant qu’Augustine n’avait rien d’une «domestique», ainsi que certains chroniqueurs mal informés ont voulu nous le faire croire. Son appartement rue Cardinet, situé dans un quartier agréable de Paris, était tout à fait correct; ils avaient une personne à leur service, -ainsi que nous le rappelle Yolande-, ce qui corrobore là encore les nombreux propos de Jean Contoux-Montalvo à ce sujet. De la même façon, nous savons que par son père, «tailleur d’habits» [en français dans le texte, ndt], Augustine était rattachée aux ateliers de tapisserie du Centre de la France, et bénéficiait d’un statut prestigieux; sa grand-mère travaillait avec son père et confectionnait des robes d’un goût raffiné. Nous en avons un témoignage très clair dans la lettre du 28 novembre 1882 que lui adressa M. Agustin Yerovi depuis Guayaquil, où il la remercie pour les vêtements qu’il lui a confiés pour ses filles, dont il est satisfait et au sujet desquelles il signale qu'»elles les leur vont très bien».
Fait curieux qu’il conviendrait d’élucider, le nom de famille de la mère d’Augustine était Reverdy; nom prestigieux qui évoque celui d’un grand poète surréaliste, Pierre Reverdy (1889-1960). Existe-t-il un lien de parenté qui expliquerait par ailleurs le penchant d’Augustine pour les lettres? Nous n’en avons pas la certitude, mais il serait possible de mener des recherches dans ce sens.
Curieusement, Yolande apprit par Augustine cet épisode évoqué par Jean Contoux-Montalvo au sujet du neveu de Juan Montalvo, qui alla à Paris avec la mission de remettre une somme d’argent à ses proches provenant des droits d’auteur de l’écrivain équatorien. Mais nous savons que cet émissaire, César Montalvo, ne remplit pas sa mission. À Paris, il se consacra aux jeux de hasard, il dilapida la somme en question et finalement se suicida. Jean Contoux-Montalvo parle d’un montant de 15.000 francs de l’époque et rajoute: «c’était une somme considérable pour l’époque puisque le salaire journalier du Français moyen était alors de 5 francs au maximum», (lettre du 13 décembre 1968). Il rajoute plus loin que suite à cet incident, sa mère ne voulut plus garder aucun contact avec l’Équateur.
Si les informations que nous fournit Yolande Simard attirent notre attention au sujet d’Augustine Contoux, sa grand-mère, sur ses parents Émile Simard et Louise-Suzanne Contoux, celles qui concernent Eveline Micheline Jeanne Contoux, fille de Jean Contoux-Montalvo et de sa première épouse Gilberta-Luise Ledain, la seule petite-fille de Juan Montalvo, qui décéda à Bruxelles vers 1979, nous intéressent tout autant. Cependant, les informations concernant l’oncle de Yolande, Jean Contoux-Montalvo, revêtent pour nous une importance toute particulière.
JEAN CONTOUX-MONTALVO
Les exigences pressantes du foyer l’obligèrent à abandonner ses études universitaires et l’orientèrent vers une vocation précoce dans le journalisme. «Je m’orientai donc -écrit-il-, vers le journalisme et réussis, je ne sais trop comment, à me faire accepter à la rédaction du vieux quotidien sportif LE VÉLO, où j’appris les rudiments du métier» (Id., p. 246). D’après le témoignage de Yolande, tous ses proches étaient au courant du travail journalistique actif de leur oncle, et elle nous rappelle aujourd’hui les titres de quelques-uns des journaux dont il fut le collaborateur, ainsi que d’autres dans lesquels il fut rédacteur en chef. Titres qui coïncident avec plusieurs de ceux que Jean Contoux-Montalvo mentionne dans sa lettre: LE SOIR, LE JOURNAL, LE LITTORAL, ÈVE, MINERVE, LE MUSCLE, ETC.
Hélas, il fut impossible de récupérer ces cartons, du fait de la négligence de ceux qui -malgré maintes déclarations et invitations-, n’ont pas rempli leurs engagements envers Jean Contoux-Montalvo. Après sa mort, le 9 décembre 1969, dans une lettre du 10 mai 1970, son épouse Suzanne Contoux m’écrit «il y a plusieurs cartons de livres dans le garde-meubles. Je dois les examiner cet été avec l’aide de ma nièce, et c’est avec un grand plaisir que je vous écrirai si nous trouvons des choses intéressantes…». Au cours de mon entretien avec Yolande Simard en septembre 1981, elle me confirma les faits, tout en rajoutant qu’à la mort de Suzanne Contoux, en 1974, «ces cartons passèrent à une nièce, s’ils ne sont pas restés dans l’entrepôt» dont parle Jean Contoux-Montalvo dans la lettre citée précédemment. Dans un autre entretien que j’eus avec Yolande Simard le 25 mars 1982 (et où elle me remit des documents de grande valeur que lui avait confiées Suzanne Contoux, ainsi que je le rappelai dans la conférence que je dictai à Ambato le 6 avril de la même année (2), elle me confirma une fois encore qu’une de ses nièces conservait les cartons évoqués par Jean Contoux-Montalvo. Aujourd’hui, 1er février 1995, aussi bien Yolande que son fils Jean-Jacques nous proposent de mener à bien de nouvelles démarches afin de voir si l’on parvient enfin à récupérer de si précieux documents.
Suite aux informations rapportées par Yolande Simard, il convient que je résume également les impressions que nous a confiées son fils Jean-Jacques Curtet-Simard au sujet de ces deux personnages. Enfant, il vécut avec sa mère auprès d’Augustine Contoux, son arrière-grand-mère et Jean Contoux-Montalvo son grand-oncle, ce qui lui permit d’apprécier et de confirmer les qualités mises en avant par sa mère. Plus tard, déjà adolescent, jeune, il passa souvent ses vacances à Cannes, chez Jean; il garde des souvenirs bien précis de ces années, qu’il évoque en des termes extrêmement élogieux envers le fils de Juan Montalvo et son épouse, Suzanne Contoux, femme très distinguée, tel qu’en attestent ses racines familiales nobles et son grand talent artistique (elle était diplômée du Conservatoire de Paris et fut professeur de piano pendant de longues années).
Quoiqu’il en soit, et ainsi que le rappelle aussi Claude dans la Présentation de son Este otro Montalvo, je suis en mesure de ratifier les lignes que j’écrivis en fin de conclusion de l’ouvrage Juan Montalvo en París: «… par son éducation, sa culture, cet enfant naturel était bien loin d’être indigne du lien de parenté qui le rattachait à l’illustre enfant d’Ambato; et bien au contraire, malgré les hasards du sang, il fut le fils digne du défunt immortel» (p. 103).
Grâce à Yolande Simard et à son fils Jean-Jacques, les deux Équatoriens que nous sommes essayons de maintenir vivant ce lien infime qui nous unit à la famille française de Juan Montalvo; nous nous soucions en outre de la connaissance à Paris du fils immortel d’Ambato, mais aussi de celle de son fils, Jean Contoux-Montalvo en Équateur. Ainsi, après de longues années de recherche, après avoir recueillit non pas un ou deux, mais plusieurs témoignages, nous pouvons, -à la suite de Malraux-, réaffirmer avec certitude que tout ce qui a été affirmé c’est de l’Histoire.
Paris, mars 1995
Notes: