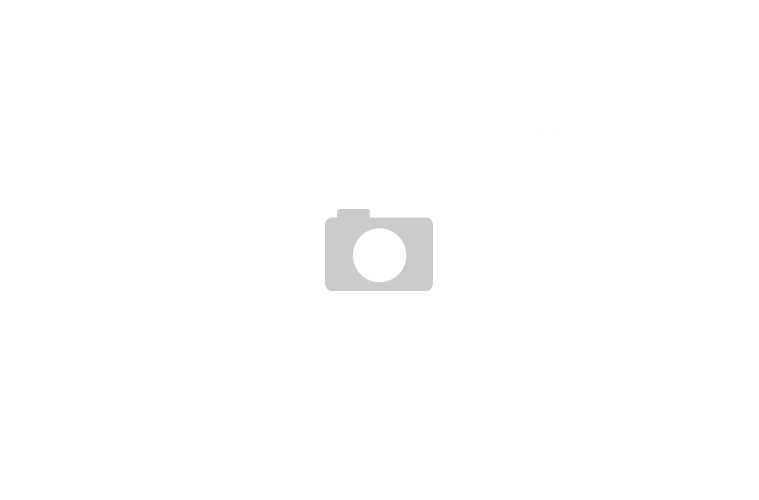Le livre de Víctor Manuel Rendón Olmedo; homme d’État et poète américain, chantre de Bolívar, publié à Paris en 1904 (2), est selon le grand homme de culture, le jésuite Aurelio Espinosa Pólit «le plus grand effort littéraire réalisé par un diplomate équatorien à l’étranger» (3).
Cependant l’œuvre de Víctor Manuel Rendón Pérez -Ministre Plénipotentiaire de l’Équateur en France et en Espagne de 1903 à 1914, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, écrivain (4) et traducteur- reste bien méconnue. Pour cette raison, en transcrivant sur notre blog, en plusieurs parties, ses traductions poétiques -publiées dans son livre sur Olmedo, ce très grand poète équatorien (5),- nous voulons lui rendre un hommage tout particulier, en présentant ainsi cette production:
«La victoire de Junin, Hymne à Bolivar, a consacré la célébrité d’Olmedo en Amérique et immortalisé son nom de poète» écrivit si bien Víctor Manuel Rendón (6). Pour introduire ce chant épique de 909 vers, (7) entièrement traduit en alexandrins par notre traducteur, nous commencerons par reproduire sa «Genèse», ensuite les traductions: des lettres de José Joaquín Olmedo à Simón Bolívar, «la victoire de Junin, Hymne à Bolivar», les réponses du Libérateur et, finalement, les répliques d’Olmedo.
(1) Aurelio Espinosa Pólit: José Joaquín Olmedo: Poesía-Prosa, Quito-Ecuador, Biblioteca Ecuatoriana Mínima. Editorial J.M. Cajica JR. S.A. Puebla-México, 1960; page 45.
(2) Cependant il faut prendre en compte cette indication: «This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring is back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation of process, and hope you enjoy this valuable book”. Olmedo; homme d’État et poète américain, chantre de Bolívar, imprimé le 24 mai 1904 par Buissière, Sain-Amand, 1904.
(4) Son roman Lorenzo Cilda, publié au Journal des Débats, a reçu le Prix de l’Académie Française, in: «À la Mémoire du Général Clavery, quatre sonnets» par Dr. Victor-Manuel Rendon, Le Vésinet, imprimerie Ch. Brande, 1938; p. 12.
(6) Idem note 2; page 108.
***
Le nom de Bolivar était, depuis longtemps déjà, le symbole de la liberté en Amérique lorsqu’il remporta au Pérou, le 6 août 1824, la victoire de Junin. Le succès de cette terrible charge de cavalerie qui, fauchant à l’arme blanche, sabre ou lance, des milliers d’ennemis supérieurs toujours en nombre, était commandée par Bolívar en personne, donna lieu à des manifestations de joie immense sur tout le continent américain. Olmedo, qui était l’admirateur passionné du héros et qui avait autant d’attachement que de reconnaissance pour le pays où s’était écoulée sa jeunesse d’étudiant, sentit son cœur bondir à la nouvelle de ce triomphe qui présageait la liberté prochaine du Pérou. Débordant d’enthousiasme, dans un grand élan d’inspiration, il traça sur le papier les premières strophes de son célèbre chant. Mais, esclave de ses multiples occupations quotidiennes, il voyait son travail interrompu à tout heure; aussi, n’en était-il qu’au début quand, le 9 décembre de la même année, le général Sucre remporta dans la plaine d’Ayacucho l’éclatante victoire qui lui valut le bâton de maréchal et mit fin, pour toujours, sur le continent américain, à la domination espagnole. Olmedo, de plus en plus embrasé du feu sacré, ne put arrêter désormais le jet de son génie et, se donnant tout entier à son poème, n’eut de cesse de le terminer. Au lieu d’un exploit unique il lui fallait pourtant en chanter deux et Bolívar, -«bien qu’on vit son âme reflétée sur le front du vainqueur», – comme le poète l’a dit dans ses vers, ne se trouvait pas sur le champ de bataille d’Ayacoucho. Nous verrons plus loin comment Olmedo se tira du mieux qu’il put de cet embarras, non sans honneurs, en imitant d’illustres modèles.
LETTRES D’ OLMEDO A BOLIVAR (A)
Cher Monsieur et ami très vénéré,
Maintenant, maintenant oui, je m’avoue absolument surpris, car bien que je n’aie jamais douté du succès, il fallait une inspiration divine pour prévoir un triomphe aussi complet et aussi rapide. L’effet de la surprise lui-même a rendu plus agréable la victoire.
Cette journée-là a été véritablement celle de l’Amérique, la journée de Bolivar.
Vous avez perdu tout droit de me reprocher ma liberté de parole depuis que vous avez laissé s’étaler impunément, en y applaudissant même, mes observations sur votre première proclamation datée de Pasto. La dernière, de Lima, est un des documents classiques de notre sainte révolution.
Les trois derniers mots sont dignes du marbre et du bronze. Fi donc! (1) Ils sont dignes des cœurs. Ne plus commander! (2) Expression divine, expression exhalée par une âme qui ne peut plus supporter sa propre gloire. Elle me représente l’image d’un homme qui, ayant fixé les yeux grands ouverts sur le soleil, les baissent et les ferment accablés par tant de lumière.
Entends-tu? Entends-tu? Est-ce moi qui me trompe? Quel est ce vacarme? C’est le char de la Liberté qui, triomphalement, se promène depuis les rives majestueuses de l’Orénoque jusqu’au bord le plus reculé du lac orageux où surnage l’île de Titicaca et, dans sa course, il dessine les couleurs de l’arc-en-ciel (3).
OLMEDO.
(1) Ces deux mots sont en français dans le texte original.
(3) Allusion aux couleurs, jaune, bleue et rouge du drapeau colombien, assemblées, comme nous l’avons dit par Miranda, l’immortel précurseur de Bolivar, et qui ont été conservées par le Venezuela, la Colombie et l’Equateur avec de légères modifications de largeur. Miranda sépara les couleurs jaune et rouge du drapeau espagnol par la couleur bleue qui est celle de la mer pour indiquer que celle-ci séparait à jamais le pays de l’or, du pays de la conquête.
Guayaquil, 31 janvier 1825
Je ne pensais pas vous écrire aujourd’hui, parce que je vous ai déjà dérobé beaucoup trop de temps; or, j’aimerai mieux passer pour n’importe quoi aux yeux des autres que pour un être ennuyeux. Je ne dois pas, pourtant, vous laisser languir de curiosité au sujet du nom de Simon le Castillan que je vous ai donné dans ma lettre de décembre.
Quant à vous, choisissez et dites-moi quel est le surnom qui vous sourit le plus (dans le même ordre d’idées, bien entendu). Est-ce le Gothique, le Vandale ou le Castillan ? etc. Le Péruvien, non pas, car vous n’avez pas remporté de victoire sur des Péruviens et le pays de vos triomphes n’est pas un pays lointain ou ennemi de l’Amérique…
Mais supposez, néanmoins, que j’aie voulu parler au point de vue militaire. Rien n’est perdu pour cela, car c’est une affaire que le terrain soit glissant et s’en est une tout autre que les hommes y glissent forcément. Vous savez fort bien que la glace est très glissante et, malgré cela, on y court admirablement. J’entends par là que, plus on trouve d’obstacles et de périls sur sa route, plus on a de gloire à parvenir au but. N’allez pas vous vantez tous de votre grande expérience, ni croire que le sol des galeries de Lima est aussi aisé que celui des champs de Junin et d’Ayacoucho!
J’ai à peine écrit cinquante vers; le plan en est superbe et, par cela même, je me sens impuissant à le réaliser. Ces jours derniers, l’on me demanda les paroles d’une marche qui devait être chantée dans une des fêtes par lesquelles nous avons célébré la victoire d’Ayacoucho. Cette marche je la fis à pas redoublés. Elle a paru dans le Patriote du 22 janvier et voici que j’en ai honte. Vous allez penser que je suis extrêmement ambitieux de gloire, tout en ayant l’air de la mépriser. Je ne sais pas trop si vous vous trompez…, mais mon découragement actuel provient de cette idée dont je suis intimement pénétré: que rien de vulgaire, rien de médiocre, rien de périssable ne peut convenir à ce triomphe. Je n’aime pas la gloire autant que je déteste la médiocrité. Et que vais-je répondre a celui qui me dira, après voir lu mon ode: «si tu manquais de souffle pour un tel travail, à quoi bon l’avoir entrepris? Pour en ternir l’éclat? Tu aurais mieux fait de te taire!» Que pourrai-je répondre alors, mon cher Monsieur ?
Votre respectueux ami,
(1) Allusion au début du chant (Note autographe)
Mon ami très respecté et cher Monsieur,
Par le courrier j’enverrai ma requête au gouvernement de la Colombie; mais je n’attendrai pas son acquiescement, s’il faut partir avant de recevoir la réponse; car, du moment que ces provinces sont sous vos ordres, à plus forte raison doit l’être la plus infime chose de la République: ma personne.
***
Je croyais avoir jeté l’ancre pour toujours et me voici livré à la mer. Mais, puis-je m’appartenir? Et puis, est-ce une si grande affaire de ne pouvoir disposer de moi quand, vous-même, vous ne vous appartenez pas, vous à qui la Patrie pourrait accorder la liberté que vous avez si bien méritée.
Le courrier de Lima est arrivé peu d’heures avant le moment fixé pour son départ. C’est à peine si j’ai le temps de vous adresser mes sincères remerciements pour votre souvenir et pour la bonne opinion dont vous honorez le plus respectueux et le plus dévoué de vos amis.
OLMEDO
Guayaquil, le 30 avril 1825
Cher Monsieur et ami très respecté,
J’ai pensé que cette lettre serait aussi longue que mon chant; mais cela ne peut-être, car le courrier me presse et j’ai passé mon temps à copier les vers pour tenir la promesse que je vous ai faite de vous les envoyer aujourd’hui. Dans la prochaine, je vous communiquerai toutes les réflexions qui sur moi-même me passeront par la tête. Car je ne suis pas content de mon œuvre. Je songeais à la laisser dormir un mois pour qu’elle se bonifie et la réduire de trois cents vers au moins; sa longueur étant un de ses principaux défauts. Comme vous allez-vous ennuyer!
OLMEDO
Guayaquil, le 15 mai 1825.
Cher Monsieur et ami très respecté,
Vous avez dû voir déjà l’accouchement de la montagne. Moi-même je ne suis pas satisfait de mon œuvre. Aussi, je n’ai le droit d’attendre de personne approbation ou pitié. Ce fut un vrai malheur de n’avoir pas eu pendant plus de deux mois deux jours d’isolement, de tranquillité, d’insouciance de toute chose terrestre pour habiter le séjour des esprits. L’enthousiasme qui est à chaque pas interrompu par des occupations impertinentes ne peut inspirer rien de grand, rien d’extraordinaire. Heureux celui qui dans de telles conditions ne se traîne pas terre à terre. Mais quand l’enthousiasme est soutenu et qu’il est délivré pour quelques temps de toute impression extérieure, on voit toujours arriver le moment des miracles. Dans le premier cas la Muse se met à courir à travers les vallées, à grimper sur les monts; elle explore les arbres, les lacs et les fleuves; son voyage est long et peut-être ennuyeux. Dans le second, tout le contraire, elle déploie ses ailes, prend son essor, dédaigne la terre, franchit les sommets, s’approche du soleil, ouvre les cieux et, s’il lui plaît, s’engouffre dans les enfers pour interrompre les pleurs et les tourments des damnés. Je me suis vu dans le premier cas; aussi, mon chant s’en est trouvé long et froid, ou, ce qui est pire, médiocre. Peut-être, si j’avais pu m’isoler quinze jours à la campagne, eussé-je fait davantage que pendant trois mois. J’aurais épié le moment propice et dans trois cents vers seulement j’aurais parcouru plus d’espace que je n’en ai parcouru dans mes huit cents vers. Je rends, je cède et je transmets à d’autres la part d’immortalité que je m’étais promise au début. Soyez seul triomphant.
Mon plan fut le suivant: ouvrir la scène avec une idée originale et pindarique. La Muse transportée par la victoire de Junin s’élève d’une aile rapide; dans son vol elle aperçoit le champ de bataille; elle suit les combattants, se faufile parmi eux et triomphe à leurs côtés. Elle trouve ainsi l’occasion de décrire l’action et la déroute des ennemis. Tous célèbrent cette victoire qui, croyaient-ils, devait sceller les destins du Pérou et de l’Amérique; mais, au milieu des célébrations, une voix terrible annonce l’apparition d’un Inca dans les cieux. Cet Inca est à la fois empereur, grand prêtre et prophète. Celui-ci, en revoyant pour la première fois les champs qui furent le théâtre des horreurs et des calamites de la conquête, ne peut s’empêcher de déplorer le sort de ses fils et de son peuple. Ensuite, il applaudit la victoire de Junin et annonce que ce ne sera point la dernière. C’est le moment favorable de prédire la victoire d’Ayacoucho.
Comme le poète n’avait pour but que de chanter le triomphe de Junin et que le chant resterait défectueux, boiteux, incomplet s’il n’annonçait pas la seconde victoire qui elle fut décisive, l’oracle de l’inca y a été introduit aussi minutieusement que possible pour ne pas amoindrir la gloire d’Ayacoucho. Le nom du général qui commande et le triomphe et ceux des chefs qui s’y firent remarquer y ont été rappelés pour rendre hommage à leur mérite et pour leur donner dès Junin l’espoir d’Ayacoucho avec le courage et l’intrépidité nécessaires à la nouvelle bataille. L’Inca termine en souhaitant que le sceptre de l’empire ne soit pas rétabli, car il peut conduire le peuple à la tyrannie. Il conseille l’union indispensable pour le progrès de l’Amérique; annonce le bonheur qui nous attend; prédit que la Liberté dressera son trône parmi nous et que cet exemple aura une influence sur la liberté de tous les peuples de la terre; enfin, il certifie le triomphe de Bolivar. Mais la plus grande gloire de ce héros sera d’unir et lier tous les peuples d’Amérique dans une confédération et assez étroitement pour qu’ils ne forment qu’un seul peuple, libre par ses institutions, heureux par ses lois et sa richesse, respecté pour sa puissance.
Ce plan, cher Monsieur, est grand et beau, (bien que ce soit le mien). J’ai pris la liberté de faire cette analyse craignant que, malgré votre perspicacité, vous ne puissiez découvrir toute la beauté de l’idée ensevelie sous cette quantité de vers, qui est le principal défaut de mon chant. Excusez-moi donc, car, mécontent de l’exécution, je me réjouis de la beauté du plan et c’est ce que je voudrais seulement faire entrer dans l’esprit de tous pour prévenir de mon mieux le blâme.
Je désire que vous m’écriviez assez longuement sur tout cela, en m’indiquant avec une entière franchise toutes les idées que vous auriez voulu me voir supprimer. Je le désire et je l’exige de vous, car, pendant mon voyage, je compte beaucoup parfaire ce chant et en faire à Londres une édition convenable; or, pour ce moment-là, je voudrais connaître votre opinion et vos critiques.
***
N’allez pas dire que je suis aussi ennuyeux en prose qu’en vers. Je termine donc en me répétant, comme toujours votre très dévoué et très respectueux serviteur.
OLMEDO.
Guayaquil, le 5 août 1825
Très cher monsieur et ami très respecté,
Je pars aujourd’hui pour Panama. Comme, depuis ma nomination, je suis prêt, mon voyage s’effectuera aussitôt que mon collègue Paredes sera arrivé avec les documents officiels et les instructions.
Je pars aujourd’hui. C’est l’heure où je comprends que le service que je vais vous rendre a quelque valeur. Comme, depuis que je suis époux et père, je ne suis jamais éloigné à une aussi grande distance ni pour aussi longtemps, ni au milieu de tant de périls, ni avec autant d’incertitude sur mon retour, je n’ai jamais éprouvé un chagrin pareil à celui-ci qui, en vérité, est inexprimable…
Je me recommande donc à votre souvenir et je vous recommande très instamment ma famille que je mets sous votre protection. Adieu, cher Monsieur. Je regrette vivement de partir sans avoir reçu de lettre de vous après la lecture de mon pauvre chant de Junin. J’exige de vous de nombreuses observations qui me seront utiles pour mon édition de Londres.
OLMEDO
Les lettres qui précèdent sont des documents précieux, autant pour nous éclairer sur l’état d’âme du poète à la veille de son nouveau départ pour l’Europe, en qualité d’agent diplomatique, cette fois, que pour nous initier au plan et à l’élaboration du poème La Victoire de Junin. Dans son humilité, Olmedo nous ferait croire qu’elle fut difficile et laborieuse. Avec plus de sincérité, croyons-nous, il nous déclare que les deux principaux défauts de l’œuvre sont le manque d’unité et sa longueur. Il s’expliquera plus longuement sur ses différentes parties dans sa réponse aux lettres très intéressantes de critique que Bolivar lui adressa. Nous les publions plus loin, car il faut auparavant que le lecteur connaisse le poème. Nous l’avons traduit de notre mieux fidèlement, sinon littéralement, chose impossible. Nous avons préféré pour cette traduction le vers alexandrin. N’est-ce pas le mètre le plus noble et le plus souvent employé par les poètes français dans les genres épique et lyrique. Olmedo, lui, obéissant moins aux règles de l’ode dans la prosodie castillane qu’à son goût personnel, a écrit son chant comme presque toutes ses grandes poésies, en vers dont les mètres ne sont pas toujours égaux. Le vers de onze pieds, qui correspond à l’alexandrin français, y domine, c’est vrai et, pendant de longues périodes, il se fait seul entendre. De temps en temps, pourtant, un vers de sept pieds apparait, selon la fantaisie du poète, soit qu’il veuille frapper l’imagination par une idée mise en relief et contenue dans un seul vers court, comme un joyau dans son écrin spécial, soit qu’il lui convienne de précipiter le récit. Le lecteur par la variété du mètre savamment combinée, est ainsi tenu constamment en éveil dans la lecture d’un poème de longue haleine et trouve comme des haltes où la voix se repose, non sans charme pour l’esprit. Dans d’autres endroits encore, comme dans le cantique des Vestales, pour alléger la strophe et lui donner plus de douceur, les vers de sept pieds se présentent plus fréquemment; deux ou trois se suivent, recherchant un effet musical, ou ils alternent avec les grands hémistiches sonores, quand l’image requiert de l’ampleur. Olmedo possédait ainsi l’art de graduer les nuances des idées et de les adapter à la cadence de la phrase poétique. Il pressait ou retardait le mouvement en artiste délicat qui, possédant à fond le métier, atteint sûrement la perfection ou s’en approche le plus possible.
On a dit avec raison qu’Olmedo avait parfois recours à l’allitération. Dès le début du chant il donne un exemple heureux d’harmonie imitative en entassant les r dans les deux premiers vers:
Y sordo retumbando se dilata
Por la inflamada esfera
Al Dios anuncia que en el cielo impera.”
A la simple vue, comme à la simple prononciation des vers précédents, ceux-là mêmes qui ne parlent pas espagnol peuvent se rendre compte de l’effet obtenu par la facture du poète qui a la science du mot juste placé dans le vers à la juste place , comme rappelant le proverbe américain: «The right man in the right place». Voyez comme il imite avec bonheur le vacarme horrible du tonnerre qui, après avoir éclaté avec fracas, résonne pendant quelques instants encore dans les airs embrasés, mais dont les grondements successifs diminuent d’intensité, s’amenuisent et s’éloignent progressivement. Olmedo, après avoir choisi quatre mots sonores, éclatants, qui, par la répétition de la même consonne, rappellent le roulement céleste, emploie un mot plus court qui marque le ralentissement qui a lieu dans la nue entre deux grondements et se sert aussitôt après de mots lourds, amples et polysyllabiques qui retardent le mouvement, tout en prolongeant la cadence.
Malgré ces réminiscences arrivant toujours de propos délibéré, sans heurter le goût et qui semblent: «…des pierres arrachées aux monuments de la Grèce et de Rome pour élever un monument à un héros moderne,» ce chant est loin d’être un décalque plus ou moins habilement travesti d’œuvres fameuses des maîtres du passé. Sans cela, aurait-il force l’admiration des lettrés, même en Espagne?
Pour forger ces chaines d’or, au feu de son inspiration, maintenu vivant par l’enthousiasme patriotique, Olmedo possédait un outil précieux qu’il maniait à merveille: son style débordant de nerf, brillant, très personnel dans sa recherche d’innovations originales et dans le choix d’épithètes lumineuses où il apportait une correction impeccable et une sobriété de bon goût. Tout en conservant une majestueuse allure à la phrase, qui rappelle toujours la noblesse de son origine classique, son style se montre plein de sève vigoureuse et jeune, revêtu de resplendissante couleur locale. La souplesse de sa plume, la richesse de sa palette montrent que son âme vivait en harmonie constante avec les lieux environnants. C’est ainsi qu’au milieu des scènes de carnage et de mort puissamment tracées, soudain souffle la brise agréable de son fleuve qui rafraîchit l’air alourdi par l’orage; et les suaves senteurs exhalées par les délicieuses campagnes qui le bordent ont bientôt fait de chasser l’acre odeur de la poudre et du sang. Dans un langage clair et dans une forme concise, mais élégante, il sait présenter les saines maximes, les sages conseils, les nobles leçons qui font image et qu’on retient.
Hélas! Combien toutes les qualités incontestables des poésies d’Olmedo, en passant, par nos soins, d’une langue dans une autre, perdront-elles de leur valeur intrinsèque!
A ces réflexions justes de Voltaire on peut, pourtant, toujours répondre qu’il vaut mieux chercher à connaître le génie d’un poète étranger célèbre, même à travers une pâle traduction, que de l’ignorer tout à fait. Mais, forcement, le coin qui servit à un esprit supérieur pour frapper son or doit, dans la main d’un simple ouvrier, s’émousser ou se fausser!