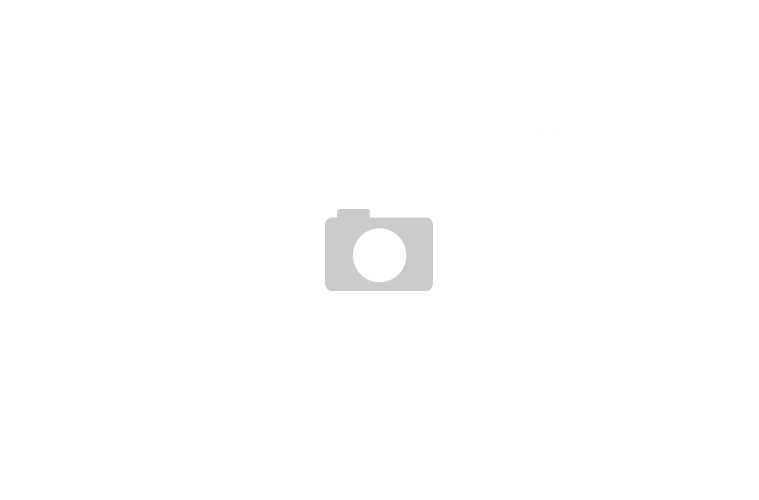I
Anne-Marie ne conversa jamais beaucoup avec qui que ce fût. Pas même avec ce bon fils, qui en naissant ne l´avait pas beaucoup fanée, qui grandit en elle très tôt, à tel point qu´en peu d´années il allait parvenir à partager sa jeunesse. L´enfance du fils, qui généralement n´est pas douloureuse à condition qu´il y ait un pain à partager, se réduisit à de légers couffins sur les épaules d´Anne-Marie, bien que ce pain, l´oignon cuit à l´eau et le maïs grillé dans la graisse, avec du sel ou des raclures de sucre noir n´aient pas toujours été à leur disposition.
Comme il ne l´avait pas beaucoup fait souffrir, le moment venait où il allait l´éprouver. Car elle, quand elle guida les pas de Jean vers Ambato, elle savait que pour les autres ce nom évoque une ville, alors qu´en réalité c´est une rivière. Si on ne joue pas avec une ville, on peut le faire avec une rivière, mais ça fait mal. Par exemple, peu de gens savent que des six ponts d´Ambato, sur celui qui est en bois, tout ce qui se produit est inversé. Anne-Marie, malgré cela, comprit que Jean se placerait dessous, ses pieds trempant dans l´eau, à l´endroit d´où l´on voit passer le nuage presque sur cette eau même, tandis que l´âne, la charrette, les gens cheminent en haut, près des balustrades et du vent.
Anne-Marie, qui savait que Jean abrégeait la conversation, laquelle n´avait jamais été très longue auparavant, en fut persuadée quand on lui raconta que le lendemain de l´arrivée à Ambato il rejoignit plusieurs gamins derrière ce même pont et demanda comment on parvient de l´autre côté sans avoir à monter le chemin qu´empruntent les grandes personnes. Pendant qu´il s´exerçait, s´accrochant aux branches et aux pierres, Jean dut prendre au hasard une tige de frêle roseau et par les sifflements qu´il émit il fit traverser tous ses parents, y compris son Père; nul doute qu´il pleura, mais il ne le dit à personne.
C´est à partir de ce moment que l´on découvrit son habitude de ne rien raconter aux autres. (Dans les sierras et dans les vallées, les aînés ont coutume d´être reconnaissants aux enfants pour leurs silences).
Mais les nuages n´existent pas seulement sous le pont de bois. L´un deux grandissait dans les yeux mêmes d´Anne-Marie (12). C´était un nuage consistant, cruel, qui rendait difficile l´entrée de quoi que ce soit; les arbres eux-mêmes, qui avaient été d´abord des arbres se transformaient en feuillage, beau mais terrible, avec plus d´ombres que de lumière.
Anne-Marie perçut cela physiquement dans ses pupilles. Elle n´en dit rien, car sinon Jean reviendrait, et l´année de sacrifices consentis pour les études serait gaspillée, et ce gaspillage coûterait plus cher qu´un champ ensemencé.
Elle n´en dit rien, mais après quelques semaines le curé le comprit, et le commissaire de police (13) lui offrit ouvertement la canne du défunt don Inocencio Fernández, et les voisines fouillèrent dans ses yeux: Elles se mirent à regarder ce feuillage blanc qui s´était accumulé depuis des années en un lieu où il n´aurait jamais dû être. Jean aussi l´apprit plus tard, bien que tous voulurent le lui cacher. Mais sa mère dit qu´il n´en fallait rien faire, qu´un vieillard peut être aveugle ou non, et que lui devait partir, et elle, rester. Comme Jean insista, ils décidèrent qu´elle descendrait l´année suivante, quand il obtiendrait son titre au collège et qu´il pourrait travailler dans une des écoles d´Ambato, pour subvenir à ses besoins à elle. Ainsi, Jean suivrait ensuite les cours de l´Université. Ils en demanderaient l´autorisation au Directeur Départemental des Études et celui-ci l´accorderait, car il lui serait difficile de refuser si c´est une mère presque aveugle et un fils qui grandit et qui coûte encore cher à ceux qui lui demandent.
Jean, à nouveau, s´offrit de retourner à la campagne. Et Anne-Marie s´y opposa une nouvelle fois, disant qu´elle pouvait faire sans cela, puisqu´elle ne sortait pas de chez elle. Les quelques portes de Pachanlica, le petit nombre de rues lui étaient familières mais elle ne désirait même pas les parcourir.
C´est ainsi qu´ Anne-Marie parvint à rester au village.
Pendant ce temps, plusieurs petits faits relatifs à Jean se produisirent. Un voisin de la maison où il habitait, joaillier originaire de Cuenca (14) qui cherchait à se retirer à Ambato le formait pour en faire son ouvrier. Jean s´enthousiasma, non pour le maniement de la charnière, de l´argent et de l´or, mais parce qu´il pouvait enfin posséder sa dose de magie.
Il réussit effectivement en quelques semaines des merveilles faciles à réussir. Avec deux pierres vertes il mit des yeux comme des cratères au volcan Tungurahua (15), qu´il pendit à une fine chaîne de métal jaune. Avec l´argent d´une agrafe oubliée, il fabriquait l´extrémité du bec du pélican, l´entoura du regard de la Sainte Trinité et créa ainsi un oiseau de mer plus savant que tous les oiseaux terrestres. Il donna au métal rouge la forme d´une langue de perroquet; grâce à elle il établit un lien avec la Cascade d´Agoyan (16) malade intérieurement et se rongeant peu à peu, et il s´entretint avec la Cascade d´Inés-Marie, laquelle lui confia qu´elle n´allait durer que jusqu´à ce qu´un nouveau tremblement de terre change le cours de la source et de la rivière. Il attacha à l´aide d´une chaîne de nickel le soleil des Incas dessiné dans les textes historiques au soleil des almanachs japonais. À cette époque on lui parla de la trahison des Espagnols envers Atahualpa (17), qui, prisonnier, les bras en l´air, fut brûlé vif après avoir acheté sa liberté au prix d´une cellule remplie d´or. La trahison lui parut terrible, non seulement à cause des flammes et de l´amertume, mais aussi parce que le métal des églises, des prisons et des bancs est un métal prisonnier, qui serait bien mieux placé aux chevilles des femmes et sur les buccins, et qui servirait à traverser sur des ponts dorés les océans et les firmaments, à faire des anneaux comme ceux de Saturne, et un pont comme ceux que forment les nuages sur la cataracte. Ainsi Jean découvrit que si nous ne cheminons pas sur les nuages c´est parce que nous ne le désirons pas. Quand on lui raconta qu´Ulysse avait lutté contre un géant qui n´avait qu´un œil, et que c´était un guerrier originaire d´une ville lointaine, il s´enthousiasma non pour son triomphe mais pour ses voyages, les grottes visitées et le retour; il fabriqua deux arcs, l´un ornemental et un autre avec un fil de métal élastique, au cas où le peuple n´aurait pas été juste, car ceux qui ne partent pas ont aussi leur amour propre.
Le métier de joaillier lui permit de découvrir une réalité méconnue des professeurs du collège; il l´aidait, en outre, à payer ses études et à porter quelque argent à sa mère chaque fin de semaine.
Les samedis Jean revenait, mais ses occupations avaient changé. Il ne s´asseyait plus devant la table du cordonnier ni ne ramassait plus les chutes de bois des cercueils. C´est durant ces samedis et ces dimanches qu´il se chargea de lire à sa mère les journaux et les lettres.
Il a déjà été dit (18) qu´ils recevaient peu de journaux -un ou deux- et pas plus de deux lettres par mois. Pour écouter les lectures du fils, la mère fixait ses yeux sur le point le plus lointain: sur Guayaquil; sur le plus proche: les chemins embrumés; sur ce qui n´a pas de distance: son Jean, son Jésus, la place du marché. Elle se faisait répéter les nouvelles qui lui plaisaient. Et plusieurs remerciements illimités tombaient en une larme régulière de ses yeux devenus aveugles. Elle avait été supérieure à son mari, et maintenant elle devenait inférieure à son fils: elle avait beaucoup de raisons de lui être reconnaissante.
Jean comprenait que les journaux étaient un piège tendu par sa mère, mais il ne chercha jamais à en comprendre la raison. Anne-Marie, quant à elle, en connut toujours le motif, mais elle ignorait jusqu´à quel point ce piège était si bien tendu, de façon aussi parfaite. Car le dialogue non établit par les mots de l´un et de l´autre devenait possible, facile même grâce à cette voix avec laquelle le fils donnait des nouvelles. Il lisait: “De plus grandes facilités portuaires dans le Pacifique pour les embarquements de bananes sont à l´étude”. Tous les deux, alors, ne pensaient pas aux bateaux mais aux wagons, ceux qui apportaient de Machala (19), de Guayaquil, les délicieuses petites bananes mûres qui s´ouvraient dans les mains; celles, vertes, que l´on retourne dans la cendre; ils pensaient au train disparu de la ligne conduisant à l´Orient, aux rails maintenant hors d´usage; à ce lui qui n´avait pas encore vu le jour et dont on poursuivait la construction à Esmeraldas (20), province africaine de la Côte, chemin de fer tardif, vaincu par les routes, véhicule esquissé en vue d´amener les marimbas (21) que l´on avait montrées un jour de fête sur l´estrade du village et que l´on ne revit plus jamais.
Jean lisait: «Les compagnies pétrolières ferment leurs puits dans la région amazonienne. Elles les rouvriront dans vingt cinq ans, lorsque les méthodes d´extraction et de transport rendront notre pétrole commercialisable». Comme ils ignoraient ce qu´étaient les campements pétroliers, tous les deux pensaient aux régions les plus visitées: les villages de la lisière de la forêt, aux maisons dans l´eau jusqu´à la cheville, avec deux églises où les dominicains avaient engagé la Vierge pour qu´elle réalise des miracles, dont quelques uns avaient fait sensation, toujours auprès de la génération antérieure à la présente, et d´autres, plus facile, plus actuels et plus journaliers, comme de verser de l´eau bouillonnante, froide pour la boire, chaude pour nager, et les deux eaux proches l´une de l´autre, au cas où le baigneur aurait soif.
C´est ainsi qu´Anne-Marie rachetait Jean. Tous deux parcouraient le monde. Elle, sans en avoir besoin, fermait les yeux pour se voir cheminer de telle sorte. Et lui, les yeux bien ouverts, un peu inutiles, ne savait où conduire sa mère, car bien qu´elle n´acceptait pas de partir, Pachanlica devenait trop connu, et Ambato n´était pas une ville mais une rivière, et on devait bien pouvoir l´atteindre par quelque endroit en naviguant vers l´amont, ou vers l´aval, en passant sur les ponts, en arrivant aux régions des autobus et à celles des canots.
Mais ce n´est pas de cette façon que tous deux apprirent pratiquement à cheminer côte à côte. C´est d´une façon différente, par un tremblement de terre et au milieu d´une soirée et d´une nuit bien sombres (22).
Deux heures dix sonnèrent aux vieux cyprès de Pachanlica et aux horloges d´Ambato. Pendant quelques instants il y eut du soleil et de la bruine mêlés, de la bruine couleur poussière, un soleil couleur poussière, et c´est alors que le tremblement de terre grimpa depuis ses racines jusqu´à la surface. De dessous chaque pied émergèrent des bruits qui n´étaient ni des tambours ni de la musique. Ils ne venaient pas de la mer et n´étaient point des vagues. Ils ne venaient pas de la verte province où l´on danse (23) car ils ne ressemblaient pas au frôlement des talons sur le sol et autour de l´arbre; ils ne venaient d´aucune région plus haute que le genou car ils plaçaient les différents noms de Dieu à la seule hauteur de la frayeur humaine: Les chiens, les premiers, ensuite tous les autres animaux domestiques, un chœur d´aboiements et de plaintes annonça que la terre allait s´ébranler; les hennissements successifs le confirmèrent, les murs de roseau répondirent, ceux-ci laissèrent passer toutes les secousses en deux secondes, et alors les cathédrales de pierre se brisèrent, leurs autels s´écroulèrent, et peut-être la pauvreté du pisé put moins bien résister que le sparte, mais beaucoup mieux en définitive que la magnificence de la préfecture et que la basilique.
Anne-Marie, à deux heures dix, très précisément, quelques secondes avant la commotion, se leva et eut peur pour Jean.
– Mon fils, mon fils, où es-tu?- cria-t-elle. Elle savait qu´il était loin mais elle voulait qu´il l´écoute. Lorsqu´elle termina sa phrase, les mouvements de la terre commencèrent, divisés en secousses principales et en secousses secondaires; ceux-là prolongés, ceux-ci brefs; tous, redoutables.
– Mon fils, mon fils, où es-tu? -répéta-t-elle, sachant bien pourquoi elle criait.
Sans penser à elle, mais seulement pour aller le chercher, lui, elle prit sa canne et à tâtons traversa le vestibule où les sacs de grain avaient coutume de tomber, où Jean fit ses adieux, où entra Jésus si souvent, avec ses corps différents, le corps joyeux éclatant de santé, le corps satisfait des bonnes récoltes, et le corps incliné à la nuque meurtrie, corps que seule la propre et lente agonie permit de reconnaître, après l´hôpital. En arrivant à la porte, un bruit l´arrêta, à peine pendant quelques fractions de seconde, suffisantes pour que la pierre du linteau s´abatte devant elle sans l´atteindre.
Personne ne la vit sortir du village. Elle se repéra grâce au mur de gauche. Les autres personnes devaient prier, agenouillées sur la terre de la place. Elle aussi prierait en chemin. Elle désirait que son fils sache rapidement que sa mère était en train de le chercher. Regardant droit devant, son odorat en éveil pour distinguer les ponts, les pâtés de maisons et les terres ensemencées suivant l´odeur des chevaux, des bois, de l´eau, les terres humides, pas à pas et arbre après arbre, s´appuyant contre eux, elle assura son chemin. Il faut généralement cinq heures et demie à pied; avec la bruine, ceux qui voient cheminent plus vite; les aveugles sont lents. Elle se couvrit la tête de sa mante noire pour se protéger de la pluie, qui devenait insistante. En arrivant à la bifurcation, elle prit à droite, pensant que les camions qui tuent les hommes ne peuvent passer par là. Et c´était vrai, mais par là non plus les enfants ne cheminent pas. Voulant aller plus vite, elle se perdit, et la nuit était bien avancée quand elle arriva à Ambato. Elle s´en rendit compte, non parce que les rues commencent à être moins en pente, mais parce que la clameur d´une ville a une voix différente le jour des tremblements de terre.
Ce n´est que lorsqu´elle se trouva égarée au milieu de cette clameur, au milieu des voix qui appelaient Manuel, Tomasa, Marcel, Micaela, qu´elle comprit que ce qu´elle faisait n´avait aucun sens. Elle se rendit compte qu´il faisait nuit, que les autres non plus ne voyaient pas très clair, que la terre continuait à trembler avec des frissons prolongées, comme un convalescent après l´ultime attaque de paludisme. C´est pour cela que les hommes continuaient à s´appeler entre eux, formant des groupes sur les places, dormant et s´agitant hors des foyers, sans pouvoir rien faire d´autre que de chercher les personnes connues et de s´assembler et de camper ne fût-ce qu´une fois sous le signe de la mort. Tout cela, Anne-Marie le savait. Mais elle aussi, comme les autres, criait par moments:
– Jean, mon fils, Jean-. Et personne ne saurait lequel de ces Jeans était le sien, personne ne saurait comment l´aider, personne ne saurait qu´elle était aveugle.
Elle passa sous les bâches des campements et elle interrogea ceux qu´elle entendait. Et elle voulut se confier à ceux qui lui inspiraient quelque bonté. Et dans la boue formée par la bruine, ses traces se confondirent peu à peu avec celles de ceux qui voyaient. Et ainsi, à travers cinq, six ou sept places, elle atteignit enfin la rivière. Elle la flaira. Elle chemina le long de ses rives. La ville continuait à résonner, bien éveillée. Et le fils n´apparaissait pas. Enfin elle comprit que lui aussi devait la chercher. Et son cœur se contracta, anéanti. Alors seulement elle décida de revenir, pour faciliter la tâche de Jean. Elle ne se trompait pas. En montant à la hâte et à tâtons vers Pachanlica, son village, elle décida de crier:
– Jean, mon fils, Jean-. Et elle répéta ce cri d´une voix rauque, mille, deux mille fois, jusqu´à ce qu´elle sentît les bras de son fils qui la saisissaient tandis qu´elle notait que dans ses yeux voilés -également sur des ruines semblables à d´autres- la ville détruite renaissait.
C´est ainsi que tous deux, empiriquement, apprirent à cheminer ensemble.
À six heures du matin de ce même jour, les habitants d´Ambato commencèrent à reconstruire la ville détruite la veille. On reconstruit une ville comme s´il s´agissait de n´importe quelle vie, de n´importe quelle chose. En commençant par les fondations, si la destruction a été totale; sinon, par où les coups l´atteignirent, et en allant vers le haut, vers la nouvelle toiture.
Jean et Anne-Marie décidèrent de vivre ensemble pour mieux faire face. Pour l´heure, ils ne désiraient pas retourner à Pachanlica.Plus tard, ils se demanderaient pourquoi ils avaient pris cette décision. Ils apprirent que tous ceux du canton les cherchaient; aussi, pour les rassurer, ils leur donnèrent de leurs nouvelles et leur firent savoir qu´ils ne reviendraient pas.
Pendant quelques semaines ils restèrent chez des gens de leur connaissance et chez des parents éloignés. Ensuite ils se fixèrent dans la rue où les trains ne passaient plus, où les rails morts avaient été enlevés et remplacés par deux rangées de pierre différentes des autres, avec des traverses de pierre également, qui dessinaient un long escalier, dirigé vers le nord et vers le sud: vers Quito sur les montagnes, vers Guayaquil, près de la mer.
Dans cette rue, avec ce que rapporta la récolte de “mellocos” (24) auquel s´ajouta quelque argent qu´on leur devait, ils louèrent une boutique, achetèrent des bocaux de bonbons; des étagères avec des morceaux de savon, des sacs de farine, d´orge: Anne-Marie, en vue de s´asseoir et de vendre ce qu´on lui demanderait, Jean pour avoir un endroit où revenir midi et soir, au moment où il convient de partager un peu de pain et un peu d´eau avec du sel.
Jean, bien qu´il n´était plus un enfant, continuait à souffrit de ne pas voir passer les trains dans sa rue. Par contre, les charges de charbon passaient sur les ânes provinciaux, ainsi que les amoureux à la tombée de la nuit. Alors, en voyant les couples, cette douleur s´amplifiait, et il se rendit compte que sa rue était circulaire, qu´elle ceignait la ville comme une ceinture: À l´intérieur, les maisons et les potagers, au dehors, selon le climat, les collines poudreuses et un ciel qui troublaient les résonances d´un vent propagateur d´autres vents, ou des ocarinas ou des harpes anciennes, celles-ci très rarement et en voie d´extinction.
La boutique vendait plus de douceur que de pain. Assise sur le bord d´un banc très bas, Anne-Marie laissait tomber sur le comptoir le poids de son visage, au point de ressembler, depuis la porte, à une tête sculptée depuis bien longtemps, coupée à la base, et abandonnée, libre de promener son regard sans expression sur tous ceux qui apparaissaient.
Jean allait deux fois par jour à son atelier de joaillier. Ni lui ni sa mère ne se nourrirent de ce que rapportait la boutique, mais des six paires de pendentifs en argent produits chaque semaine par les deux jeunes mains. Cela ne lui coûtait rien à Jean, à peine la plante d´un orgueil, plante plus petite que le persil, et plus faible.
Sa croissance et son travail allaient de pair, et en grandissant et en travaillant, il s´étonna d´accéder peu à peu à la connaissance de tout, ou de presque tout. Il possédait un certain pouvoir qui allait au delà des sens. Mais deux choses le tinrent en échec, l´une fut le tremblement de terre; il avait en effet demandé plusieurs fois si le volcan Tungurahua, dont les pierres recouvraient les plateaux, s´ébranlerait à nouveau, comme le racontaient les aïeuls. Et la veille des tremblements, il déambula, cherchant les tremblements dans l´air, et non sous les maisons. L´autre fut la boutique, car s´il avait toujours su qu´ils ne vendraient pas beaucoup, il ne prédit pas que dans la vitrine, à coté de la tête de sa mère, parmi les bocaux de bonbons, quelque humidité issue de lui et d´elle les séparerait et les dissoudrait peu à peu, exactement comme le sucre si on le garde trop longtemps.
Ceci, certainement, Jean ne le sut jamais. Sa mère le sut, elle.
Sa mâchoire reposant sur le comptoir, Anne-Marie, comprit que les samedis et les dimanches, jours de visite du fils, de lecture de journaux et de lettres, allaient s´amenuisant. Ce qui restait de sa vieille frondaison fut secoué quand elle en prit conscience. Elle n´avait jamais éprouvé de jalousie vis à vis de son mari. -J´ai porté de l´estime à mon défunt- répondit-elle, pour dire qu´elle l´ avait aimé, quand, veuve depuis peu, on la questionna sur lui, sur sa vie. Maintenant, elle se sentait de plus en plus désemparée, et désirait s´attacher à quelqu´être durable. Mais, paysanne après tout, elle sut se contenir, mordre cette poussée de rébellion et l´étouffer doucement, avec cette manière d´être indulgente vis à vis des autres, bien que sévère pour elle-même en son for intérieur.
D´autres événements également se produisaient pour Jean, qu´il lui était facile de prévoir. Avec des mains rustiques et une faible expérience en bijoux, il avait tissé des restes de palmes des Rameaux, pour les offrir à sa blonde voisine. La jeune fille l´avait remercié par des paroles, mais non par le cœur et le regard, car ceux-ci se portaient aussi bien sur tel ou tel garçon de la ville. Alors Jean essaya avec une autre amie et un autre matériel. Il tissa avec de l´argent deux boucles d´oreille, véritables petites merveilles. Mais elle ne les accepta pas, et il dut les garder dans le petit tiroir de joaillier. Il commençait à acquérir une certaine timidité qui tenait de la naïveté mais aussi de la méfiance.
Il regardait de temps en temps les chemins qui gravissaient les collines, autour d´Ambato. Les amis de Pachanlica lui avaient offert un porc et une poule afin qu´il les engraisse chez lui. Mais il n´était pas possible de les garder tous les deux dans la boutique. Pour la poule, c´était possible, retenue par des ficelles, dans la cour; mais pour le porc, ça ne l´était pas. Jean, par conséquent, se rendait journellement à ces collines toutes proches; à l´aller et au retour il tenait la corde du porc, tendue, dans ses mains.
C´est ainsi que la jeune étrangère de la ferme d´en haut fit sa connaissance, et qu´il rougit, lui, et abandonna la corde.
– Prête-moi ton porc un moment- proposa d´emblée la jeune fille.
Quant il lui remit la corde, une sorte de pacte fut signé entre eux. Elle pourrait jouer sous ses yeux innocents à lui. En revanche, elle viendrait au portillon de sa ferme pour recevoir les jours de semaine les boucles d´oreille des dimanches des Rameaux et de Pâques.
Et il n´y aurait presque rien de plus à raconter sur eux deux, si ce n´est qu´ils partirent l´un et l´autre peu de temps après. Ses parents à elle, venus d´un pays éloigné, devaient s´en retourner. Ils parlèrent du départ comme s´ils avaient secoué quelque peu cette nouvelle terre collée à leurs vêtements. Ainsi se terminèrent les rendez-vous du portillon.
Jean se vit abandonné de nouveau, et sa mère ne lui suffit plus. Il avait coutume de monter à la colline proche de la maison de son amie, habitée maintenant par d´autres personnes, pour la regarder de loin, et revenir à la boutique. Il prit son crayon, quelques feuilles de papier. Son professeur de littérature pensa que ce garçon connaissait bien les quelques années sur lesquelles il écrivait. Moi aussi j´ai toujours soutenu qu´un écrivain de moins de trente ans mérite qu´on l´écoute. Je lui demandai s´il voulait continuer ses études dans la capitale. Le seul nom de Quito que je prononçai produisit les effets d´une fontaine lumineuse. Je me pris à douter alors: Avais-je eu raison de mettre cette offre devant ses yeux? Je lui promis d´en parler à l´Université afin qu´on l´admette comme boursier. Il aurait à payer l´inscription tout au plus.
– Merci, vous me rendez un grand service -furent ses seules paroles. Mais, pendant qu´il les prononçait, il me remettait timidement un poème, du bout des doigts.
Je n´ai jamais pu être sensible à cette sorte d´arguments, et je tins parole. Jean obtiendrait sa bourse. Je m´excuse grandement pour ces faits, car je ne connaissais pas son milieu, ni sa dimension séculaire; je pus comprendre seulement quelques unes de ses nombreuses racines quand Jean et sa mère m´expliquèrent que la boutique était une coutume qui s´était rajoutée au reste. Je compris mieux ces racines ensuite, quand on le tua et qu´avec sa mère nous allâmes à la recherche d´un cadavre ignoré de tous.
En se séparant de la ville-rivière, Jean comprit que sa naissance avait autant d´importance que sa vie: Ambato était formé de plusieurs Pachanlicas. Il se demandait si Quito ne serait pas plusieurs Ambatos. Sa grande Nation ne lui semblait rien d´autre qu´un village verdoyant, avec des bananeraies et des palmeraies à la porte des chaumières basses, des cannes à sucre avoisinant les moulins, avec des champs de luzerne et des pâturages dans les régions crépusculaires. Et en haut, à deux centimètres des neiges, avec des fleurs de pyrèthre mises là, au milieu de lambeaux de lagune et de ciel, pour interrompre le vert, changer au moyen de quelque cire rouge le bleu andin, pour le rendre supportable aux yeux des humbles voyageurs.
Raisonnant ainsi mais se demandant où commençait la grande ville et où se terminait sa province, Jean pleura Ambato pendant que l´omnibus l´éloignait de ces années et ainsi le protégerait d´elles. Il éprouvait de la gratitude pour ce qu´on lui avait enseigné, pour ce qu’il laissait. Ce n´est pas rien de jouer avec le puzzle d´un tremblement de terre et de redresser les maisons dès l´aurore qui suit le désastre. Ce n´est pas peu de chose que de savoir comment se baigner dans le gué de la rivière. Et ce n´est pas moins difficile que d´apprendre comment on dore l´argent, comment on transforme en plaques le métal jaune. Glisser sur le sable des collines et se retrouver juché sur le mur du verger du riche voisin, pour voir l´arbre à duracines, est certainement aussi valable que de savoir attendre plusieurs années pour le voir devenir grand.
Pendant son voyage, ces vérités des siens lui firent mieux approfondir les choses que ses cahiers de géographie. Ce qu´il apprenait, il l´apprenait par lui-même, mais il aurait pu parler également au nom de son père. Car le fait d´être né pauvre et même après avoir été enterré d´avoir un fils faisant ses études à Quito, cela signifiait connaître les pas de tous les hommes, dans la vie et dans la mort.
Jean se présenterait devant la Capitale avec la même douceur qu´eut celui qui mourut, prenant son fils par la main. D´autre part, une telle douceur n´appartenait pas seulement à son père mais lui-même, depuis le moment où l´amie étrangère reçut de lui la corde du porc pour la consoler de sa solitude.
De la fenêtre de l´omnibus il contempla d´autres rivières et d´autre bétail sur les plaines humides et ensoleillées de Latacunga (25). Il en conclut que son Pachanlica apparaissait en tous lieux, qu´il était transhumant, plus docile qu´un chien, plus silencieux. Il l´emmènerait ainsi avec lui, mais s´efforcerait de le dissimuler aux autres.
À cette époque on appela sous les drapeaux les jeunes gens dont l´anniversaire tombait un Vendredi Saint. Jean se présenta docilement. On l´affecta à la cavalerie.
Il crut que le sort était de son côté: il se souvenait de sa longue amitié avec les chevaux. Mais la courte période militaire l´éloigna d´eux et ce fut là pour de nombreuses années le seul ressentiment qu´il éprouva envers quelqu´un.
Ce ne fut pas de la rancœur mais un manque de compréhension vis à vis de la caserne; il se rendit compte simplement qu´on ne lui avait enseigné aucun métier utile: piloter un avion, dorer des métaux, vivre; on ne lui avait pas enseigné à attendre la croissance des arbres et la résurrection d´entre les morts, en l´occurrence celle de ses parents; on ne lui avait pas enseigné à composer un vers à l´aide d´une serviette en papier, comme l´avait fait son professeur de littérature. Mais il est vrai également qu´il dormit peu de semaines dans la vaste chambre commune du bataillon, long dortoir semblable à la salle de l´hôpital de Sœur Isabelle. Il est vrai également qu´un officier et un sergent notèrent sa docilité, et, en dissimulant charitablement la vérité, firent en sorte qu´il se fatigue moins dans les mille tours de manège, pendant que les autres s´épuisaient à cet exercice: entre gens de la campagne on décèle son origine sans avoir besoin de se parler. Il resta peu de semaines sous les drapeaux, quelque deux mois en tout, car pendant ce délai, sans qu´il ait fait aucune démarche, ses chefs reconnurent “qu´il manquait d´aptitude en tant qu´orphelin, fils unique et soutien de veuve”.
Il sortit avec la même sérénité qu´à l´entrée, à laquelle s´ajouta peut-être une légère mélancolie cristallisée, qui commença à apparaître ces jours-là, se notant davantage au ton de sa voix que dans son regard.
Au moment de quitter la caserne, avant de venir à l´Université il resta deux jours à Ambato avec sa mère. Ensuite, il me chercha.
Je le reçus avec une grande joie. J´avais loué pour lui une chambre à Saint-Jean, quartier pauvre de Quito, beau et oublié. Nous nous étions promis de visiter ce quartier, pour voir, en descendant les pentes, les ruches blanches où vivent les gens d´une des villes les plus belles et les plus simples du monde.
– Maman est restée, comme d´habitude, derrière le comptoir- me dit-il, comme s´il transportait une lourde charge sur le dos et qu´il ait voulu la mettre devant et la regarder en face.
– Tu aurais dû l´amener- suggérai-je.
– Je lui ai demandé si souvent -dit-il pour se justifier- mais elle ne veut jamais bouger de l´endroit où elle est. Pensez que pour la faire partir de Pachanlica un tremblement de terre fut nécessaire. Et elle ne le fit pas pour elle mais pour venir à ma recherche.
– Je ne suis pas aussi convainquant qu´un tremblement de terre, mais je lui parlerai -proposai-je.
– Ce serait absurde parce qu´inutile.
– Qu´a donc ta mère, qu´ont donc les tiens, pour ne jamais bouger d´où ils sont?
– Maman dit qu´à Pachanlica et à Ambato elle se trouve plus près de Dieu et des siens.
– De Dieu, je ne sais. Mais des siens, que cela signifie-t-il, puisqu´elle n´a pratiquement plus personne dans cette région?
Je remarquai que cette phrase ainsi que d´autres m´éloignèrent de Jean. Il me contempla avec beaucoup de douceur mais comme si nous avions été très éloignés l´un de l´autre. Il garda le silence, parce que probablement ses paroles auraient été loyales à mon égard mais déloyales quant à ses sentiments. Je ne pus savoir s´il défendait le voisinage de sa mère avec les morts, avec les arbres, ou simplement avec les faits connus et le lieu où ils se produisent. Je ne le saurai jamais. Jean, simplement, s´éloigna de moi.
Le second éloignement fut produit par l´écoulement naturel de la vie. Dès qu´il le put il enferma ses silences dans le giron d´une femme. J´avais remarqué qu´il regardait les jeunes filles pulpeuses avec un trouble à la fois animal et pacifique, empreint de paix dans l´offrande, et animal dans la certitude de pouvoir accomplir celle-ci. L´épicière-couturière du coin, avec son tablier couleur arbre, qui les après-midi vendait aux universitaires aussi bien du café chaud que du papier rayé et se voyait confier par des voisines, le soir, de “petits travaux” à contrepointer et à repriser pour le lendemain matin, était originaire de la Côte, était arrivée à la Sierra à l´âge de seize ans, avait perdu son père aussitôt quand il s´était disputé avec sa mère et qu´il était parti, sans dire où ni avec qui; elle était devenue orpheline à dix huit ans; il y avait par conséquent six ans qu´elle s´employait ainsi à retirer de son travail l´argent quotidien qu´exigeait la croissance implacable de ses frères cadets.
Ni la machine à coudre nocturne ni l´attention matinale envers les jeunes n´étaient parvenus à ébranler la fermeté de son buste et sa façon nerveuse de marcher. La fécondité du Guayas (26), fécondité de palétuviers, de terrain inondable, lui permettait de conserver toute sa sveltesse tropicale. Mais en même temps elle était solide, avec cette santé du tropique situé près de la neige.
C´est elle qui décida de prendre Jean. Elle le fit avec la tranquillité de la plaine, la “basse terre”, quand elle capte les rapides de la rivière montagnarde, qu´elle l´assagit, la préparant ainsi à une vie plus intense, à devenir mer, ou à s´évaporer.
– Le corps de la femme est une portion de paix, il se couche et s´allonge- me confia Jean. -Enfin je trouve mes fenêtres ouvertes sur la plaine inconnue. Ici j´aurais pu devenir sédentaire comme le furent mes parents. C´est ainsi que la paix du monde aurait dû se faire, sur des plaines comme la mienne, au retour de fréquents voyages par les collines et les vallées. Mais, sans aucun doute, il y a quelque vent qui me pousse, nous pousse en avant. On nous appelle Jéricho, mais ce ne sont ni l´amour ni le bien qui détruisent. Ce sont les autres qui nous poussent, ceux auxquels il a manqué une portion interne de paysage, ceux qui renoncent à leur vocation de bonheur. Pour toutes ces raisons, nous devons savoir qu´ils ne pourraient connaître notre essence, ni la leur ni la mienne, ni celle de personne, même s´ils jurent fréquemment qu´ils s´en font les défenseurs. Si je meurs quelque jour ou si je manque d´une façon ou d´une autre (je vois bien qu´il n´y a pas d´autre façon de manquer hormis la mort), pour ce jour, dis-je, je vous demande seulement de relater dans vos écrits que mes parents et moi nous avons toujours su parfaitement ce que nous sommes. Dites-leur à tous que si les hommes duraient plus que les plaines, la vie prendrait pour nous une signification. S´il vous plaît, affirmez que ce qui est urgent pour nous, ce n´est pas que l´on interprète notre essence. Non, de grâce, qu´ils cessent de le faire. Qu´ils nous permettent d´abord de proclamer qu´elle existe, qu´elle vit sous la menace. Mais non comme unité isolée sinon comme unité de groupe, comme prolongement de différentes hauteurs en une confluence collective, vaste, infinie.
Quand je l´écoutai, je ne voulus pas croire que c´était Jean qui parlait. Je le supposais capable d´exister, même d´exister dans un cadre agréable, mais pas d´exprimer des propos aussi sages. Plus tard, j´ai compris que Jean avait toujours été illuminé, que son père, sa mère, tous les siens étaient des êtres illuminés. Mais tous les autres, moi y compris, leur refusions la possibilité de nous le dire, si au préalable ils ne cessaient d´utiliser leur langage pour utiliser le nôtre. Le curé de Pachanlica, par exemple, leur offrait des lambeaux de ciel s´ils apprenaient à se comporter comme les bons curés. Les politiciens leur promettaient quelques mois de prospérité si au prix d´années de souffrance personnelle ils prenaient part à la prospérité d´autrui. Les intellectuels également lisaient à voix haute ses cahiers d´écolier. Si c´étaient des admirateurs de l´histoire universelle ils juraient qu´ils pourraient donner à Jean et aux siens une vraie guerre quand ils auraient déclenché une guerre de soldats de plomb.
Mais Jean savait que “les siens” devaient être patients et écouter, car “les autres” étaient faits pour dire de telles choses et il valait mieux leur permettre de les dire. Quant à lui, il durerait plus longtemps, il avait déjà duré plus longtemps. Étant père, ses enfants grandissant, il durerait avec eux; sinon, il durerait aussi. Car il venait d´exister avant sa naissance. Et en considérant sa mort, elle se produirait de nombreuses fois, pas nécessairement à travers ses petits enfants, mais à travers les petits enfants de tous, car les signes distinctifs des paysans se transmettent, pour sûr, de génération en génération, d´une bouche à l´autre, mais aussi de porte en porte, de colline en colline. Et dans cet ordre d´idée peu importe que ce soit le fils qui transmette le message, pourvu qu´il y ait quelqu´un pour le crier et quelqu´un pour le recevoir. Car Jean, à peine âgé de quelques jours, avait appris que l´histoire véritable n´est pas écrite, ne s´exprime pas par des lettres, mais de vive voix, comme les échos.
J´avais déjà remarqué, comme je l´ai dit, que le langage de Jean avait été modifié par cette femme adulte. Les bois montagneux de sa voix à lui seraient secoués et définitivement façonnés par ce grand vent du tropique, soufflant comme l´ouragan, présageant d´abondantes récoltes, stratifié et sédentaire après s´être déposé dans les vallées.
– Les choses que j´aime dans mon pays, je les connais sans avoir eu besoin de m´en être éloigné et d´avoir dû procéder par comparaison- me dit-il, me reprochant ainsi mes voyages.
– Qu´aimes-tu en lui? -lui demandai-je pour dire quelque chose- parce que moi, j´aime chaque minute de mon pays, chaque minute de chaque coin et de chaque climat.-
– Moi aussi- me répondit-il, -mais je l´aime surtout parce qu´on peut parcourir pieds nus la ligne équinoxiale ou s´y suspendre pour descendre sur les mains des montagnes jusqu´à la forêt.
– Tu l´as déjà fait?- lui demandai-je pour l´acculer.
– Plusieurs fois, tous les jours, et je vais continuer à le faire toute ma vie.
Quand Jean parlait ainsi, c´était moi qui me sentais acculé. J´avais envie de tendre des clôtures autour de mes propres concepts ou de les découper à coups de dents.
Et il est vrai que guidé par cette femme du tropique, Jean commença sa redécouverte des Sierras, de son soleil, de la Patrie.
Ses yeux de paysan amoureux se portèrent sur Quito, ville espagnole, métisse cependant; il la trouva diaphane, blottie dans un repli du cœur et de la montagne. Son front reposant sur une épaule, Jean abandonna sa tête au vent natal, ce même vieux vent découvert dans les patios de province. À l´aide des mains enlacées, il fit, avec les mains solitaires de la femme, des ponts et des filtres pour l´eau des ruisseaux, près du svelte vent prisonnier, qui s´échappait humidifié.
À l´aide des pulsations de ses propres tempes, effleurées par la main qui apaise, il apprécia le nombre de secondes et de minutes dont se compose un jour complet, l´azur du ciel, l´écho des arbres et le crépuscule dont les couleurs pures ont chassé la douleur.
Nous parlâmes souvent de cette femme.
– Je ne connaissais pas Quito avant d´avoir à le montrer à quelqu´un- affirmait Jean avec chaleur.
– Il en est toujours ainsi, et pas seulement avec les villes- lui répondais-je.
– Je veux dire que nous devons protéger maintenant nos petites villes, nos villages et nos rues contres les maires qui les détruisent- précisait-il pour clore la discussion.
Ces dialogues me permirent de comprendre qu´une compagne peut être plus que le pas qui accompagne le nôtre, plus qu´un refuge dont la porte, ouverte, attend qu´on y entre. Le Guayas était pour Jean, incarné par cette femme, un grand fleuve qui entraînait vers la mer les nouvelles des villages qu´il livrerait au monde, lequel sans elle ne serait pas complet, ne se teindrait pas de la couleur de la terre proche, germinatrice, morbide.
Pour ma part, après avoir écouté que Quito était l´objet des réflexions de Guayaquil, j´eus honte de ne pas avoir défendu plus à fond l´architecture traditionnelle de mon Pays. La Capitale, ville espagnole, avait été, malgré cela, le plus important lieu d´habitation des indigènes, le plus connu et le plus sédentaire. De ceux-ci, ses véritables fondateurs, il ne restait pas que les ruines mais l´homme également, comme dans mon Jéricho (27), cité par Jean durant ses rares moments d´exaltation accusatrice. Et même de la nouvelle ville, celle qui était récente, républicaine et européenne, celle des élus, les murs s´effaçaient. Mais ses rues métisses conservaient des signes datant de soixante ou quatre cents ans, vivants indices de l´architecture baroque, de la Renaissance, monarchique et républicaine. Et l´on permettait la destruction des sculptures ornant les frontispices.
Ces cieux azurés de Quito étaient dignes des rochers de la Grèce. Mais les magiciennes du mont Circeo ne cheminaient pas de rocher en rocher; de la crête neigeuse jaillissaient plutôt des collines comme des seins virginaux et des vallées se détachaient qui devenaient des lacs. Nous remplacions les humbles dimensions du balcon de fer, de l´auvent, du portail et de l´arche par l´imposante grandeur de l´hybride gratte-ciel. Et au lieu de la pierre et du moellon pour la pose desquels il y avait pléthore de maçons, nous confiions à l´ingénieur la charge de ciment et le style de Chicago. Et cette ville ne constituait que l´exemple. Pour moi, et je le dis à Jean, il ne s´agissait pas seulement des villes, mais surtout des hommes… Il acquiesça.
On approchait de la date de clôture de la période d´inscription et d´admission universitaire. Je remarquai qu´il feignait de ne pas s´en rendre compte. Ensuite je me souvins qu´à l´université gratuite les boursiers eux-mêmes doivent acquitter au début une petite somme. Lorsque j´en parlai, il se l´était déjà procurée, grâce à la vente de boucles d´oreille qui lui restaient de ses tristes amours provinciales.
Son inscription payée, il commença à fréquenter la Faculté des Lettres, à regarder la ville à travers la fenêtre et à aller à Ambato chaque samedi pour rendre visite à sa mère.
Mais je compris mieux sa solitude quand, après l´horaire normal des heures de cours, il venait me parler du Pays, de son seigneur Atahualpa, de Rumiñahui (28), habitué des grottes explorées par des condors, capitaine des incendies, guide des biens fugitifs des indiens.
C´est pendant cette période qu´il défendit sa théorie sur le sens équivoque du nom donné à la Patrie.
– Elle ne devrait pas s´appeler Équateur. Pourquoi pas Quito, nom sous lequel les premiers habitants la connaissaient, pourquoi pas Terre Verte, (29) comme les premiers chroniqueurs la connaissaient, pourquoi pas Sierra Nevada, Río Blanco, Guayas, Esmerladas, Yacimiento, Cuenca, Yahuarzongo, Pedernal ou Tambillo.
L´université, pendant ces mois-là, déménageait. Née au centre de la ville, dans des rues qui étaient des gorges avec des salles de cours dérobées ça et là aux maisons d´habitation, elle ne voulait plus vivre dans tant de patios et de couloirs dispersés. Au prix de grands efforts elle réussissait à projeter un vaste et bel ensemble qui commençait à germer sur les collines du Nord. Elle réussissait, enfin, à appeler la famille universitaire “les familles” pour mentionner les facultés, et les rassembler autour de ces lignes naissantes qui apparaissaient dans le lointain.
Mais il ne s´agissait pas encore du changement de domicile définitif. La nouvelle citadelle mettrait dix ou vingt ans pour être construire. Ce n´était là que l´un des si nombreux déménagements provisoires. On ne peut conduire un groupe de plusieurs milliers s´asseoir sur des chaises imaginaires, parmi les premières rangées de briques. Le nouveau siège était la réalisation d´un plan d´architectes qui avait commencé à prendre forme sur le terrain, et plus tard il allait même lui manquer les deux conditions de base d´une université: des laboratoires et une bibliothèque. Parce qu´un ensemble aux belles toitures, avec des professeurs et des élèves mais sans atelier, n´est pas une université; il ne l´est pas aujourd’hui, ne le fut pas au Moyen Âge et ne le sera jamais. Université signifie la somme de tous les moments pathétiques et cérébraux de l´homme: l´académie grecque, plus les liqueurs et le poison de Socrate, plus la république insaisissable de Platon, plus l´orange des physiciens transpercée d´une flèche (30), plus les jardins de Plutarque, plus le kérosène des fusées sidérales, plus le loup d´Assise, plus les lapins de Carrera Andrade (31), plus les pâturages de Jammes, la mer de Valéry, les troupeaux de Claudel, moins tous les arts oratoires qui ne seraient pas écrits par Whitman ou chantés par Martí.
Je précise bien qu´il ne s´agissait pas du changement de style de vie, pas même du changement d´adresse définitif. La faculté, devant l´empressement des loueurs, se transformait simplement de maison pauvre en autre maison pauvre.
Ce déménagement servit plusieurs fois de thème de conversation avec Jean. Je pus ainsi me rendre compte de la façon dont il considérait les habitants de la capitale et les professeurs de l´établissement. Je pus ainsi en conclure un jour que ses définitions sur l´université étaient beaucoup plus précises que ma digression et mes théories. Beaucoup plus profondes, surtout.
Je crois que ce que j´ai à faire de plus honnête, c´est de copier textuellement quelques notes personnelles conservées par sa mère, qui me les remit sans savoir qu´elles constituent un testament.
Voici leur texte:
«Mes notes d´histoire contiennent deux vieux personnages. Avec mes professeurs j´essaie d´en construire un nouveau pour faire le troisième. Je doute de pouvoir y parvenir.
«Une fois mon professeur d´histoire nationale fut surpris de me voir regarder la fenêtre si fixement. Il vint et regarda de toutes parts pour découvrir ce qui m´intéressait tellement. Je crois qu´il ne put voir Atahualpa qui, là-bas, sur l´Ichimbía (32), sur le Panecillo, sur d´autres collines, avec sa mère, descendait, parlait avec chaleur et indiquait l´inégalité des charges humaines portées sur le dos. Car veiller à cette inégalité est le souci constant des meilleurs princes indigènes.
«Le comportement de mon professeur d´histoire m´attendrit parfois; il lui manque la fierté du dernier roi des Quiténiens. Pendant la dernière classe, par exemple, il s´employa à nous présenter des leçons d´art oratoire, lequel, en fin de compte, lui sert à briller devant le premier venu. Mais les deux mères se ressemblent beaucoup. Évidemment, celle d´Atahualpa prend le soleil sur la pierre tiède. Celle de mon professeur est malade, elle préfère attendre ce soleil devant la porte de sa boutique entr´ouverte, avec des tampons de flanelle serrés sur les articulations de l´avant-bras et du poignet, pour les réchauffer. C´est une bonne dame qui, sur un éventaire, vend à la pièce les fils déroulés et au centimètre les enveloppes de toile destinées aux boutons de métal. Parmi ses objets d´ornement il y en a un qui n´est pas destiné au commerce: l´orgueil qu´elle éprouve pour son fils, qui ne lui rend visite que de temps en temps.
«J´ai regardé aujourd´hui la mère d´Atahaulpa et me suis pris à imaginer son fils, quelque vingt ans avant l´incinération (33). Depuis la mi-hauteur de ses montagnes, elle a vu arriver les armées ennemies et a considéré les deux alternatives: Conquérir l´envahisseur, ou lui permettre de partir. Mais la décision ne lui incombe pas à elle seule, car Huayna Capac (34), le guerrier, voulant laver ses blessures a eu envie de se reposer, et tout en se reposant et en se lavant, il l´a regardée. Et c´est lui qui a décidé de mettre un terme à ses invasions et de s´asseoir sur la pierre pour prendre le soleil et avoir un fils.
«Quand mon professeur m´a demandé ma ´conception sur les changements structuraux en cours´ j´ai vénéré une lignée en lui, en ce bon fils de femme du peuple, qui n´est pas fils de cacique ou de roi. Et lui, surpris par mon regard lointain, m´a demandé si je suivais son cours. Et j´ai répondu que j´étais très attentif. Peut-être lui ai-je menti, mais cela dépend. Si lui faisait allusion à ce que je savais sur ses fonctions au Sénat, ses interpellations adressées aux Ministres, ses interventions à l´Institut de Prévision Sociale, ce qui ne l´empêche pas d´être maintenant avocat de patrons d´usine, si c´est cela, je lui ai menti.
«Mais c´est à sa génération antérieure que je pensais, à sa mère, au temps que passent les deux femmes -avec celle d´Atahualpa- à manier l´écheveau et le fil. Car demain, quand les fils mourront, les trois mères -avec celle de mon troisième personnage qui n´est pas encore créé et qui peut mourir crucifié ou lapidé ou simplement ignoré et dont je ne peux dire s´il existera jamais- réclameront un visage, des traits, une essence, et elles n´auront qu´à imaginer des broderies et à les tisser aussitôt au fur et à mesure des événements, de ce qui surgit des mains de ces fils, qui détinrent la vérité il y a des siècles, qui sont dans l´erreur aujourd´hui, et qui par anticipation détiennent la vérité pour l´avenir.
«Je pensais que Rumiñahui (35), général indien, pouvait être satisfait de mes cours d´histoire. Mais la vérité est tout autre. Je ne la vois pas cheminer dans les collines, mais courir, passer furieusement, j´ignore les traits de sa mère et surtout, il me semble né pour plus tard. Le professeur de littérature équatorienne le connaît. ´Visage de pierre´(36), répète-t-il, pour citer quelque chose d´un jeune poète; il adore citer les jeunes écrivains, sans raison, sans logique, comme cela, pour avancer et coopérer.
« Rumiñahui s´est levé très tôt aujourd´hui. Il commence à peine à cesser d´être un enfant mais il sait manier la sarbacane; il a déjà dépassé les leçons de la pierre projetée vers la neige; avec ses nouvelles armes il aime marcher dans la savane et avoir le condor à sa merci. Si cela dépendait de lui, il brandirait la plus lourde poterie de son père, mais il n´en n´a pas la force; si c´est un enfant, ce sera pour plus tard. Il pourrait conquérir les terres basses en suivant les rivières et les vallées comme l´ont fait les adolescents qui rêvent, mais lui préfèrera les terres hautes, celles des montagnes: par l´orient, ´faisant le tour´, du côté du soleil, du côté vulnérable mais éternel, pour le faire le jour et ainsi surprendre les fauves, qui ont coutume de s´abriter du côté de l´ouest quand vient la nuit. Plus tard cet enfant saura qu´il n´y a pas que les fauves. Mais aujourd´hui il est apparu dès l´aube pleine de clarté, son cœur n´est troublé que par ses battements, et il ignore tout des invasions venant de la mer d´occident.
«Mon professeur de littérature détient plusieurs clés de la vie. Il a forgé une grande amitié avec moi. Quand j´emploie le mot claie, je veux dire ces assemblages mortaisés, en bois robuste, qui sont ajustés de l´autre côté de la porte, comme les vieilles barres qui servent à fermer le champêtre grenier… Nous cheminons sur notre amitié, tendue pour faciliter la marche, et je sais ce qu´il veut me dire quand il récite les noms des écrivains latino-américains en lesquels il croit et en qui les patries obtinrent quelque réussite sans cependant éviter de se tromper grandement.
«Notre fraternité n´a pas de définitions idéologiques, ni de noms, ni de surnoms. Elle aurait pu être bleue ou rouge, et elle pourrait ressembler de la même façon à une balle molle qui nous permettrait ainsi de la faire rebondir en descendant le sentier. La nôtre, sans doute, est une amitié civile, c´est l´université; et le mot ´université´ ne peut signifier en aucun endroit du monde autre chose que ces conversations entre deux hommes d´atelier, ou davantage, sur leurs lectures, leurs recherches, leur expérience vécue.
«Je dis ´amitié civile´ et je témoigne de périodes précises d´une vie passionnée. Celle de Rumiñahui. De deux vies au bord de la passion. Celle du professeur et la mienne. Ni lui ni moi ne serions encore capables d´incendier cette belle ville blanche que nous traversons en direction de quelque point équidistant entre les deux quartiers, le sien à lui, à moitié résidentiel, quartier de gens ayant des professions, tranquille, et le mien, à jamais populaire. Cependant, tous les deux nous parlâmes de l´homme qui, lui, en fut capable.
« Rumiñahui, non seulement ton visage de pierre, mais aussi tes mains couleur de terre fraîche devaient renfermer plusieurs enfances, comme c´est mon cas. Savoir à l´instant que le condor est une sentinelle et un allié, découvrir le cœur de l´homme en direction des lances. Mettre sur la lame tranchante d´abord les signes de bienvenue, puis les prévisions climatiques; offrir les villes de la vallée. Voir ensuite que le langage est inutile, que les dieux passent, et que dans les mains étrangères la moitié d´une lance avec une poignée se nomme épée quand on l´enfonce dans la terre des tombes, et quand, en l´enfonçant, on commence à demander de l´appeler une croix. Je te comprends bien, Visage de Pierre, je justifie ta colère parce que tu l´as préparée. Mais surtout parce qu´au préalable tu as veillé sur tes fils et sur les fils de tes fils, et les as mis en lieu sûr. Et tu as pris les femmes et tu as indiqué le chemin qu´empruntent les femmes et les as mises en lieu sûr. Je te comprends et t´admire, car pour faire cela, tu as dû apprendre d´abord la croissance de l´arbre et la naissance du tien propre, avec des milliers d´années pendant lesquelles t´ont appartenu l´air, la lumière et le soleil, la savane et le soleil, les champs ensemencés et le soleil, la ville et le soleil, les eaux tièdes et le soleil, le mur et le soleil, les tanneries et le métal, la santé et le soleil.
«Quand, homme vaincu, corps robuste, regard de capitaine aux aguets, tu dus admettre une sagesse étrangère derrière le feu dévastateur de tes troupes, alors tu te retrouves seul, avec ta manière d´incendier et d´être pur. Les autres ne savent pas que la décision fut prise quand tu avais mon âge, c´est à dire plusieurs années avant l´incendie général. Le professeur de littérature qui est plein de bonté, le sait. Il me l´a raconté. Car le plan consistant à prendre la richesse de la vallée, à la conduire jusqu´aux montagnes en passant par les tanières de l´orient, contraires aux coutumes des naufragés, et celui de brûler la ville abandonnée émane de toi, de ton cœur adolescent et crédule, quand tu penses que tu es en présence d´êtres qu´il est impossible de reconquérir. Comme tu n´as pas d´autre façon d´aimer, tu les vaincs en t´y prenant ainsi, à partir de l´histoire. Tu conduis tes hommes plusieurs fois, et recules autant de fois. Et, uniquement pour qu´ils te reconnaissent, tu reviens un jour à l´attaque, après t´être assuré que les traces de la tanière ont été effacées, te trompant quand tu crois qu´elles sont indispensables à ceux qui te suivent à la trace. Ceux qui sont responsables de ta mort, si nous, nous ne le sommes pas de ta résurrection.
«À demain, professeur, à demain, merci de m´avoir demandé de vous aider à tenir le secrétariat du Journal qui durera seulement six mois, merci de croire que le papier et moi sommes utiles, de me parler des jeunes générations et des précédentes comme si elles n´en faisaient qu´une. Vous savez bien que cette mission que nous avons d´écrire, est notre pauvre incendie. Vos fines lances, ainsi que celles de vos amis, ont été plus efficaces, parce que groupées, que ma chère lance à moi, qui est cassante, grosse et lourde; lance de la solitude, que je garde dans les mains par habitude, et qui me déconcerte par son inutilité quand vous vous éloignez de moi.
«Car chaque fois que je prends congé de vous et vous dis au revoir, je reste en bons termes avec tous, et j´éprouve quelque souffrance. Je pense que les autres professeurs également constituent par fragments ce Pays combattu et profond, qui renaît de ses cendres.
«À demain, professeur, je vais à mon cours de Droit.
«Si je me souviens des trois noms du Juge qui le dicte aux universitaires de ma faculté, tenus de suivre cette matière, je n´ai presque rien à dire. Il dit tout humblement. Il incarne le présent, un présent agile, spirituel, lucide. Il a les deux traits caractéristiques de notre Patrie: métis des hautes terres par la neige et le soleil, métis du tropique par le soleil et la mer. Les habitants de la Côte le considèrent comme leur appartenant, l´appelleraient ´montuvio´ (37) car ils appellent ainsi le rude dominateur de la forêt; nous, ceux des hautes terres, nous pourrions l´appeler témoignage, car nos poteries sont faites de ces pommettes. Comme il est l´orgueil de notre classe, bien qu´il dicte des conférences à tous, nous l´appelons ´docteur´ pour solliciter sa gratitude et la placer au centre de toutes les réunions.
«Dans ses classes, je dois faire des efforts, car mon imagination ne peut vagabonder. Atahualpa, Rumiñahui, comme moi, s´asseyent pour l´écouter, craignent même de poser des questions, car l´eau cristalline saute avec une telle pureté qu´un mot de trop peu la souiller.
«Il a été Recteur de l´université, Doyen de sa faculté, qui n´est pas la mienne, Ministre des Travailleurs installé par les travailleurs. Dans tous ces lieux, non seulement ceux qui furent choqués par sa justice l´ont combattu mais aussi ceux qui exigeaient l´incendie de la ville avant la bataille, avant de faire face et de mettre les femmes et les enfants en lieu sûr, et avant de savoir si cette fois également nous perdrons la guerre.
«Comme il leur a dit non et qu´il a pris soin du passé avec un amour patriarcal, et qu´il a pardonné toutes les audaces, il a recouvré sa modeste profession de juge et est venu nous dicter son cours avec ses mêmes pommettes sombres, sa voix calme et sonore, avec sa sagesse qui tient du livre et de la vie, et des deux à la fois, munie d´un filtre pour l´action des hommes et de leurs écrits.
«C´est un allié de la bibliothèque: ´Nous n´aurons pas d´Université tant que vous n´irez pas à la bibliothèque et au laboratoire six heures par jour´ nous dit-il. Et dans mon for intérieur je le réclame parce que cette Université est pauvre et que le laboratoire existe à peine et coûte beaucoup d´argent, et qu´il y a peu de personnes et peu de livres dans la bibliothèque et une poussière implacable qui grimpe la nuit sur les rayons.
«Mais c´est notre Université, c´est la sienne, celle des professeurs d´histoire, de littérature, l´Université aimée dans laquelle j´acquiers droit de cité bien qu´elle prépare quelques uns à la vie routinière et d´autres à une mort stérile.
«Cette Université où l´on ne citera pas mon nom si ce n´est en lisant la liste des inscrits. Car je le sais bien, les autres ne sauront presque rien de moi.
«C´est elle…”.
Jean me raconta que les étudiants assistant aux cours se réunissaient pour protester contre le coût de la vie, qu´un vieil étudiant inscrit dans plusieurs facultés, ancien élève ayant terminé ses études dans une autre université, dont la femme, enceinte, présidait les manifestations, haranguait les autres, après avoir remporté trois concours d´art oratoire.
Je lui demandai s´il pensait prendre toujours part avec eux à ces manifestations.
– Ce sont des hâbleurs. La femme va devant, et lui derrière, mais nous appartenons à la même famille- me répondit-il.
– Veux-tu dire que ces jeunes gens et leurs groupes sont tes lundis?
– Ils sont mes lundis –fut sa réponse.
Après il cessa de venir me chercher. Les universitaires criaient dans la rue, les militants politiques tiraient mortellement cachés derrière leurs balcons, les uns dans le dos de la gauche, les autres dans celui de la droite. Les policiers tiraient aussi. Le mari de la femme enceinte atteint, s´effondra. Ses camarades rendirent la police responsable. La police dit que c´était la balle d´un civil. En fait, cela revenait au même. Les journaux s´inquiétaient de son sort, et nous apprîmes que sa femme avait été transportée à la maternité par les voisins pour donner naissance à un fils prématuré.
Quant à Jean, personne n´en parla. Par ailleurs, presque personne ne le connaissait. Moi-même ne me serais pas aperçu qu´il était absent, si sa mère aveugle, avec sa canne reposant sur ses bras, ne s´était pas présentée chez moi avec un véritable rugissement:
– Mon fils, encore mon fils.
C´est ainsi que je sus que Jean était absent au rendez-vous du samedi. Nous n´allâmes pas à l´hôpital public parce qu´elle y était déjà passée. À la prison, on nous dit que les prisonniers avaient été libérés le vendredi. Alors nous nous dirigeâmes vers la morgue. Et c´est là que je pus le voir, une fois de plus, avec deux éperons irréguliers coagulés sur les tempes, ses yeux fixant de nombreuses vallées, vues de la plus haute de toutes les collines.
Anne-Marie pleura comme elle ne l´avait jamais fait, plus que pour la mort de Jésus, avec tant de gémissement et tant de larmes que je fus étonné de ne pas voir se dissoudre la taie de ses yeux.
Je trouvai le temps de passer par la boutique de la femme de Guayaquil. Nous nous connaissions de vue. Nous allions être deux, pensais-je, les à moitié connus, qui allions arriver à sa porte: la mort, et moi.
Je luis dis que je désirais lui parler de Jean et ses yeux ne furent pas seuls à répondre. Son corps entier vibra, secoué par une force intérieure. Alors apparurent la terre du ceibo (38) s´interrogeant sur sa pluie, celle du palétuvier attendant l´inondation, celle du bananier, frustrée de sa récolte, redoutant le retard de la pluie et sa gangrène; celle du pétrole, en attente devant la forêt.
Elle se rendit compte que mes nouvelles ne pouvaient être bonnes et toute cette terre s´assombrit.
– Ne me le dites pas, je l´ai deviné. Il y a presque un mois que je ne l´ai vu.
Elle n´essaya même pas de faire cesser ses pleurs. Elle me dit qu´elle était enceinte. Si elle avait à dire des malédictions, elle ne l’exprima pas. D´une voix tremblante par où filtrait la rage elle ajouta seulement:
– Pour moi cela n´a pas d´importance, je sais travailler, on s´en rendra compte plus tard.
Elle me dit que Jean mourait sans savoir qu´elle attendait un enfant, parce qu´ils avaient eu une discussion et qu´elle avait prononcé des phrases dures. Lui, sans dire un mot, avec sa façon tranquille, était parti, simplement.
– Je savais qu´il allait revenir si je l´appelais- indiqua-t-elle.
Et maintenant la mort s´interposait.
Quand je l´invitai à m´accompagner pour voir Jean, elle pleura plus fortement et refusa.
– Non -me dit-elle- ce n´est pas possible, sa mère n´a jamais accepté que nous le partagions. Si j´y vais, je la blesse. Ce n´est pas concevable. Allez-y seul. Son mort lui revient. Je me console avec ce fils.
Et il en fut ainsi.
Après avoir rempli les formulaires pour le mort, nous le transportâmes à Pachanlica. À cette occasion, lors de l´ultime retour, nous étions seuls tous les trois.
Je le laissai là, après l´avoir enterré. Et j´y laissai aussi Anne-Marie, dans sa vieille pièce, les yeux fixés sur une porte permanente, où il n´y aurait plus jamais de samedis.
Je me suis entretenu avec l´éditeur sur les possibilités de changer la mort de Jean Hiedra. Nous avions pensé qu´en la rendant moins triste nous sauvions une pièce littéraire, lui donnions la contexture d´un roman. L´éditeur et moi avions plusieurs solutions, avec des variantes différentes, approuvées par divers groupes de lecteurs.
Cependant je relis aujourd´hui mes notes. Et il m´apparaît qu´elles ne permettent pas la moindre possibilité de modification. Que je n´ai jamais pu ni ne pourrai jamais changer les témoignages. Et que dans l´hypothèse où je le pourrais, Jean Hiedra serait toujours le même. Car peu importe comment on relate une vie vécue.
Je crois que dans ma transcription je suis parvenu à être fidèle aux faits. Si j´ai été ou non fidèle à l´esprit de ces faits, c´est quelque chose dont je suis moins sûr.
Il est possible qu´il en soit ainsi, que Jean, s´il avait vécu, m´ait donné raison, parce que dans ses mains il n´y eut jamais d´autre possession qu´un lambeau de paix, parfois partageable, et parfois gardé avec amour par sa très haute, sa très interandine solitude.
NOTES:
(13) “el teniente político”: (T.) Les attributs de ce fonctionnaire sont multiples. Elles rappellent ce qu´ étaient celles des responsables des brigades spéciales sous le régime de Vichy.
(14) “Cuenca”: (T.) Ville située au sud d´Ambato, chef-lieu de la province de l´Azuay, de 160.000 habitants.
(15) “Tungurahua”: (T.) Outre le nom de la province, volcan de plus de 5000 m situé au Sud Est d´Ambato.
(16) “Cascade d´Agoyán”: (T.) Appelée aussi “Saut de l´Agoyan”; située sur la roue de Baños à l´Orient, près de la rivière Pastaza.
(17) “Atahualpa”: (T.) Dernier empereur Inca, fait prisonnier par Francisco Pizarro et mis à mort par les Espagnols le 29 août 1533.
(18) (T.) Cf. ci-dessus édition P. 11. (Passage de la traduction p.2: «… qu´elle devait s´en remettre à lui pour connaître le contenu des deux lettres annuelles des parents, l´hebdomadaire dominical…»).
(19) “Machala”: (T.) Ville située sur la Côte, au sud de Guayaquil, chef-lieu de la province El Oro, le plus riche centre producteur de bananes du littoral.
(20) “Esmeraldas”: (T.) Dépression côtière du nord du pays, qui s´étend sur 20.000 km2.
(21) “marimbas”: (T.) Instrument africain utilisé dans de nombreux pays latino-américains, dont on joue comme du xylophone. Avec le “bongo” fait d´un tronc d´arbre creux et recouvert d´une peau, et les “maracas”, il constitue l´ensemble instrumental utilisé par les noirs (“morenos”) de cette province d´Esmeraldas, connus pour leur tempérament joyeux et remuant et leur folklore richement coloré.
(22) (T.) Allusion au terrible tremblement de terre d´Ambato qui, le 15 août 1949, détruisit en partie l´agglomération.
(23) (T.) Cf. ci-dessus note 21.
(24) (T.) Cf. ci-dessus note 8.
(25) “Latacunga”: (T.) Chef-lieu de la province de Cotopaxi, situé au nord d´Ambato. Important centre agricole dont le sol a été fertilisé par les cendres du volcan Cotopaxi à la suite de l´éruption de 1880, et où l´on exploite la pierre ponce que rejeta le volcan sous forme de lave.
(26) “Guayas”: (T.) Région côtière –fleuve et estuaire- dont Guayaquil est la capitale.
(27) “Jéricho”: (T.) Cf. ci-dessus l´édition p. 73.
(28) “Rumiñahui”: (T.) Général d´Atahualpa (cf. note 17) qui après la mort de ce dernier s´opposa farouchement à la progression des Conquistadors, incendiant les villes -dont Quito- sur son passage. Fait prisonnier par Benalcázar, torturé puis soumis à pendaison en janvier 1535.
(29) “Terre Verte”: (T.) Ce nom a été évoqué par Jorge Carrera Andrade (cf. ci-dessous l´édition p. 81) dans son livre: La Tierra siempre verde –La Terre toujours verte– publié en 1955 aux éditions Internationales (Cercle Paul Valéry). Les chroniqueurs des Indes Occidentales appelèrent le Royaume de Quito “le pays de l´éternel printemps ou la terre toujours verte”.
(30) «L´orange des physiciens transpercée d´une flèche”: (A.) Allusion aux philosophes physiciens de la Grèce présocratique, et indirectement à Zénon d´Élée.
(31) «Les lapins de Carrera Andrade»: (A.) Allusion au poème “La Vie Parfaite” de Carrera Andrade.
(32) “L´Ichimbía”: (T.) Avec le Panecillo, collines qui entourent Quito, de même que les deux sommets du volcan Pichincha.
(33) (T.) Selon Cieza de León, chroniqueur espagnol digne de foi, Atahualpa (cf. notes 17 et 28) à sa mort, en 1533, avait plus de trente ans.
(34) (T.) “Huayna Cápac”: Empereur Inca, père de Huáscar et d´Atahualpa. Il entreprit en 1513 la conquête de l´Équateur, s´empara de Quito, s´éprit de la princesse Cacha. Atahualpa serait né de cette union. Frère bâtard et rival de Huáscar qui régnait au Cuzco (Pérou), il remporta aidé de trois de ses généraux, dont Rumiñahui, une victoire décisive devant cette forteresse, et fit son frère prisonnier. L´arrivée des Espagnols vint bouleverser ses plans. Atahualpa, de par sa mère, eut toujours une préférence pour la “Terre toujours verte”, d´où la reconnaissance que lui témoigne le peuple équatorien. Il est à ce pays ce que Vercingétorix est à la France.
(35) “Rumiñahui”: (T.) Cf. notes 28 et 34.
(36) “Visage de pierre”: (T.) En quechua “rumi”= la Pierre et “ñahui”= visage.
(37) “montuvio” (T.) Habitant de la Côte, en Équateur, opposé souvent au “Serrano”, habitant de la Sierra ou cordillère.
(38) “ceibo”: (T.) Arbre majestueux d´Amérique, appelé également “ceiba”. Gabriela Mistral l´associe à la végétation luxuriante, dans son poème “Ronde de la ceiba équatorienne”: “… en la ceiba está la verde/¡llamarada de América!” («dans la ceiba réside la verte et vive flamme de l´Amérique!»